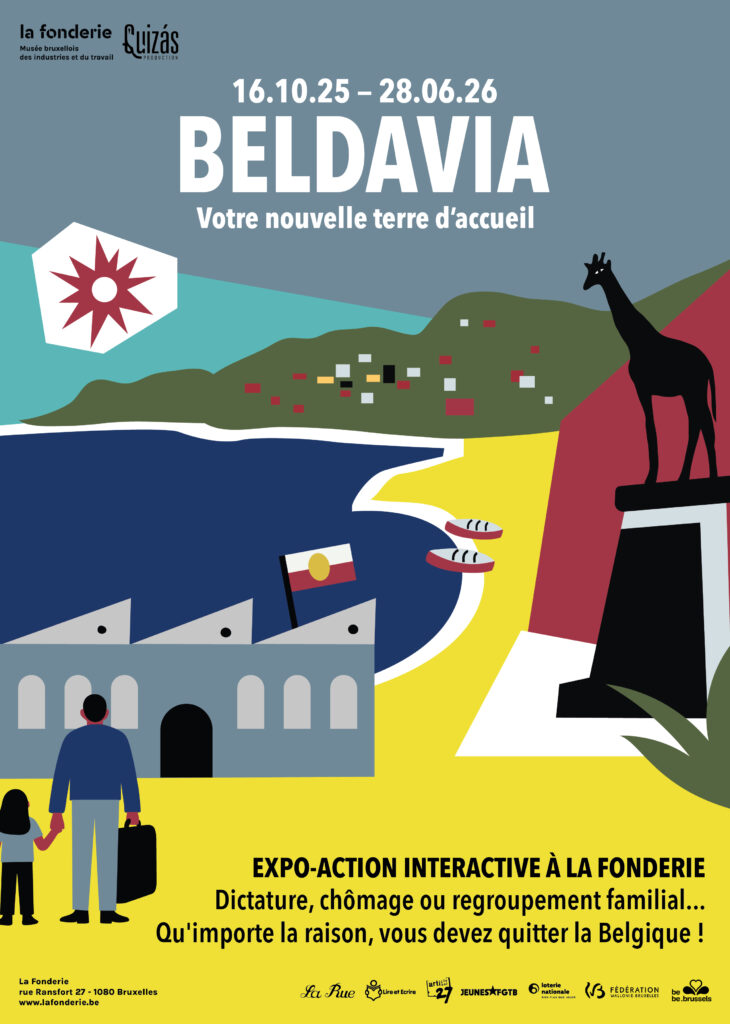

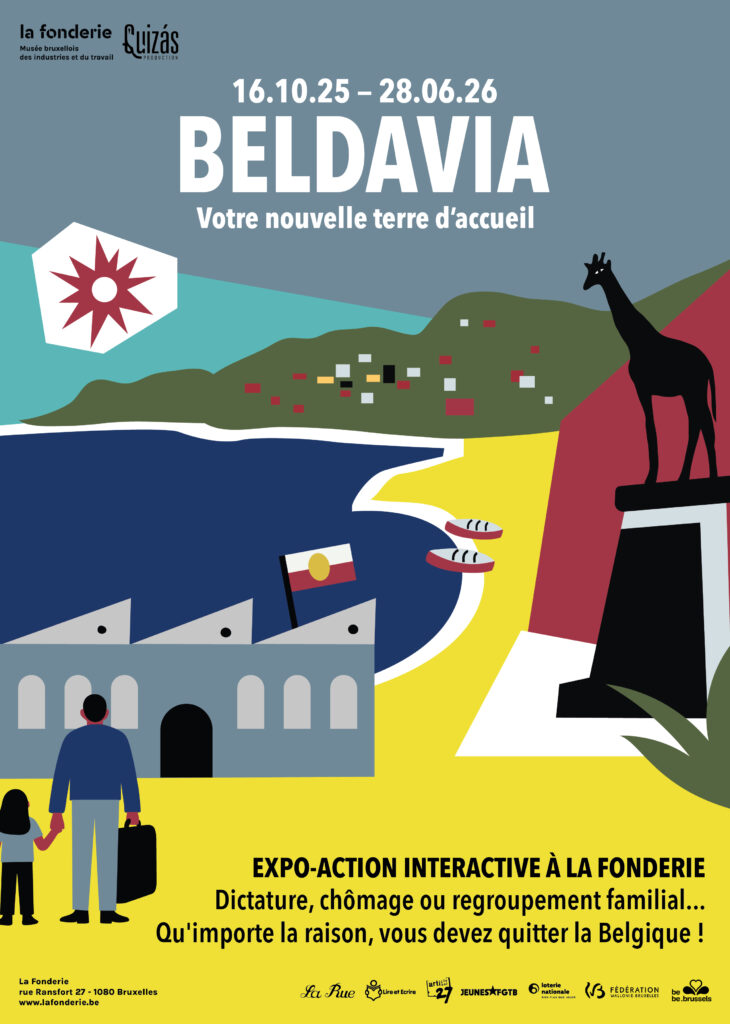


Le plus vieux métier du monde dit-on. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la prostitution sans jamais oser le demander… En allant à l’écoute des personnes prostituées et à la rencontre des photographies de Frédéric Pauwels, La Fonderie se penche sur la vie des travailleurs du sexe à Bruxelles. Cette exposition est complétée par une série de documents évoquant l’histoire de la prostitution à Bruxelles.
Si nous sommes aujourd’hui tous égaux, ce ne fut pas toujours le cas. L’exposition «Garçon ou fille» nous entraine dans le tourbillon de l’histoire du genre. Car le destin de chacun a longtemps été déterminé p ar son s exe : à l’homme la carrière professionnelle et les études qui y conduisent, à la femme la gestion ménagère et le soin des enfants.
Les regards sur la féminité et la masculinité, qui semblent ‘naturelles’ à beaucoup, sont loin d’être immuables. Dominantes à certains moments, contestées à d’autres, les idées préconçues apparaissent, disparaissent ou se transforment au cours du temps. Ont-elles disparu aujourd’hui ? Pas si sûr… Les stéréotypes sur la manière dont les filles et les garçons doivent se comporter continuent trop souvent de teinter nos actions. Il suffit d’ouvrir un magasine pour se rendre compte que l’image véhiculée par la publicité ne tend pas toujours vers l’égalité des sexe.
L’histoire d’un petit bout de campagne qui, durant des siècles, approvisionne le centre ville en produits agricoles, jusqu’à ce que la révolution industrielle transforme ses champs et ses prairies en un vaste faubourg usinier. Aujourd’hui, Molenbeek est une commune en pleine métamorphose, au centre de nombreux projets urbains. C’est le lieu de tous les contrastes, où l’espérance de vie d’un côté et de l’autre du chemin de fer n’est pas la même, où le bâti est sans doute le plus diversifié de toute la Région, où les vagues successives d’immigration ont donné naissance à une étonnante mixité culturelle… Molenbeek est complexe et surprenante. Son histoire raconte le présent, peut-être plus qu’ailleurs.
La Fonderie vous présente Molenbeek, du 11 février au 15 octobre 2006, à travers une exposition à la fois interactive, riche et dynamique, mêlant le texte à l’image et au son.
Le visiteur est accueilli dans une salle à l’ambiance feutrée où il rencontre des anciens et actuels habitants de la commune. Il est ensuite plongé dans les rues de Molenbeek, celles d’hier et celles d’aujourd’hui, et découvre la vie économique, sociale, culturelle … et même sportive de la commune. Histoire et actualité molenbeekoises sont mises en scène à travers un choix de pièces et de documents remarquables : tableaux anciens, photos récentes, vues du passé, objets industriels, produits molenbeekois, souvenirs et curiosités,…
Enfin, chaque Molenbeekois pourra se faire tirer le portrait afin de se retrouver en bonne place dans une galerie qui s’enrichira au fil des jours !
La carrière de Gilbert De Keyser a débuté peu de temps après la deuxième guerre mondiale et s’est poursuivie jusqu’à l’aube de notre siècle.
Ce brillant photographe qui disait ne pas aimer la ville, nous a quittés le 24 septembre 2001, nous laissant une œuvre riche et originale, nourrie par les multiples regards qu’il a portés sur Bruxelles et ses faubourgs. Ses photographies des années soixante, à la fois pessimistes et grandioses, images d’une ville livrée à l’automobile, à la promotion immobilière et à l’urbanisation brutale, l’ont rendu célèbre. Celles qu’il a réalisées au cours des décennies suivantes ont volontiers pris pour thème l’architecture ancienne, envisagée souvent à partir de détails ornementaux taillés dans la pierre. Son objectif qu’il veut précis les isole, les cadre et leur confère la monumentalité de la grande sculpture. Tandis que la lumière qui les effleure met en valeur les subtilités de leur épiderme.
L’intérêt pour ces traces apparemment modestes d’un passé architectural révolu amène Gilbert De Keyser à faire œuvre d’historien et à retrouver les noms et les œuvres des architectes du passé. C’est ainsi qu’il va entreprendre de dépouiller les archives des services de l’urbanisme de Saint-Gilles. Ses recherches aboutissent en 1989-1990, à la publication des Dossiers de l’urbanisme de Saint-Gilles (inventaire des constructions, des architectes, des entrepreneurs, des propriétaires, des entreprises, des artistes et des personnalités).
Diverses missions photographiques lui seront d’ailleurs confiées par les communes d’Ixelles et de Saint-Gilles. Ses photographies offrent dès lors un intérêt documentaire considérable, elles ont en effet beaucoup contribué à fixer la mémoire des lieux. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Il ne s’agit pas pour lui de faire uniquement œuvre d’historien ou d’archéologue du patrimoine architectural. Son travail n’est jamais systématique ; il ne choisit et ne retient que ce qui lui permet de faire œuvre créatrice. Lorsqu’il considère un sujet, il en voit déjà la photographie.
Dans le même temps, Gilbert De Keyser s’est aussi intéressé à l’univers du travail, des paysages qu’il a façonnés, des ateliers où ont œuvré des artisans dont le savoir-faire s’est perdu depuis. Et chose nouvelle dans sa démarche, il a voulu à maintes reprises y intégrer les travailleurs. C’est à ces divers aspects moins connus de l’œuvre de ce photographe que le Musée bruxellois de l’Industrie et du Travail a voulu consacrer la présente exposition. On y verra des paysages industriels aux abords du canal – entrepôts, moulins, cokeries – d’anciennes brasseries, les ateliers de la firme Blaton-Aubert où, à partir de moules, on fabriquait des statues de béton destinées à l’ornementation des parcs, les ateliers Salu de Laeken … On y suivra le travail d’artisans comme le ferblantier, le rémouleur ou l’encadreur. En tout près d’une centaine de tirages originaux seront exposés.
11 novembre 1918, 11 heures, l’armistice est proclamé. Les foules exultent et acclament la fin de la guerre. À l’occasion du centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, La Fonderie présentera, dès le 6 mai prochain, l’exposition conçue par le CARHIF, Gender@war 1914-1918, qu’elle complètera de pièces originales.
L’exposition trouve sa place à La Fonderie car elle offre un regard social sur cette guerre dont l’ampleur et l’extrême violence suscitent encore une profonde émotion. La Première Guerre mondiale a profondément bouleversé la société héritée du 19ème siècle. Plus spécifiquement, dans le domaine de l’égalité des sexes et de la division des rôles, plus rien ne sera comme avant.
La mémoire collective véhicule encore les images du valeureux soldat défendant la patrie et de la femme soignant les blessés ou pleurant ses morts. Mais ces images convenues dissimulent les rôles bien plus complexes et multiples attribués aux hommes et aux femmes durant le conflit.
À travers des exemples tirés de quatre pays (Allemagne, Belgique, France et Grande-Bretagne), l’exposition explore l’étroite dépendance entre les fronts militaire et civil et ses conséquences sur les rôles masculins et féminins. Qu’attend-on des hommes, des femmes et des enfants ? Quelles sont leurs souffrances et leurs contributions à l’effort de guerre ? Comment la guerre affecte-t-elle leur statut dans la famille et la société ?

En France, en Allemagne et en Grand-Bretagne, où la mobilisation des hommes est importante, les femmes remplacent les hommes et accèdent à des métiers traditionnellement masculins : pompières, factrices, conductrices ou receveuses de tramways, employées dans certaines administrations… Sans oublier que, dès 1915, elles sont requises pour l’industrie de guerre. Ces incursions dans des domaines masculins créent souvent des craintes quant à l’inversion des genres et à la concurrence des femmes sur le marché du travail.
L’exposition suggère des réponses à ces questions, en montrant le choc infligé à des dizaines de millions d’hommes et de femmes : la guerre envoie les hommes au front, sépare les familles, désorganise le monde du travail, propulse les femmes dans des fonctions traditionnellement masculines, ou au contraire, dans les régions occupées, renvoie les hommes et les femmes au foyer et les oblige à gérer ensemble la précarité domestique. Comment la guerre brouille-t-elle les codes de la féminité et de la masculinité ? Comment exalte-t-elle des valeurs très conventionnelles tout en proposant des modèles émancipateurs ?
Enfin, Gender@war décrit les conséquences de la guerre sur les droits économiques et politiques des hommes et des femmes et la construction de la mémoire du conflit.

En Belgique occupée, seuls 20% des hommes sont absents. L’industrie et le commerce sont à l’arrêt et le chômage explose pour les femmes comme pour les hommes. C’est ensemble qu’ils affrontent les destructions, les réquisitions et le blocus, font la file pour recevoir l’aide alimentaire ou s’activent dans de nombreuses œuvres caritatives. Cette situation fait redouter à certains une “féminisation” des hommes.
Confrontant en permanence propagande, rôles attendus et réalité, l’exposition dépasse les clichés et fait largement réfléchir aux effets des conflits armés sur le statut des hommes et des femmes dans la société. Trilingue (français – néerlandais – anglais) et présentant plus de 300 documents (photos, affiches, dessins, caricatures, publications, lettres, cartes postales…) issus de nombreux centres belges et étrangers, elle s’adresse à un large public, jeune et moins jeune. Elle sera accompagnée d’un programme d’activités variées : journée familiale pour l’ouverture, visites guidées, animations scolaires, concours d’écriture sur la lettre de guerre, lecture publique, conférences…
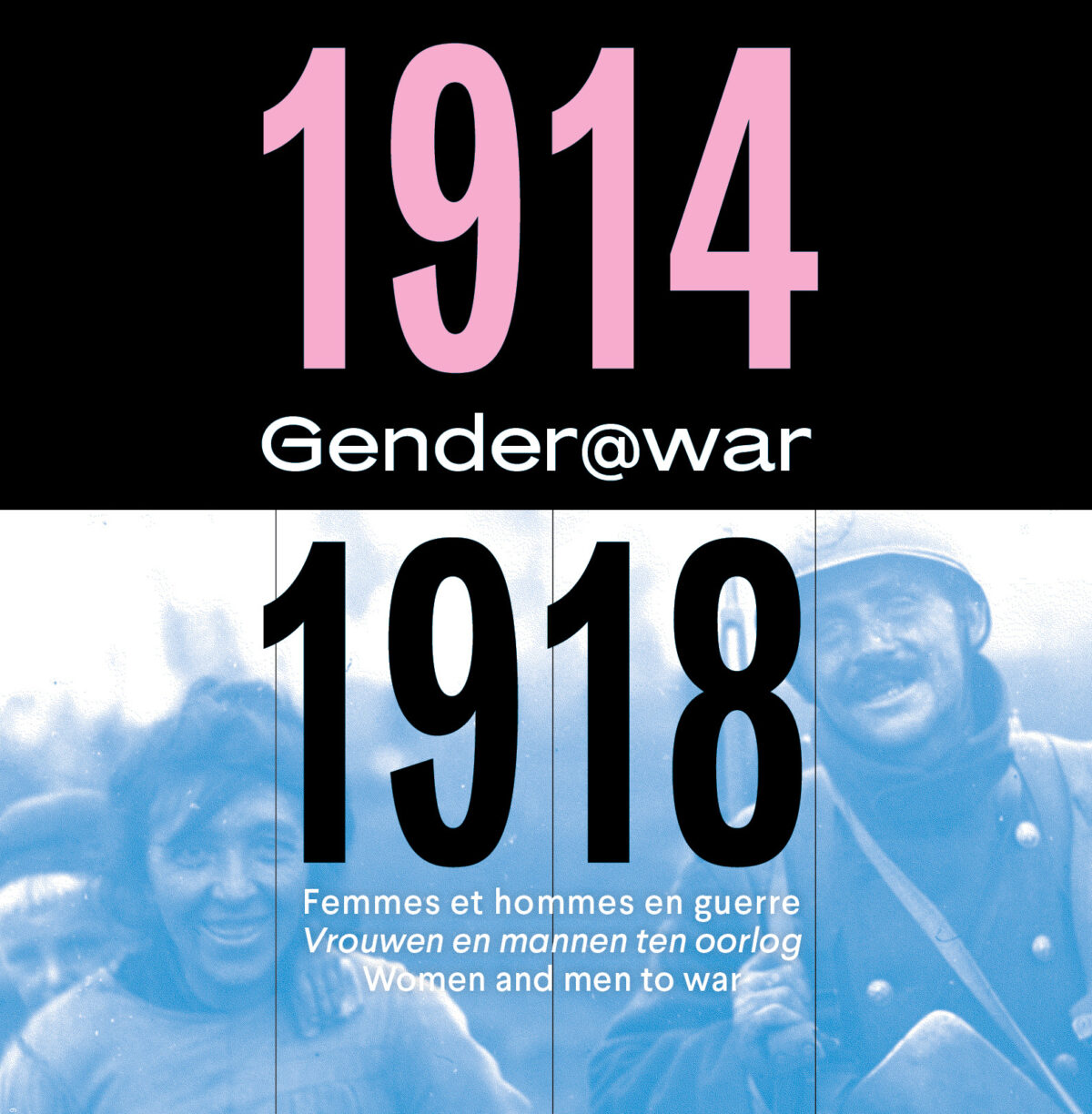
Faire sa lessive, un acte anodin? Certainement pas : depuis que l’homme porte des vêtements, entretenir son linge est une préoccupation majeure des foyers. Si de nos jours, la lessive est devenue, une opération banale, rapide et relativement bon marché, il n’en a pas toujours été ainsi. Dans le passé, la pénibilité de cet acte ménager est difficilement imaginable, alors que pour nous il suffit d’appuyer sur un bouton pour lancer un programme adapté à nos textiles. Il est important de rappeler la place que prenait la lessive dans la vie quotidienne de la plupart des femmes avant l’arrivée des machines à laver automatiques. Pendant des siècles, faire son linge fut une véritable corvée sans cesse répétée qui se déroulait sur plusieurs jours dans des conditions
La Fonderie travaille pour son prochain programme quadriennal sur une grande exposition autour de la lessive, de son histoire et de son évolution. Nos collections regorgent en effet d’objets, machines ou savons en tout genre, et nous serons heureux de pouvoir les partager avec vous. Nous parlerons dans cette exposition de progrès techniques, de contexte socio-économique, d’hygiène, de la place de la femme et du travail domestique, de pratiques sociales, de folklore, de la politique hygiéniste de Bruxelles dans son combat pour la propreté ou encore du rôle des wasserettes aujourd’hui ou de la lessive ailleurs dans le monde. Vous l’aurez compris, la lessive touche à bien plus d’aspects que le simple entretien du linge.
Mais pour préparer cette exposition, nous avons besoin de vos souvenirs et témoignages sur vos pratiques et celles de vos aïeux. Si La Fonderie est bien le musée bruxellois des industries et du travail, elle est aussi reconnue comme acteur d’Education permanente. Ce qui signifie que pour nous, les publics sont vraiment au cœur de notre action. En conséquence, nous souhaitons construire cette exposition à partir de vos témoignages.
Nous proposons depuis mars une activité peu banale dans le monde des musées: une exposition préparatoire. Nous vous invitons à visiter cette pré-exposition, installée dans la salle des électriciens. Une présentation compacte de la problématique dans un espace réduit, avec comme objectif non seulement de vous introduire à cette extraordinaire thématique qu’est la lessive, mais aussi de vous interroger sur vos souvenirs et pratiques. Ceux-ci nous serviront à élaborer notre prochaine scénographie.
Car pour toute bonne lessive, ne faut-il pas un prélavage ?

Quelques artistes exposés : Claudio Bottero, Pavel Tasovsky, Giovanni Rotondo, Lukas Kucera…
Sculpture de Pavel Tasovsky Jr
La forge comme fil rouge…
A l’âge de 23 ans, je me suis intéressé à l’univers de la ferronnerie d’art grâce à une rencontre fortuite mais tellement heureuse avec un des maîtres artistes-forgerons les plus connus en Europe à l’époque : Alfred Habermann. C’est chez lui que j’ai fait mes premiers pas au feu, c’est lui qui m’a appris la rigueur ; l’importance de préparer les projets jusqu’aux détails les plus infimes, de passer par la phase créative du dessin, de garder l’atelier en ordre, de prendre exemple sur la nature… Il fut, si ce n’est mon père spirituel, au moins mon père manuel. Freddy – comme j’avais le privilège de l’appeler – m’a permis de rencontrer durant mes années d’apprentissage de nombreux forgerons dans différents pays. Puis je fis mes propres découvertes et suivis mon chemin, guidé par cette curiosité dont j’aime à penser qu’elle me caractérise. Toutes ces histoires de forge nourrissent aujourd’hui ce regard que je porte sur mon histoire, ici racontée par cette exposition.
Laissez-vous mener par ce fil rouge, par ma passion pour le feu créateur, le feu du forgeron.
Belle découverte !
Michel Mouton.

Entre 1870 et 1940, une grande variété de maisons du peuple se bâtit à travers l’Europe. Ces établissements, humbles ou grandioses, sont le lieu physique de structuration des masses ouvrières et contribuent à l’obtention de réelles avancées en matière de droits politiques et d’accès à l’éducation. Ce sont aussi des lieux de rencontre, de convivialité, des espaces de réflexion, de solidarité, de culture et d’émancipation. En Belgique, les maisons du peuple assurent l’ancrage du Parti ouvrier belge, fondé en 1885.
Dès les origines, les maisons du peuple sont portées par leurs sociétés coopératives qui fournissent aux ouvriers des produits à bon prix et assument les frais liés à l’achat et au fonctionnement des bâtiments ainsi qu’aux investissements. Les maisons abritent
des magasins coopératifs et des services (boulangerie, épicerie, aunages et confection, boucherie, charbon, pharmacie, café…), ainsi que des sociétés d’éducation et de loisirs (harmonie, théâtre, cinéma, art, sport…). Elles accueillent également des activités syndicales, mutualistes et politiques. Enfants, jeunes gens, adultes et personnes âgées trouvent en un seul lieu des activités qui leur sont spécifiquement destinées. L’imbrication du récréatif et du politique contribue à imprégner les participants des valeurs socialistes.
Ces forteresses du mouvement coopératif sont un défi pour les architectes, qui doivent intégrer dans leur programme architectural le politique, l’économique, le social, le culturel… Dénommées la Ruche verrière, la Populaire, l’Espérance ou la Fraternelle…, les maisons du peuple expriment clairement, par leur architecture, une volonté d’affirmation.
Le nombre de maisons du peuple augmente jusque dans les années 1940. Par la suite, les syndicats et mutuelles s’autonomiseront, les coopératives tomberont en faillite et les mentalités évolueront vers plus d’individualisme. Ce contexte causera la fermeture des maisons du peuple. Elles gardent cependant dans les mémoires une valeur symbolique forte. De nombreux acquis obtenus grâce aux mouvements ouvriers et syndicaux persistent, comme les mutuelles. Ce qu’on appelle l’économie sociale a pris également le relais en cherchant à répondre aux défis sociaux et environnementaux qui se sont présentés au fil du temps. On pense notamment à l’éclosion des entreprises à finalité d’insertion socioprofessionnelle face à la crise.
Le rêve coopératif subsiste aussi aujourd’hui grâce à des initiatives émergeant de citoyens et basées sur le partage et la collaboration. Conjointement au parcours historique autour des maisons du peuple, l’exposition propose donc au visiteur d’explorer différentes formes de pratiques collaboratives déjà en place à Bruxelles.
Covoiturage, location de logements entre particuliers, crowdfunding, troc, échanges, dons, coworking, cohabitat, recycleries, Fab Labs… sont autant d’illustrations de cette économie du partage fondée sur les échanges de biens, de services ou de connaissances entre particuliers.
Ces expériences connaissent depuis quelques années un succès grandissant dans la capitale et révolutionnent notre comportement de citoyen et de consommateur. La ville change : nouveaux lieux, nouvelles pratiques, nouveaux modes de transport… L’individu n’est plus uniquement consommateur, mais peut devenir lui aussi acteur, producteur de biens ou de services, créateur, financeur ou décideur.
L’économie collaborative n’est pas une idée neuve, mais une pratique renouvelée par l’arrivée d’Internet et du système pair-à-pair, qui permet d’échanger entre particuliers, sans intermédiaire. Les “choses” que l’on possède (voitures, outils, lieux…), les compétences et connaissances également (les repair cafés, wikipedia ou les cours en ligne ouverts à tous) peuvent être partagées.
Dans ce processus, le modèle des coopératives a un rôle à jouer et l’on observe un renouveau du mouvement coopératif. Rendez-vous après le 19 mars pour un coup d’œil sur quelques coopératives bruxelloises qui ont accepté de s’exposer à La Fonderie. Elles sont représentatives de cette économie du partage réinventée qui entend redonner du sens au lien social, à la coopération, au bien-être commun face à la compétition et à l’individualisme.

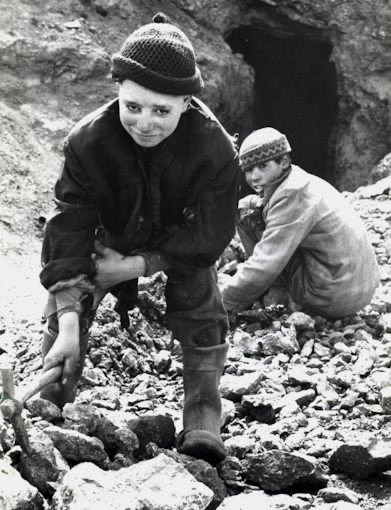
Charles Henneghien est photographe et médecin pneumologue. De 1962 à 1970, il exerce la médecine auprès des mineurs de la région d’Oujda, à l’Est du Maroc. Son engagement personnel, la connaissance qu’il possède du pays en général et des mineurs en particulier l’ont amené à témoigner.
Avec son épouse Paulette, ils s’installent en 1962 dans la région d’Oujda, l’un comme médecin au service du Ministère de la Santé publique du Maroc, l’autre pour enseigner les sciences au lycée local. Partis à titre personnel, ils séjourneront huit années dans ce Maroc redevenu indépendant en 1956.
Les photos que Charles Henneghien nous propose révèlent les conditions de travail difficiles dans les mines de charbon, de manganèse et de cuivre telles qu’elles étaient exploitées dans le Maroc oriental des années 60. Il exprime par ses clichés sa sympathie pour ces mineurs, son indignation face à leurs conditions de vie et aux mécanismes économiques responsables de leur misère.


Cette exposition vous plonge dans l’ambiance des stages organisés depuis 10 ans par Feu et Fer asbl. Quelles techniques, quel travail, quels gestes a-t-il fallu développer derrière chacun des objets exposés ? Comment façonne-t-on le métal pour lui donner forme et en révéler sa beauté ? Comment apprenons-nous, en quelques jours de stage, à aimer, comprendre et respecter quelques métiers ancestraux ?
Composée d’oeuvres réalisées durant les stages – souvent de très belle qualité – et de modules didactiques, l’exposition comporte peu de textes, car les images et les objets présentés suffisent à comprendre que derrière chaque sculpture, même le plus petit clou, l’apprenti a posé nombre de gestes et utilisé différentes techniques.


L’Académie de Dessin et des Arts Visuels de Molenbeek est l’une des plus anciennes de la Région bruxelloise. Fondée il y a 150 ans, elle se différencie d’autres institutions similaires par sa localisation : située dans un quartier industriel, elle aura longtemps comme vocation la formation ouvrière d’excellence. Soutenue par le patronat local, ses cours du soir à l’enseignement très pratique accueilleront des centaines d’apprentis et ouvriers avant d’évoluer fin des années soixante vers une académie aux objectifs plus artisitques.
En collaboration avec le Momuse et l’Académie, La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail vous propose une exposition où élèves et professeurs d’hier et d’aujourd’hui se croisent pour mieux comprendre cette étonnante école molenbeekoise. Si des grands noms y sont associés, comme Eugène Laermans ou Pierre Abattucci, ce sont surtout ces étudiants restés anonymes qui sont au coeur de notre exposition temporaire.
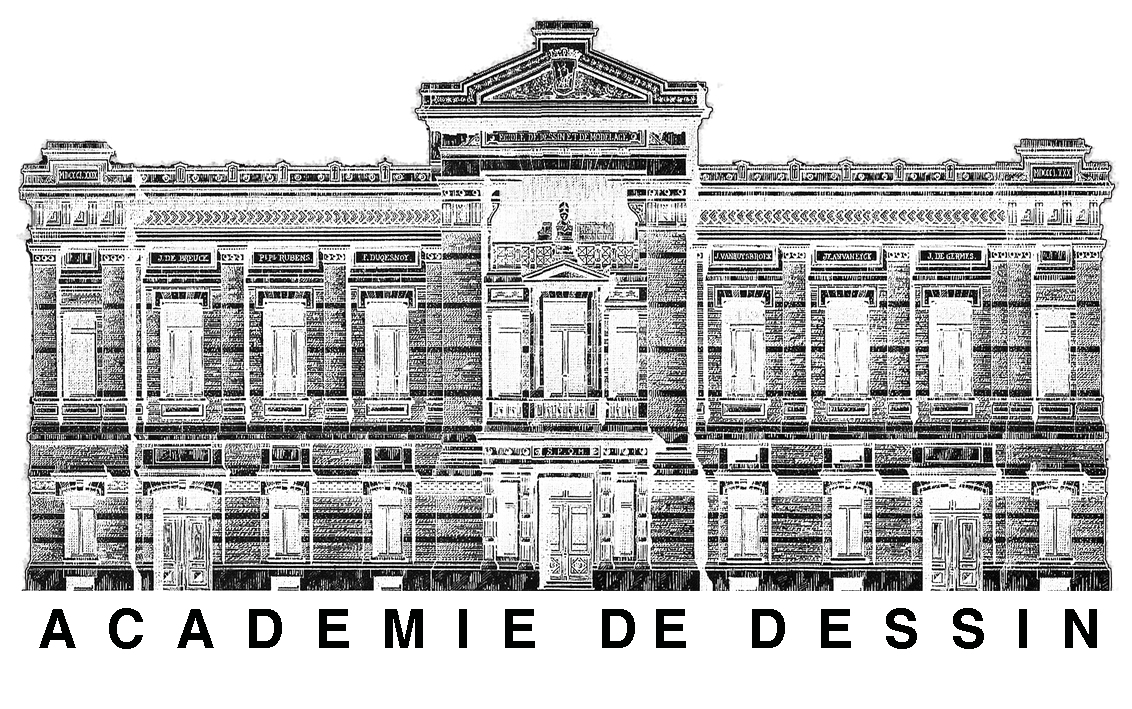
L’Acte I, au Centre d’Art de Rouge-Cloître du 13 février au 12 avril, se veut un travelling sur une vie faite de signes, d’empilements, d’assemblages improbables qui font sens ou contre-sens.
L’Acte II, à La Fonderie du 26 avril au 4 octobre, mettra quant à lui l’accent sur le lien entre l’œuvre graphique et photographique de Luc Van Malderen mise en volume par Michel Michiels.
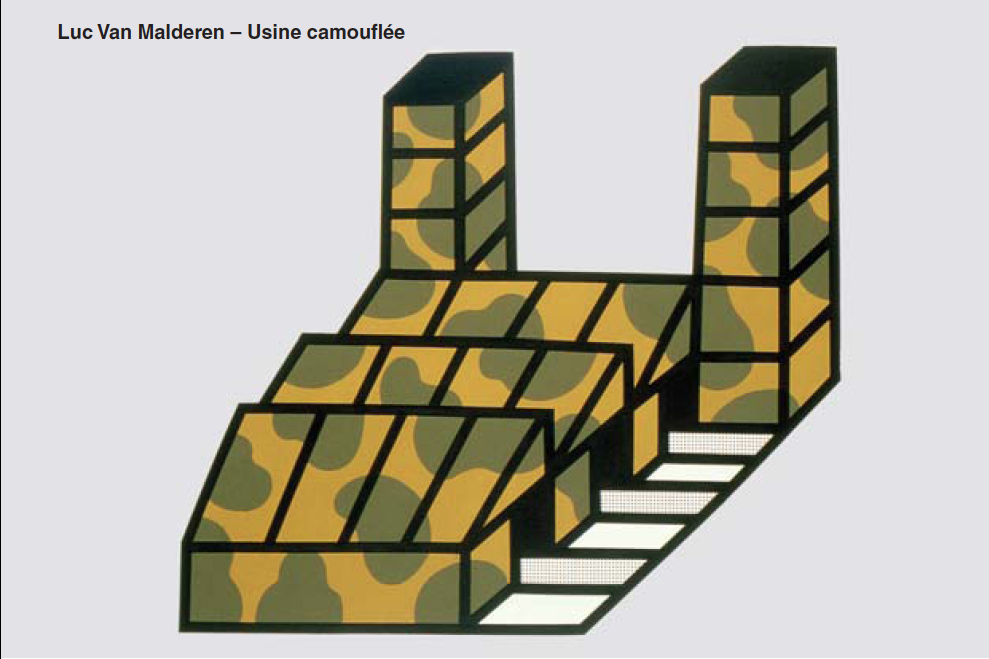
“Les enfants jouent : c’est leur travail. Ce serait bien de faire jouer les adultes en prétextant un travail urgent.” LVM
Né en 1930, Luc Van Malderen est un personnage, un plasticien de l’esprit des formes. Un penseur auteur d’aphorismes, un pédagogue… un explorateur tous azimuts. Il vit et travaille à Bruxelles où il dirigea le département de communication visuelle de l’ENSAV La Cambre de 1962 à 1994. Son influence fut considérable sur les générations de graphistes qu’il a formés. De la multiplicité de ses expressions, le vocabulaire synthétique de Luc Van Malderen n’a voulu retenir que l’essentiel. Il livre une œuvre graphique dédiée au signe, éminemment lisible, empreinte de poésie et d’humour. Ce qui importe chez Luc Van Malderen, c’est la dimension contemporaine de la réflexion globale. Le monde qu’il donne à voir n’a pas d’épaisseur, pas d’intention autre que graphique. Pourtant, cette œuvre ressemble à un jeu, un exercice de style – sans doute brillant – mais sans questionnement. Chez Luc Van Malderen, il n’y a rien à voir à l’intérieur. Les productions de Luc Van Malderen sont comme les notes d’une gigantesque gamme. Une note à la fois, mais qui en fait résonner bien d’autres.
L’Acte I qui aura lieu au Centre d’Art de Rouge-Cloître du 13 février au 12 avrilsera ainsi consacré au processus créatif de l’artiste : l’élaboration du vocabulaire plastique et ses innombrables déclinaisons. Toutes les étapes de la construction de son univers : carnets, calques, peintures, sérigraphies y seront abordées dans sa profusion dialectique, sa sobriété conceptuelle et sa sensualité. Une vie de création au service de la ligne !
Quant à l’Acte II qui se tiendra à La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail du 26 avril au 4 octobre se concentrera sur l’élaboration de l’abécédaire des formes dans l’œuvre de Luc Van Malderen, de ses photographies de sites industriels jusqu’à la mise en volume de ses créations par Michel Michiels. Au-delà du constat photographique, les œuvres révèlent une multiplicité d’interprétations inventées fondant un univers coloré, linéaire et juvénile.
L’INDUSTRIE
Passionné d’architecture industrielle, LVM arpenta la Belgique et l’Europe occidentale pendant près de 15 ans. En 12.000 clichés, il nous en livre le répertoire, en quelque sorte un abécédaire sur le terrain. L’âge industriel a dû se forger son vocabulaire. LVM se concentre sur les sites d’extraction, de transformation, de stockage. Cet univers est délibérément immobile. LVM joue avec l’éternité. Non que son oeuvre soit intemporelle, elle ne parle simplement pas du temps. LVM est l’auteur de plusieurs ouvrages dont deux sont intitulés Architectures industrielles en Belgique et ailleurs en 1992 (textes de Pierre Puttemans et Luc Van Malderen) et Archéologie industrielle en Belgique en 2002 (textes de Lise Coirier et Luc Van Malderen).
Michel Oleffe, quant à lui, signe en 2012 Luc Van Malderen. Poétique du paysage industriel. «Luc Van Malderen ne tente pas de faire table rase du poids de l’histoire mais au contraire puise à satiété dans ces immenses répertoires d’images prêtes à l’emploi, de ready-made architectural qu’il recycle à son profit et, à partir de là, réinjecte dans le circuit vivant de notre époque.» Catherine de Braekeleer
Des ateliers pour enfants, des conférences et des rencontres seront organisés en marge du cheminement de l’artiste Luc Van Malderen, au Centre d’Art de Rouge-Cloître et à La Fonderie, Musée bruxellois des industries et du travail.

Après six rencontres-débats inter muros, le Collectif Solidarité Contre l’Exclusion, La Fonderie et Lire et Écrire Bruxelles vous invitent à poursuivre ces échanges autour des questions d’actualités lors d’un parcours guidé dans un quartier emblématique de Molenbeek.
Le Vieux Molenbeek, quartier situé en bordure du canal, est communément appelé « le Petit Manchester ». En effet, il témoigne d’une époque où Bruxelles était la deuxième ville la plus industrialisée au monde, après Manchester en Angleterre. Ses usines, ateliers et fabriques ont profondément façonné l’univers urbain et social de ce territoire. Peu de quartiers ont connu une histoire sociale aussi intense, dont les effets se font encore sentir aujourd’hui.
Ce parcours guidé vous invite à explorer les places et les rues du Petit Manchester belge à travers son histoire, et à discuter des enjeux et opportunités contemporains qui y sont liés. Le parcours s’achèvera au Musée bruxellois des industries et du travail, dont l’accès à l’exposition vous sera offert.


À La Fonderie, nous nous réjouissons particulièrement de voir ce festival de quartier, encore une fois, s’installer avec fougue, audace et générosité dans le Parc de La Fonderie et se faufiler jusqu’à notre site.
Pour cette troisième édition, nos voisins — Les Voisins van het Park — ont, comme à leur habitude, concocté un programme ample, convivial et varié : exposition d’art en plein air, ateliers pour petits et grands, performances, danses, concerts, cinéma, repas communautaires… et bien d’autres surprises pour petits et grands. Tout le monde y trouvera ses coups de cœur !
Pendant toute la durée du festival, les portails reliant le parc, notre site et celui de l’Auberge de Jeunesse Génération Europe seront exceptionnellement ouverts. Une façon d’associer la fête et la rencontre des voisins à la découverte, par des voies nouvelles, de ce lieu secret, insolite et essentiel qu’est le Parc de La Fonderie.
Pour assister à la soirée d’ouverture du festival le soir du 18 juin, franchissez les grilles et prenez le petit chemin dérobé entre le Parc de La Fonderie et notre site.
Au programme :
19:00-20:00
Performance : retransmission en direct du conseil communal de Molenbeek avec commentaires live
en collaboration avec le Conseil Citoyen de Molenbeek
20:00-20:45
Court métrage (preview) : DEMO de KRIS VERDONCK
en collaboration avec Two Dogs Company & le Musée de la Fonderie
21:00-22:00
Concert : SOFI NAUFAL
organisé par ZOT, la cantine de La Fonderie
À partir de 18h00 et en continu : Bar + Cuisine par ZOT, la cantine de La Fonderie

DEMO (2025, 20 min.) est la toute dernière œuvre vidéo de Kris Verdonck. Le film explore les environs de la zone du canal à Bruxelles — autrefois un axe de transport essentiel vers et depuis le cœur industriel de la ville. Bien que l’héritage industriel et les conséquences démographiques de plusieurs vagues migratoires soient encore très présents dans cette zone, d’autres forces y sont également à l’œuvre aujourd’hui. Les interventions infrastructurelles de grande envergure et la gentrification transforment peu à peu le paysage et le tissu social. Une mascotte nous guide à travers ce morceau de Bruxelles en pleine transformation, suggérant que la ville n’existe pas seulement comme réalité physique, mais aussi comme une scène où les forces et rapports de pouvoir réels trouvent un contrepoids dans notre imagination et nos projections collectives — tout aussi essentielles au renouvellement urbain.
Kris Verdonck participe également à l’exposition à travers des installations qui font dialoguer le Parc de La Fonderie et notre site.
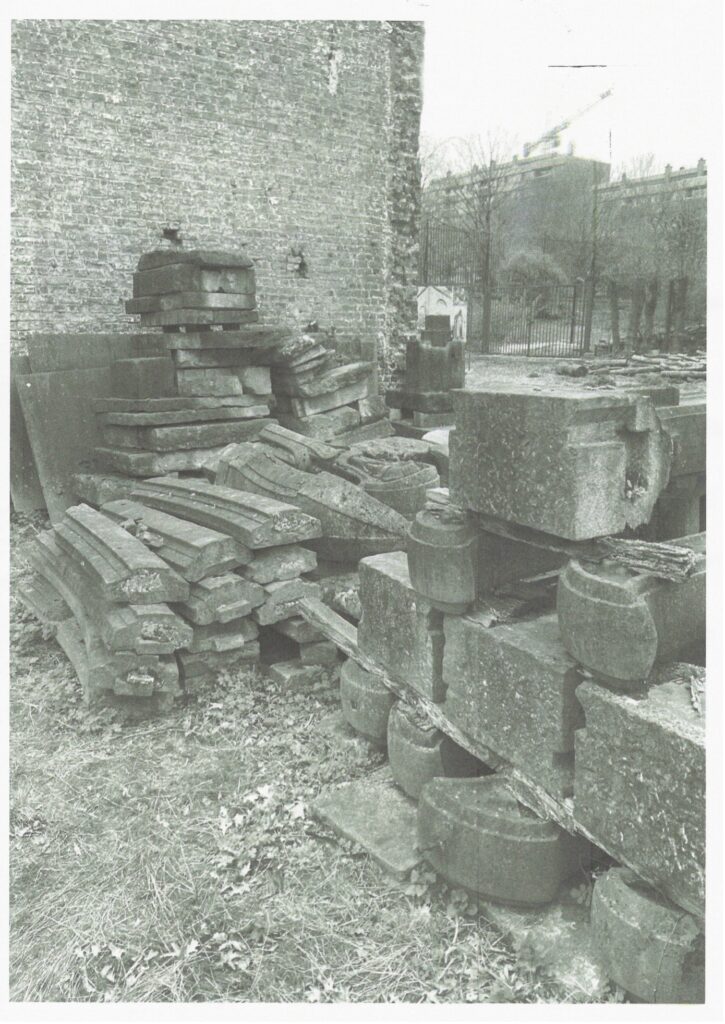
Trois autres artistes participant au festival ont également choisi de mettre en connexion le Parc de La Fonderie et notre site en retissant et en réinterprétant les liens et les articulations entre eux. Robin Brettar, Matilda Cobanli et Judith Geerts ont créé Documents Lapidaires, une installation en pierres bleues issues de la collection de La Fonderie et transportées dans le Parc.
L’installation est née d’une curiosité pour le caractère ambigu d’un tas de pierres dans le jardin du Musée de La Fonderie. Cette collection fragmentée de pierres provient de la maison de l’architecte Art Nouveau Ernest Blérot ainsi que de l’usine Cail et Halot, qui occupait le site actuel du parc de 1838 jusqu’au début du 20e siècle. Les artistes Robin Brettar, Matilda Cobanli et Judith Geerts ont déplacé ces pierres dans le Parc pour en faire le matériau d’une installation artistique. Par ce déplacement, les artistes réfléchissent aux implications matérielles du processus de reconversion et au statut changeant des objets. Cette question s’inscrit également dans la période où les anciens bâtiments industriels du Parc étaient connus sous le nom de « Musée Inconnu », un lieu de conservation d’éléments décoratifs et architecturaux issus de bâtiments bruxellois*. Ces « documents lapidaires », sauvés lors des démolitions et destinés à la rénovation ou à la réutilisation, racontent une petite histoire de Bruxelles. Documents Lapidaires fonctionne comme une présence historique et matérielle, constituée de pierres témoignant des transformations urbaines ainsi que des évolutions des valeurs économiques et culturelles.
La réalisation de Documents Lapidaires place la collectivité au cœur du projet. Robin Brettar, Matilda Cobanli et Judith Geerts ne travaillent pas seulement comme artistes individuels, mais questionnent aussi, par leur pratique collective, d’autres modèles de l’artisanat artistique. Le déplacement collectif et physique des pierres constitue un élément essentiel de l’œuvre. Des techniques manuelles et historiques sont ainsi mises en œuvre, confrontées à des conceptions contemporaines du travail, de l’autorité et de la sécurité.
* Un Musée Inconnu, Documents lapidaires. Article publié dans L’indépendance Belge, 1936
Pour consulter le reste du programme foisonnant de la Fête de l’ Éléphant, c’est ici !

Le mardi 17 juin prochain, venez vous informer et débattre autour du thème : « LES MURS ANTI-MIGRANTS DE L’ARIZONA », avec Sotieta Ngo (CIRÉ) et Antoine Roblain (ULB)
Le gouvernement Arizona dit vouloir s’orienter vers une politique migratoire plus contrôlée et plus humaine, mais surtout, vouloir lutter plus vigoureusement contre le phénomène de la migration illégale et imposer aux nouveaux·elles arrivant·es davantage d’efforts contraignants.
Si le gouvernement précédent avait déjà adopté une série de mesures portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes étrangères (loi pour une politique proactive de retour, loi Frontex…), l’Arizona marque clairement un virage répressif, axé sur la politique de retour, extrêmement stigmatisant.
Dans cet accord, le séjour et la sécurité des personnes étrangères sont fortement impactés, précarisés et leurs droits les plus fondamentaux sont limités, voire supprimés. C’est ainsi que l’asbl CIRÉ introduit le document dans lequel elle décrypte le volet “asile et migration” de l’accord du gouvernement Arizona.
Face à de telle dérives, que peut faire le·la citoyen·ne et quelles sont les limites d’une aide humanitaire venant de particuliers quand celle-ci vient pallier les insuffisances ou manquements (délibérés) des autorités du pays ?
Nous échangerons sur ces enjeux avec :
Sotieta Ngo, juriste de formation, directrice de l’asbl CIRÉ, un organisme qui œuvre depuis 70 ans pour les droits des personnes exilées, avec ou sans titre de séjour.
Antoine Roblain, co-auteur du livre « Héberger des exilés.es. Initiatives citoyennes et hospitalité » et vice-doyen à la recherche à la Faculté des Psychologie, Sciences de l’Education et Logopédie (ULB).
Les rendez-vous-débats ont lieu tous les troisièmes mardis du mois chez Zot, la cantine associative de La Fonderie. Un petit bar y est ouvert et il est possible de réserver un sandwich. Chaque séance fait, par ailleurs, l’objet d’un podcast particulier sur Radio Campus, dans l’émission Micro Ouvert.


Bruxelles est un marais. Au 13e siècle, c’était un hameau perdu dans le fond humide de la vallée de la Senne. Entretemps, les rivières ont été canalisées puis voûtées, les plaines inondables asséchées pour la culture et puis pour l’habitat, la ville de béton a fini par occuper tout l’espace. Pourtant, le marais est toujours là. La preuve ? Les caves et les chantiers régulièrement inondés. Et la végétation, très spécifique aux zones humides des climats tempérés, qui se développe dès qu’on lui en laisse le temps, dans les zones oubliées, en friche. Le Marais Wiels en est le lieu d’une démonstration vibrante et un modèle pour réfléchir aux relations entre l’eau et la ville.
Ancien chantier inondé puis abandonné pendant des années, ce lieu accueille maintenant une biodiversité animale et végétale remarquable à l’échelle régionale. Il accueille aussi des habitants humains qui y ont fabriqué des cabanes de fortune, ainsi que des graffeur·euses, des dealers, des potagers collectifs, des abeilles, des ruches et leurs humains, des dépôts d’ordures clandestins, des familles en promenade, des naturalistes, des militant·es. Toutes des entités et des pratiques qui ne trouvent pas ou peu de place légitime dans le tissu urbain viennent là s’épancher. Ceci renvoie à un troisième attribut des marécages – après l’omniprésence de l’eau et d’un écosystème adapté – un lieu où le contrôle social se relâche, se dissout, s’enlise.
Dans tout Bruxelles, la force de la ville et la force de l’eau se confrontent et se conjuguent en de multiples configurations. La zone humide contaminée par la ville devient parc d’agrément avec ses étangs décoratifs, qui n’en révèlent pas moins le tracé des anciennes rivières aujourd’hui invisibles. La ville, colonisée par la végétation, laisse passer l’eau dans les anfractuosités du béton. L’expérience urbaine elle-même contredit les définitions rigides, avec ses multiples échanges et fluidités.
Dans leur ouvrage Rendre l’eau à la terre, paru en 2024, Suzanne Husky et Baptiste Morizot opposent à la vision « fluxiste » de l’eau une vision inspirée par les castors. D’un côté l’eau est canalisée, entubée, séparée de son environnement, de l’autre l’eau est ralentie, épanchée et toujours redistribuée à l’ensemble du paysage pour le bénéfice de tous. Ce serait aussi deux manières de se rapporter aux vivants et, avec plus d’audace, de faire société. Bruxelles est un marais devient ainsi un point de départ spéculatif pour penser la ville comme un écosystème boueux et foisonnant et pour faire émerger des possibles politiques.

Le centre de documentation de La Fonderie conserve un très grand nombre d’images qui ont trait aux relations multiples qu’entretiennent l’eau et la ville. L’histoire de Bruxelles s’y déploie à travers des images de la Senne, des canaux de Willebroeck et de Charleroi, de ses étangs, de son réseau de distribution des eaux, pour ne citer que quelques exemples. La fourchette historique est large avec une prédominance d’images qui datent du 19e au 20e siècle. Il s’agit de gravures de presse, de dessins techniques, de caricatures, de photographies documentaires. Avec l’aide des archivistes du centre de documentation, Savinien Peeters, Marie-Jo Hernandez et Lætitia Makamisile Lokasa, près de 1000 images ont déjà été sélectionnées, mettant en présence l’eau et ses usagers humains et non-humains, de manière parfois évidente, parfois seulement indicielle.. La complexité foisonnante qui émerge de cet ensemble nous plonge dans le marécage bruxellois et nous donne le matériau d’une histoire à venir.
En partant du Marais Wiels comme modèle à penser une autre manière de faire ville et en se basant sur les images d’archives et sur l’histoire de la construction de Bruxelles, le film The Glowing Part of Yourself se donne pour ambition de raconter une histoire liquide de la ville, d’en explorer les eaux troubles et de la penser en écosystème boueux qui rassemble la plus grande variété possible d’espèces vivantes, humaines et non-humaines.
Biblio-filmographie

Le projet « Tram 51 ? » réunit des habitant.es de la commune bruxelloise d’Uccle, usager.es du Centre culturel et du CPAS, autour de la réalisation, avec et par elles et eux, d’une carte subjective ayant pour fil rouge l’ancien tracé du Tram 51, un transport en commun qui traversait la ville de part en part et reliait entre eux des quartiers d’une diversité remarquable, représentatifs de Bruxelles. Le projet s’est étalé sur toute l’année 2024. Un mini site web relatant la démarche et portant témoignages du projet par des audio, des visuels et des audiovisuels, a ensuite été mis en ligne.
Une ville est faite de quartiers et les frontières entre ces quartiers sont plus ou moins poreuses. Un transport en commun qui traverse ces quartiers, quels qu’ils soient et quelle que soit leur diversité, constitue un véritable lien entre les habitants de la ville. C’est ce lien qu’explore la publication Tram 51.
La démarche adoptée à Bruxelles par La Fonderie, le Centre Culturel d’Uccle et les publics du Centre Culturel et du CPAS d’Uccle peut être reproduite dans d’autres villes ou avec d’autres publics bruxellois.
La carte subjective, le site web et la fiche d’exploitation de ceux-ci vous proposent d’inviter votre public à créer des liens avec d’autres publics, d’autres institutions, d’autres quartiers.
Infos
Vous trouverez la carte subjective Tram 51 à l’accueil du Musée bruxellois des industries et du travail à partir du 26 mai 2025
La fiche d’exploitation de ces deux outils d’éducation permanente est disponible sur simple demande au service éducation permanente de La Fonderie à partir du 7 juin 2025.
ep@lafonderie.be – 02 413 11 83
Le projet Tram 51 a été coordonné par La Fonderie et le Centre Culturel d’Uccle et a réuni les publics du Centre Culturel et du CPAS d’Uccle.
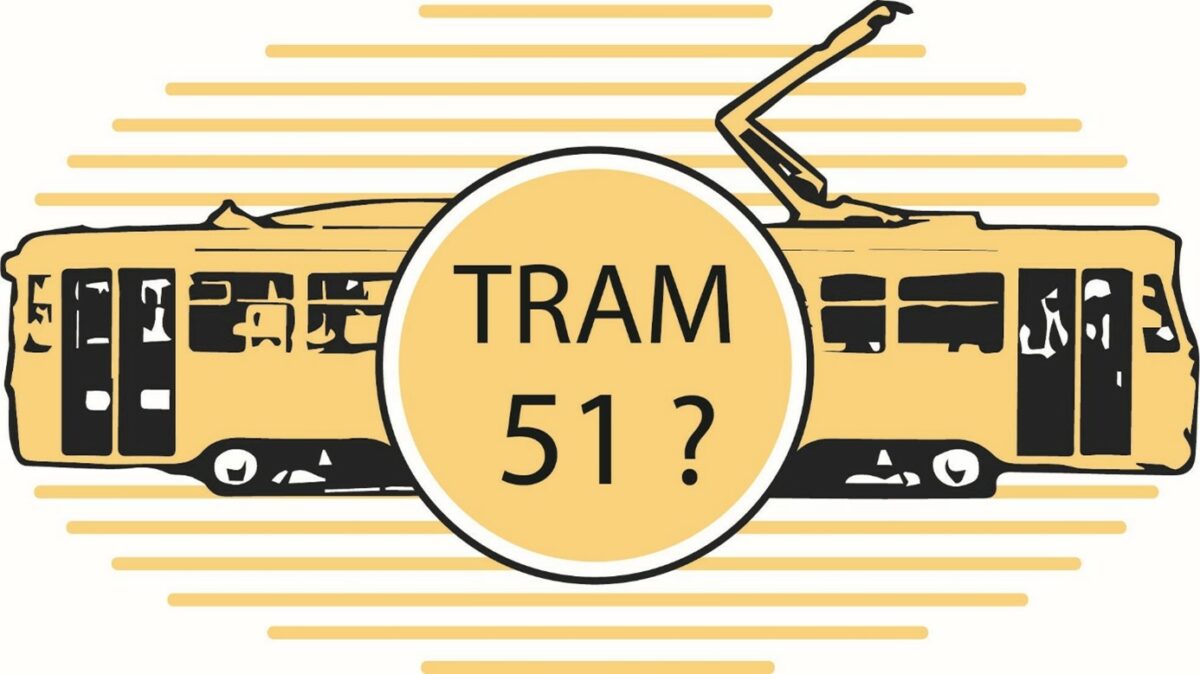
Nous vous invitons à trente visites découvertes de notre ville, réparties sur trente-cinq dates, tout au long des week-ends de mai à novembre.
Entre nos incontournables, comme « Les métiers et matériaux de l’Art nouveau », et nos nouveautés, telles que « La ceinture ferroviaire ouest de Bruxelles » ou « Quaker House », vous n’aurez que l’embarras du choix pour explorer encore et toujours Bruxelles.
MAI
Dimanche 11 mai : LA COLLÉGIALE DES SAINTS-MICHEL-ET-GUDULE
Samedi 17 mai : LES BIÈRES BRUXELLOISES
Dimanche 18 mai: LES PAVÉS DE BRUXELLES
Samedi 24 mai : LA FONDERIE : LA COMPAGNIE DES BRONZES ET L’EXPOSITION MADE IN BRUSSELS
Dimanche 25 mai : LE CIMETIÈRE DE BRUXELLES
Samedi 31 mai: LES MÉTIERS ET MATÉRIAUX DE L’ART NOUVEAU
JUIN
Dimanche 01 juin: LE PETIT SABLON ET SES 48 MÉTIERS
Samedi 7 juin: TOUR & TAXIS, UN PATRIMOINE DE CLASSE MONDIALE
Samedi 14 juin: MOLENBEEK PETIT MANCHESTER
Dimanche 22 juin: LA CEINTURE FERROVIAIRE EST DE BRUXELLES
Samedi 28 juin : LE PASSÉ INDUSTRIEL DU QUARTIER DE LINTHOUT
Dimanche 29 juin: BRUXELLES EST AINSI FÊTE …
JUILLET
Samedi 5 juillet : L’ART NOUVEAU DANS LE PENTAGONE
Dimanche 6 juillet : LE CIMETIÈRE DE MOLENBEEK
Samedi 12 juillet: BOIRE ET MANGER
Dimanche 13 juillet: L’HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL À MOLENBEEK
Samedi 19 juillet: LES BOULEVARDS OUVRIERS
AOÛT
Samedi 16 août : TOUR & TAXIS, UN PATRIMOINE DE CLASSE MONDIALE
Dimanche 17 août : LA JONCTION NORD-MIDI
Dimanche 24 août : LES MÉTIERS ET MATÉRIAUX DE L’ART NOUVEAU
Samedi 30 août: ET ON CRÉA LA CITÉ-JARDIN [Nouveauté !]
Dimanche 31 août : DE LA SOIF AU SOULAGEMENT
SEPTEMBRE
Samedi 06 septembre: LE QUARTIER DES FABRIQUES
Dimanche 07 septembre: LE CIMETIÈRE D’IXELLES
Samedi 13 septembre: SCHAERBEEK INDUSTRIEL
Dimanche 14 septembre: LA CEINTURE FERROVIAIRE OUEST DE BRUXELLES [Nouveauté !]
Samedi 27 septembre: MOLENBEEK PETIT MANCHESTER
OCTOBRE
Samedi 04 octobre: LA FONDERIE
Dimanche 05 octobre: SUR LA ROUTE DE LA LAINE
Samedi 11 octobre: ENTRE INDUSTRIE ET NATURE : SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHEMIN DE FER
Dimanche 19 octobre: LA “HALTE CENTRALE” DE LA JONCTION NORD-MIDI – reporté au dimanche 16 novembre
Samedi 25 octobre: DE L’USINE DE GODIN AU CENTRE DOCKS
Dimanche 26 octobre: LES BOULEVARDS OUVRIERS
NOVEMBRE
Samedi 01 novembre : QUAKER HOUSE [Nouveauté !]
Dimanche 09 novembre: L’ÉGLISE DE SAINT JOSSE
Dimanche 16 novembre: LA “HALTE CENTRALE” DE LA JONCTION NORD-MIDI – nouvelle date
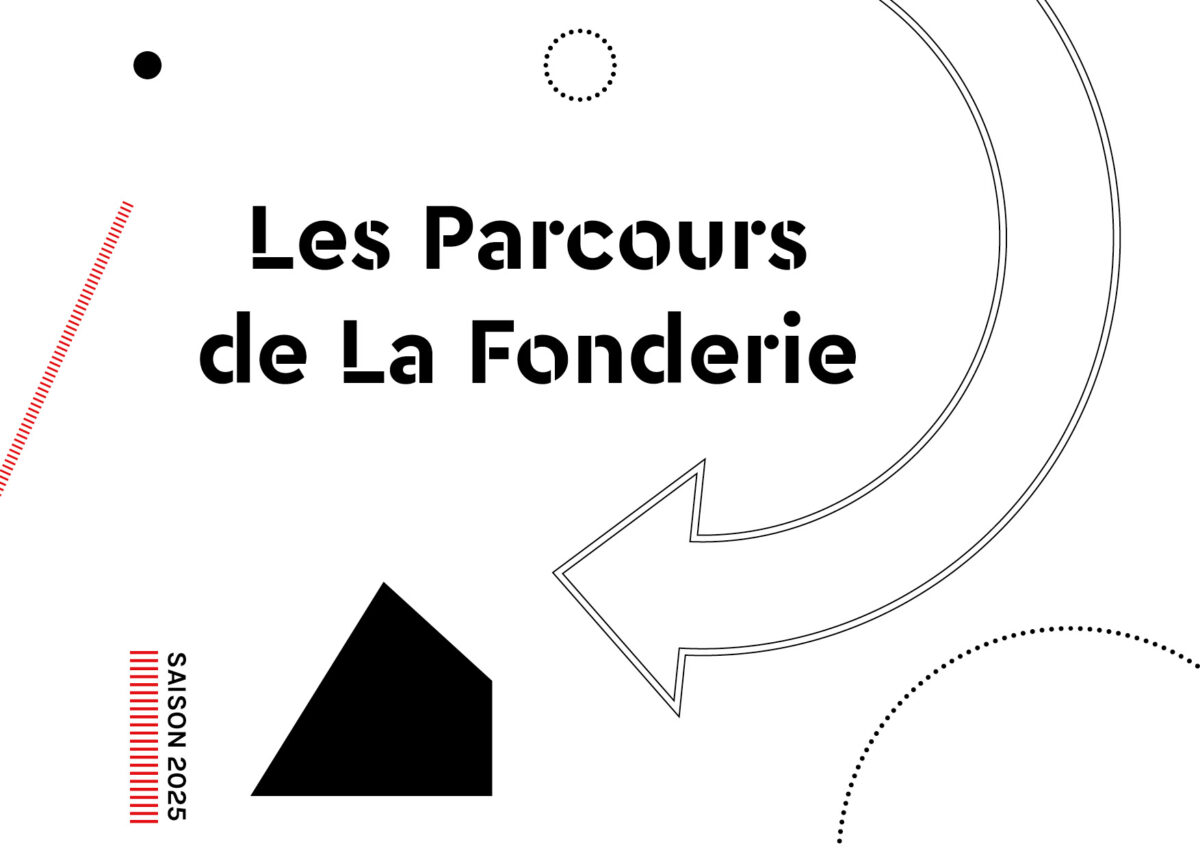
LIVREURS CYCLISTES : EXPLOITATION SANS LIMITE ?
Nous les voyons évoluer dans nos villes depuis une dizaine d’années avec leur sac à dos portant le logo des entreprises multinationales de livraison. Depuis leur apparition, ils font régulièrement la une des journaux, en raison de leurs conditions de travail extrêmement précaires, de leurs grèves, ou encore des procès intentés contre les multinationales qui les emploient.
Ces entreprises, dites de plateformes – car l’organisation du travail y passe essentiellement par des plateformes en ligne – prônent et appliquent un modèle de travail totalement dérégulé, jusqu’à nier être les employeurs des travailleur·euses réalisant les tâches qu’elles distribuent. Malgré des positionnements clairs de diverses instances administratives et surtout des procès gagnés en justice (affirmant qu’un statut de salarié doit être appliqué à ces travailleurs), jusqu’à aujourd’hui rien ne change : leur exploitation semble s’étendre sans limite, y compris judiciaire !
Qu’est-ce qui se cache derrière cette activité ? Sous quels « statuts » travaillent actuellement les livreurs ? Quels sont les risques que les modèles appliqués par ces entreprises font peser sur l’entièreté du monde du travail en Belgique ? Quelles sont les attitudes des autorités politiques face à ces activités en partie illégales ?
Nous ferons le point sur ces questions avec :
Les rendez-vous-débats ont lieu tous les troisièmes mardis du mois chez Zot, la cantine associative de La Fonderie. Un petit bar y est ouvert et il est possible de réserver un sandwich. Chaque séance fait, par ailleurs, l’objet d’un podcast particulier sur Radio Campus, dans l’émission Micro Ouvert.
Documentation : Deliveroo, exploitation sans limite

Sur le site d’une ancienne fonderie d’art qu’elle occupe depuis 1983, La Fonderie est un lieu particulier où l’on apprend, observe, contemple, expérimente, débat, échange, imagine… On y flâne aussi, dans un décor inattendu au creux de la densité urbaine. À la lisière du Pentagone bruxellois et à deux pas du canal, un peu cachée dans les rues du Vieux Molenbeek industriel, La Fonderie-Musée bruxellois des industries et du travail raconte Bruxelles et ses habitants, la ville au travail et au quotidien. Ses actions s’inspirent des patrimoines architecturaux et historiques bruxellois qu’elle met en perspective avec les enjeux humains, sociaux, économiques et urbains actuels.

Au programme jusqu’à la fin de l’année : explorer l’histoire industrielle et sociale de Bruxelles et sa réalité actuelle, expérimenter des pratiques et savoir-faire artistiques et artisanaux, découvrir des créations inspirées par la ville et le travail, participer aux dynamiques culturelles du quartier, s’informer et débattre de droits et de justice sociale, faire la fête aussi…
Et comme à La Fonderie on aime accueillir et déguster, dès le 1er mai s’y ouvre Zot, un café-cantine solidaire, à vocation socio-culturelle et durable. Zot propose une cuisine maison, des ateliers participatifs, des rencontres chaleureuses, des moments festifs.
11.05 — 09.11
SAISON DES PARCOURS DE LA FONDERIE
35 visites guidées en ville sur les traces de l’histoire économique et sociale bruxelloise
JEUDI 1er MAI
FÊTE DU TRAVAIL LANCEMENT DE LA SAISON ET DE ZOT – LA CANTINE ASSOCIATIVE DE LA FONDERIE
SAMEDI 03.05
FÊTE DE L’IRIS avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek
MARDI 20.05 ET MARDI 17.06
SANDWICH-CLUB DU MARDI À LA FONDERIE : LES DEUX DERNIERS DÉBATS avec Lire et Écrire Bruxelles et le CSCE (Collectif Solidarité contre l’Exclusion)
12:15 — 13 :45 Deux heures conviviales sur le temps de midi, un sujet de société souvent brûlant, deux invité·es passionnant·es, un débat avec la salle, un sandwich, un café et, plus tard, une retranscription radiophonique sur Radio Campus dans l’émission “Micro ouvert” !
JEUDI 22.05 ET VENDREDI 23.05
AUBERGES EN SCÈNE
JEUDI 05.06 — 18h30
ENQUÊTE SONORE / DOCUMENTAIRE RADIOPHONIQUE “DIFFICILE À AVALER” DE COLIN HORENBEEK ET DIMITRI MERCHIE – écoute et discussion en présence des auteurs et de témoins
Une usine qui disparaît, ça laisse des traces… Les récits d’ouvriers des Forges de Clabecq font écho à la nostalgie d’une époque marquante et à l’histoire d’une lutte inachevée. Depuis 30 ans, “Ceux de Clabecq” attendent des réparations
MARDI 10.06 — 18h30
WORK-IN-PROGRESS FILM THE GLOWING PART OF YOURSELF DE DIEGO THIELEMANS avec le centre de documentation de La Fonderie et l’Atelier Graphoui – projection et présentation
Le film racontera l’histoire de Bruxelles et du marais sur lequel la ville est bâtie en déployant des images d’archives animées de végétaux. La soirée est une halte dans sa création pour partager les documents découverts, projeter les premières images, discuter des prochaines étapes, échanger.
18.06 — 22.06
FESTIVAL DE LA FÊTE DE L’ÉLÉPHANT
Pour la 3e fois, le collectif d’habitant·es de la Fête de l’Éléphant et leurs partenaires organisent un festival artistique, culturel et participatif dans le Parc de La Fonderie, voisin du musée de La Fonderie. C’est l’occasion d’ouvrir les grilles entre les deux sites, tous deux anciennement industriels
21.06 — 29.06
L’ACADÉMIE DES ARTS DE MOLENBEEK
Exposition de fin de cycle des étudiants en sculpture de l’atelier d’Alexis Remacle
21.06 — 29.06
L’ÉCOLE 10, DÉCOUVERTE DU QUARTIER
Petite exposition par les enfants dans le cadre d’un projet PECA réalisé à La Fonderie
DE JUILLET À SEPTEMBRE
LA SAISON DES STAGES D’ART ET D’ARTISANAT À LA FONDERIE
SAMEDIS 24.05 ET 04.10
VISITES GUIDÉES DU SITE ET DU MUSÉE DE LA FONDERIE
DIMANCHE 21.09
HERITAGE DAYS, ART DÉCO, ANNÉES FOLLES, ANNÉES KRACH
Déposez-moi ce modèle – Et si on parlait aussi des arts industriels des années Art Déco ? La Fonderie sort de ses réserves plusieurs registres et recueils officiels de marques et de modèles déposés au cours des années 1920 par des créateurs industriels au Conseil des Prud’hommes. À partir de ce corpus d’images graphiques et publicitaires, La Fonderie propose un double atelier de sérigraphie et d’emballage pour modèles à déposer. Standing Guide dans le musée, focus Art Déco. 3 parcours en ville : Les cités-jardins de Diongre et de Saulnier, La “Halte Centrale” de la jonction Nord-Midi et Molenbeek-Saint-Jean, entre art et industrie
16.10.25 — 28.06.26
BELDAVIA, VOTRE NOUVELLE TERRE D’ACCUEIL !
Dictature, chômage ou regroupement familial…, qu’importe la raison, vous devez quitter la Belgique ! Heureusement, la BELDAVIE vous accueille à bras ouverts. Entrez au coeur de ce royaume absurde, imaginaire et déroutant où langue et culture vous échappent. Une expoaction immersive et ludique co-créée avec des apprenant·es en alphabétisation.
Télécharger le programme > ici

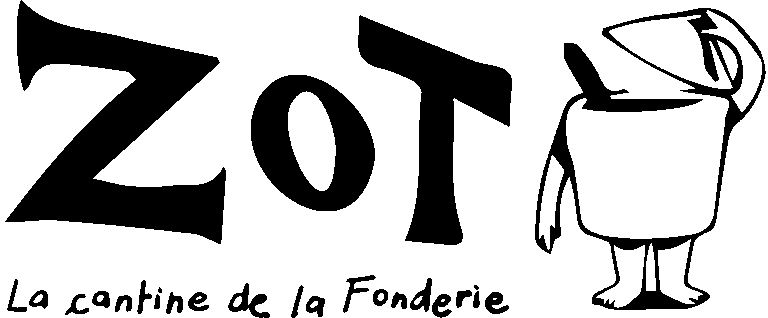
Le projet a été fondé par Zottepiste, une ASBL née de la rencontre entre personnes en quête d’un lieu porteur de sens, où elles pourraient travailler dans le respect des autres et de l’environnement. Pourquoi Zottepiste ? Parce qu’ils sont utopistes et un peu foufous, un peu zot quoi !
Derrière ce joyeux nom se cache une volonté de faire exister un modèle de société différent, plus solidaire et plus juste en créant un lieu où l’accessibilité à une nourriture saine, généreuse et savoureuse serait un droit commun fourni par les collectivités.

La cantine ZOT est un endroit où on mange de bons repas à petit prix, dans une ambiance conviviale ! Ici, tout le monde est bienvenu. Il y aura de quoi manger et boire, et surtout, un espace où on peut se retrouver, discuter et passer un moment ensemble.
Au-delà de la restauration, ZOT propose une programmation culturelle désireuse de faire vivre le quartier du canal et soucieuse de partager les valeurs de La Fonderie.
Un petit coup de pouce serait plus que bienvenu pour les aider dans leur installation et permettre à cette belle initiative de prendre vie sur notre site ! Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez contribuer à leur campagne de financement par ici.
Pour en savoir plus sur leur projet et suivre leurs actualités :



Le 1er mai, c’est la Fête du Travail, c’est le renouveau, c’est le mois du muguet… et c’est un jour particulier pour nous à La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail.
Il fait écho à l’histoire de l’ancienne fonderie de la Compagnie des Bronzes dont nous occupons le site et où parfois… résonnent encore les voix des ouvriers, portées par la mémoire des gestes et des machines. Il fait aussi écho aux actions de La Fonderie pour la défense de la mémoire ouvrière et pour la préservation des patrimoines industriel et social bruxellois, ainsi qu’à son engagement dans les luttes urbaines du siècle passé. Au fond, là aussi, des luttes résonnent, encore et toujours…
Et puis, c’est le jour où nous fêtons joyeusement avec vous le lancement de notre programmation, avec cette année le moment tant attendu de l’ouverture de Zot, la nouvelle cantine associative de La Fonderie.
Pour fêter dignement le démarrage de ces nouvelles aventures, la journée sera conviviale, créative, culturelle et gourmande. Dès 10h, la cantine Zot sera ouverte. En début d’après-midi, des ateliers pour les familles et autres groupes commenceront. Il y aura aussi des jeux en extérieur, un peu de cirque, de la musique et des discussions… Vous pourrez réparer ou briquer vos vélos auprès de professionnels avant de vous embarquer en petites boucles vers le patrimoine du petit Manchester. Et vous terminerez la journée avec un podcast inédit et interpellant suivi d’un concert singulier et détonnant.
AU PROGRAMME
10:00 — 22:00 la cantine Zot est ouverte en continu !

Ce samedi 3 mai, pour marquer le 36ᵉ anniversaire de la Région bruxelloise, la Fête de l’Iris débarque à Molenbeek-Saint-Jean !

C’est le moment de (re)découvrir notre commune sous d’autres regards, à travers un bouquet de visites guidées gratuites organisées par la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de Molenbeek et différents partenaires.
La Fonderie est ravie de proposer pour l’occasion deux parcours guidés extraits de son vaste catalogue:
Et ce n’est pas tout !
De 14h00 à 17h00, c’est à La Fonderie que se tiendra le point d’information molenbeekois de la Fête de l’Iris.
Et comme c’est la fête, notre musée ouvrira ses portes gratuitement à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent découvrir l’histoire économique et sociale de Bruxelles en compagnie d’un guide passionné et passionnant.
En famille ou avec des amis, prenez aussi le temps de profiter des jeux géants répartis dans les différents coins de nos jardins.
Et pour mieux connaître notre quartier, n’hésitez pas à passer chez nos voisins du Café de La Rue (rue de la Colonne 30) ouvert exceptionnellement de 12h à 17h. Dans cet ancien estaminet des années trente conservé dans son ambiance originelle, Marie-Noëlle vous racontera avec plaisir et émotion le rôle que ce lieu a joué dans l’histoire, le développement et l’évolution du Vieux Molenbeek… et de La Fonderie.
Et ce n’est pas encore tout !
Dès 17h00, la musique inondera l’espace de l’ancienne halle de coulée sur notre site.
De 17h00 à 20h00 : concert acoustique au rythme de la musique balkanique, avec Nicolas et Concert Balkan Orchestra.
De 20h00 à ….
Enfin, les gourmands ne seront pas oubliés… Pour assouvir vos petites soifs ou grandes faims, passez par notre nouvelle cantine associative ZOT !
Plus d’informations et programme de la journée ici

En été, plus encore qu’aux autres saisons, La Fonderie est un lieu singulièrement unique, un havre vert où l’on expérimente, on contemple et on déambule. On explore. Les enfants aussi !

Juillet
08.07 — 10.07 Tissage et crochet, avec Elisa Maudoux et Aurore Brun (Robin Hook)
08.07 — 10.07 Relief en bronze (coulée le 3e jour), avec Françoise Gutman
08.07 — 10.07 Des collections, un musée, des histoires, avec Aurélia Pfend
07.07 — 11.07 Découverte et fabrication d’instruments de musique, avec les Jeunesses musicales de Bruxelles [enfants]
12.07 — 13.07 Bleu de travail. De l’usine au magazine de mode, avec Aurore Brun (Robin Hook) [enfants et (grands)-parents]
14.07 — 18.07 Mini Architectures, avec Made in Kit [enfants]
15.07 — 17.07 Tissage artisanal et design textile, avec Elisa Maudoux
Août et septembre
18.08 — 22.08 Gravure, avec Zinaïda Tchelidze (COMPLET)
19.08 — 21.08 Petit volume en bronze (coulée le 3e jour), avec Françoise Gutman (il reste une place !)
23.08 — 24.08 Tissage, vannerie et broderie au lin, avec Lieza Dessein (COMPLET)
23.08 — 24.08 Création de bijoux, avec Sandrine Liégeois et Juliette Capron
26.08 — 29.08 Techniques d’impressions manuelles, avec Made in Kit
26.08 — 28.08 Couture à la machine et à la main, avec Caroline Hélain
30.08 — 31.08 Broderie et passementerie, avec Luisa Laranjo et Ana Silva (COMPLET)
30.08 — 31.08 et 07.09 Sculpture sur pierre, avec David Natidze (COMPLET)
07.09 Moule et “brut de coulée” en bronze, avec Françoise Gutman
26.09 — 27.09 Création de bijoux, avec Sandrine Liégeois et Juliette Capron
28.09 Moule et “brut de coulée” en bronze, avec Françoise Gutman

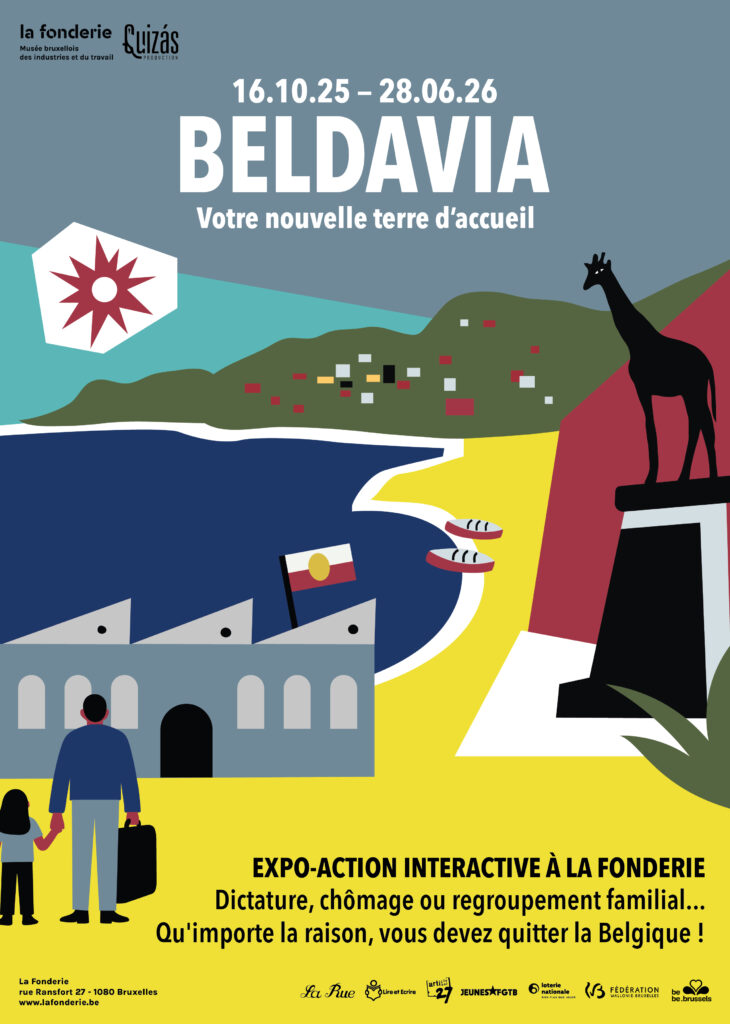
Dictature, chômage ou regroupement familial, qu’importe la raison, vous devez quitter la Belgique ! Heureusement, un pays vous accueille à bras ouverts : la BELDAVIA, un état organisé et absurde à la fois dont vous ne comprenez ni la langue, ni la culture.
Votre objectif sera d’obtenir un précieux permis de séjour et un logement décent en réussissant une série d’épreuves dans un décor original et une ambiance visuelle et sonore inédite… Vous passerez par de nombreuses émotions, de l’espoir au désarroi, de la honte à la joie…


À votre arrivée, vous recevrez une identité fictive : exilé·e pour raison économique, réfugié·e politique ou migrant.e dans le cadre d’un regroupement familial. Dans ce rôle, vous traverserez une série de pièces et vivrez le parcours d’un migrant à la recherche d’un logement décent et abordable. Vous devrez circuler, observer, essayer de raisonner dans un environnement déroutant et décalé, faire des choix via une carte d’accès munie d’une puce électronique et interagir avec divers supports numériques et physiques.
Beldavia est une expo-action produite par Quizas ASBL, créée avec des apprenant·es en alphabétisation de l’ASBL La Rue et présentée en collaboration avec La Fonderie. Elle est inspirée d’expériences réelles vécues par des personnes issues de la migration venues s’installer en Belgique.
> En savoir plus sur la création de l’exposition

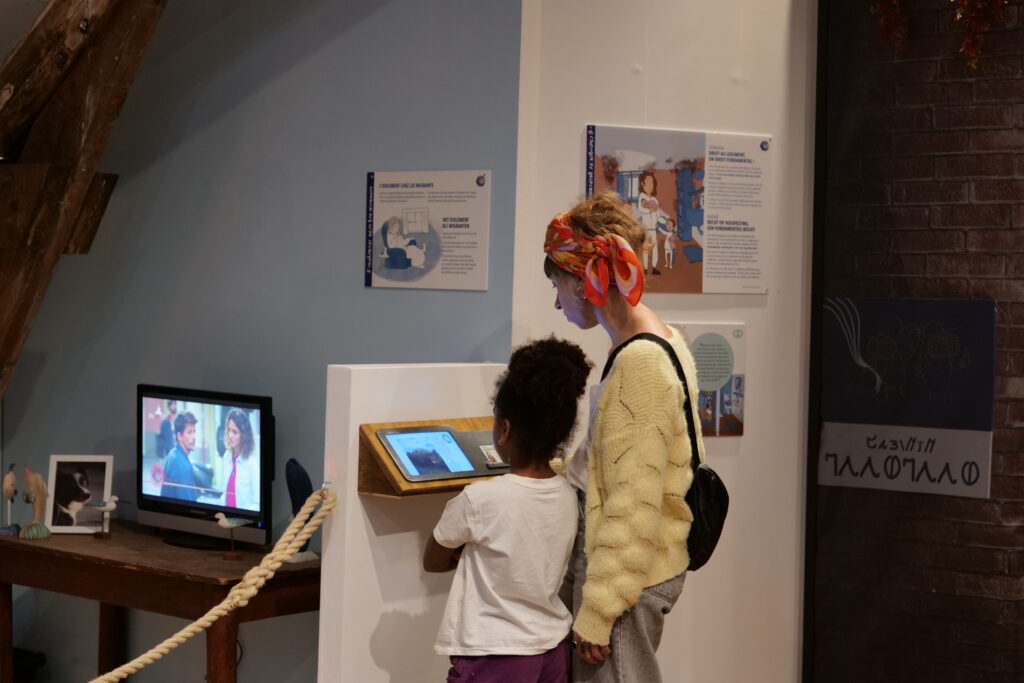
L’exposition Beldavia est un outil de sensibilisation et de réflexion critique particulièrement adapté aux élèves du secondaire puisqu’il résonne avec les programmes scolaires de la 1ère à la 6e année.
L’exposition constitue un outil pédagogique transversal qui permet de travailler de manière concrète, critique et participative sur des thématiques essentielles telles que la migration, le droit au logement, l’inclusion sociale et l’engagement citoyen…, à travers différentes matières (sciences sociales, histoire – géographie, étude du milieu, morale et citoyenneté, religion, français, arts plastiques…).
FAMILLES – AMI·ES – SOLO
SORTIES SCOLAIRES
ASSOCIATIONS (Alpha, assistant·es sociaux, etc.)
TEAM BUILDING

Cette technique particulière de création bijoutière à partir d’argile de cuivre ou d’argent, tout en nécessitant patience et habileté, permet à chacun.e de déployer sa créativité pour réaliser un bijou à la fois inventif et personnel. Après une première aventure étonnante l’année dernière, on réitère l’expérience cette année. Au fil des deux jours, les différentes étapes de confection du bijou, de la conception au polissage, seront explorées. Chacun.e sera amené.e à concevoir son prototype puis à modeler ou mouler, texturer, sécher, poncer, cuire, brosser et polir bague, pendentif ou médaillon, dans une atmosphère conviviale.
L’argile métallique est une pâte constituée de particules de cuivre ou d’argent, amalgamées par un liant non toxique. Elle se travaille comme l’argile et, à la cuisson, le liant brûle pour laisser une pièce en cuivre ou en argent véritable. La cuisson est une opération délicate, le risque que les pièces soient endommagées ne peut être totalement exclu.
Les animatrices
Sandrine Liégeois est artiste plasticienne. Elle a cheminé à travers différentes académies, dans des ateliers de peinture, de dessin, de céramique et de techniques pluridisciplinaires. Juliette Capron est assistante sociale, créative et passionnée par l’humain. Ensemble, elles animent des activités créatives au sein de plannings familiaux et dans un atelier situé à Walhain.
| RÉSERVER |

Vous avez réalisé un modèle de fonderie en plâtre, en bois, en plastique ou dans un autre matériau et vous souhaitez le couler en bronze ? Au cours d’une journée, vous avez l’opportunité de réaliser votre moule en sable et d’y couler votre « brut de coulée ». Selon le temps restant après la coulée, vous pourrez envisager la ciselure et la patine de votre objet.
Chaque participant réalise un (seul) moule à partir d’un ou plusieurs châssis. La Fonderie met à votre disposition deux formats de châssis :
– rectangulaire L :40/ l :20/ h :5 cm (pour un bas-relief)
– circulaire D : 15/ h :5 cm (pour un volume plein).
Pour comprendre les possibilités et les contraintes de cette technique, référez-vous au vadémécum du stagiaire pour le bas-relief ou le vadémécum pour le volume plein.
L’animatrice
Françoise Gutman est sculpteuse et céramiste, formée à l’école du 75 et à l’école supérieure des arts plastiques de l’Etat à Mons. Depuis de nombreuses années, elle participe régulièrement à des expositions collectives et personnelles, en Belgique et à l’étranger. Elle est aussi une précieuse animatrice plasticienne attachée aux services éducatifs de plusieurs institutions muséales. Depuis bientôt 10 ans, elle accompagne nos projets qui intègrent la fonte du métal.
| RÉSERVER |

Vous avez réalisé un modèle de fonderie en plâtre, en bois, en plastique ou dans un autre matériau et vous souhaitez le couler en bronze ? Au cours d’une journée, vous avez l’opportunité de réaliser votre moule en sable et d’y couler votre « brut de coulée ». Selon le temps restant après la coulée, vous pourrez envisager la ciselure et la patine de votre objet.
Chaque participant réalise un (seul) moule à partir d’un ou plusieurs châssis. La Fonderie met à votre disposition deux formats de châssis :
– rectangulaire L :40/ l :20/ h :5 cm (pour un bas-relief)
– circulaire D : 15/ h :5 cm (pour un volume plein).
Pour comprendre les possibilités et les contraintes de cette technique, référez-vous au vadémécum du stagiaire pour le bas-relief ou le vadémécum pour le volume plein.
L’animatrice
Françoise Gutman est sculpteuse et céramiste, formée à l’école du 75 et à l’école supérieure des arts plastiques de l’Etat à Mons. Depuis de nombreuses années, elle participe régulièrement à des expositions collectives et personnelles, en Belgique et à l’étranger. Elle est aussi une précieuse animatrice plasticienne attachée aux services éducatifs de plusieurs institutions muséales. Depuis bientôt 10 ans, elle accompagne nos projets qui intègrent la fonte du métal.
| RÉSERVER |

Un coup de chasse percutée à la massette pour dégrossir la pierre… Bauw, bauw, bauw Un pic pour aplanir sa face … clic clic clic clic Un ciseau pour tailler les évidements, les moulures… Wizzzz wizzzz wizzzz wizzzzzzzzz Une gouge pour révéler la délicatesse d’un drapé ou d’une boucle de pierre…. Chssssi chssssi chsssssiiiii ……. Et bien d’autres gestes, d’autre outils, d’autres sonorités pour apprivoiser le langage des pierres et perfectionner celui de Shakespeare !
Une expérience unique à vivre en plein-air sur le site de l’ancienne fonderie d’art avec David Natidze : un artiste à la fois sensible et rigoureux qui, au-delà de sa création personnelle, collabore fréquemment à des chantiers de restauration tels que celui des statues de la Grand-Place ou de la Cathédrale Saint-Michel et Gudule à Bruxelles. Ce stage s’adresse aussi bien aux débutant.es qu’aux personnes expérimentées. Il est conçu pour que chacun.e reçoive une attention et des commentaires personnalisés, tout en abordant les principes fondamentaux de la sculpture et l’utilisation de divers outils, techniques et matériaux. Chacun.e partira d’un bloc de calcaire tendre pour réaliser son projet. La longue et double expérience de David Natidze en tant que sculpteur et comme restaurateur garantit un apprentissage technique rigoureux tout en favorisant l’expressivité de chacun.e.
L’anglais sera la langue de communication principale durant le stage
L’animateur
David Natidze a grandi à Tbilisi en Géorgie. Après avoir obtenu son diplôme de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts, il s’installe en Belgique où il poursuit sa formation de sculpteur à l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers. Dès 1996, il participe à la rénovation des statues de la gare de Louvain. Depuis, il a enchainé les grands chantiers de restauration à Bruxelles et en Flandre. On le croise régulièrement dans des symposiums et expositions d’art, collectives et personnelles. Ses sculptures sont des représentations d’objets et de formes tirées de son environnement personnel dont, par-delà les formes, il interroge les sentiments, les sensations, les sous-entendus et les arrière-pensées.
| RÉSERVER |
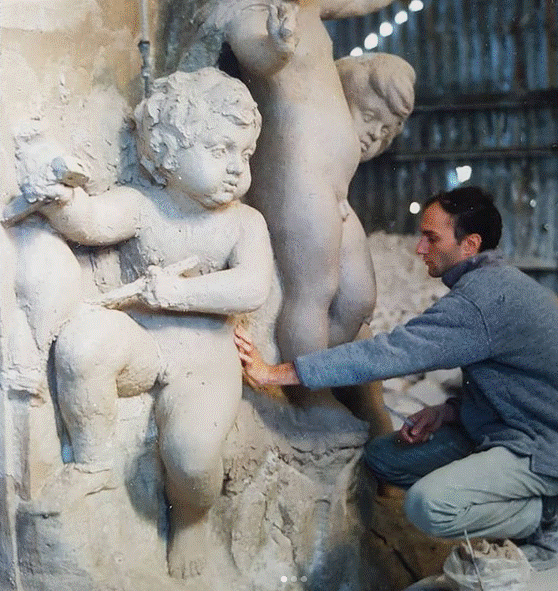
Depuis le mois d’avril, Lieza Dessein cultive une parcelle de lin à La Fonderie, dans le cadre dans le cadre du “linen project” développé par le musée du Textile de Courtrai. Cette exploration des aléas de la culture du lin ravive l’histoire oubliée de son exploitation surtout pour ses fibres pour la production textile aux 19e et 20e siècle aux Pays-Bas, en Belgique et en France. C’est également l’opportunité de proposer deux jours de création artistique autour du lin et d’autres fibres naturelles simples en explorant des techniques telles que la vannerie, la broderie et le tissage. Vous y explorerez notamment une technique de vannerie en spirale. Cet atelier convivial et accessible s’adresse tant aux personnes débutantes qu’à celles plus expérimentées. Chacun.e repart avec ses productions et les connaissances techniques suffisantes pour poursuivre son travail créatif chez soi.
L’animatrice
Lieza Dessein réinvestit des techniques artisanales historiquement genrées en les détournant de leurs origines domestiques et décoratives. Son travail oscille entre la minutie du fait main et l’expérimentation numérique, révélant la complexité et la résilience de ces pratiques dites de culture « mineure ». En traduisant des formes ornementales en gestes sculpturaux, elle interroge la manière dont l’artisanat peut dépasser ses limites historiques et revendiquer une place dans l’art contemporain. Sa pratique rend hommage aux histoires invisibles du travail des femmes, en positionnant les arts décoratifs comme des vecteurs essentiels de mémoire et d’identité culturelle.
| RÉSERVER |

Deux journées particulières qui célèbrent le patrimoine à travers des travaux d’aiguille. Un premier jour pour s’immerger dans le monde diversifié des techniques de broderie. De dessins simples en motifs intemporels, cet atelier croise l’apprentissage de points et gestes et la beauté des savoir-faire transmis de génération en génération. On y explore comment, grâce à la broderie, réparer, upcycler, rehausser et singulariser nos textiles ; chaque point contribuant à la réutilisation et au renouvellement du tissu ! Un autre jour pour découvrir l’art de la passementerie éco-responsable. Vous feriez bien quelques cordons, tresses ou franges ? A moins que vous préfèreriez confectionner l’un ou l’autre feston, ruban ou pompons. Pas plus de 30 cm à chaque fois mais quelques centimètres qui peuvent rendre à jamais vos vêtements ou vos tissus d’ameublement absolument uniques ! Un voyage à la fois fantaisiste, pratique et familier, où la créativité rencontre le savoir-faire artisanal et se conjugue à la durabilité.
Les animatrices
Artiste textile d’origine portugaise, Luisa Laranjo vit actuellement en Belgique. Son parcours artistique allie maîtrise autodidacte et formation formelle acquise à la Royal School of Needlework. Ses créations embrassent tendrement la fragilité des imperfections humaines trouvant la beauté dans les détails délicats, insolites ou inattendus. Luisa anime de nombreux ateliers où elle allie savoir-faire artisanaux et modernité en recourant à des matériaux recyclés.
Ana Silva – Atelier Chic & Tchack – est formée en psychologie et anime des ateliers couture, crochet et macramé depuis 2018. Au-delà̀ de l’apprentissage des techniques, c’est la rencontre, la convivialité́ et la solidarité́ ainsi que le respect du rythme de chacun.e qui importent. Chic & Tchack développe, en outre, une philosophie de réutilisation, de recyclage, de réparation et de réduction des déchets.
| RÉSERVER |

Vous aimez raccommoder, ravauder ou rapiécer vos textiles, en maniant l’aiguille et le fil à la main ? Vous avez toujours rêvé manipuler avec adresse et efficacité la canette, le volant ou le releveur de fil sans savoir comment se confronter à la machine : ce stage est pour vous ! Cette année, l’atelier prend particulièrement le chemin des réparations, des transformations, des customisations qui rajeunissent d’anciens textiles. Apportez donc vos tissus inutilisés ou vos vêtements et accessoires à réparer. Tous les points sont permis ! Qu’ils soient droits, invisibles ou en zig zag, ne passez pas à côté du chas de l’aiguille et venez donc revigorer vos vêtements ou créer ces petites confections qui vous manquent : poches et pochettes en tout genre, manches, doublures et autres inventions.
L’animatrice
A la fois plasticienne, dessinatrice et brodeuse, Caroline Hélain reçoit dans son atelier depuis plus de vingt ans, enfants et adultes pour des sessions de dessin, broderie ou couture.
| RÉSERVER |
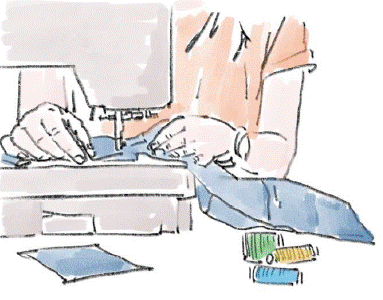
Nous partirons d’une exploration sensible, graphique et poétique de la collection de la Fonderie, ses machines et ses objets, ses cartes et ses mécanismes, afin d’identifier ce qui nous inspire et nous touche. Nous jouerons ensuite à en extraire des images pour les déployer à travers trois techniques d’impression : la gravure sur gomme, la gravure sur tetrapak et le cyanotype. L’imagination et la créativité des participant.es sont conviés ! Quatre jours graphiques entre images et imaginaires du musée, au bout desquels chacun.e repart avec ses productions et les connaissances techniques suffisantes pour reproduire les procédés d’impression chez soi.
La gravure sur gomme permet de créer des tampons. L’encrage et les impressions multiples permettent de jouer avec subtilité de ce médium facile d’accès.
La gravure sur tetrapak est une technique de gravure en taille douce qui permet de travailler les détails et de réaliser des impressions délicates.
Le cyanoptype est un procédé photographique ancien grâce auquel on obtient des images en négatif bleu de Prusse. Cette technique initie au procédé « magique » de la photographie et offre un résultat immédiat.
L’animatrice et l’animateur
Anaïs Caillat et Mathieu Lauwers de l’asbl Made in Kit
MADE iN KiT est un espace de création bruxellois basé sur le graphisme participatif et le do-it-yourself. On y amène ses rêves, ses projets, ses envies, sa créativité, ses compétences. On y trouve, pour leur donner forme, une grande boite à outils dans laquelle on puise la formule la plus adaptée à ses besoins : des stages et animations pour petits et grands qui explorent de façon ludique des techniques de création liées au papier et des formations sur des questions techniques ou artistiques, de conception ou de production. Et puis d’autres choses encore, graphiques ou scénographiques, à la demande ou juste par plaisir.
| RÉSERVER |

Cette technique particulière de création bijoutière à partir d’argile de cuivre ou d’argent, tout en nécessitant patience et habileté, permet à chacun.e de déployer sa créativité pour réaliser un bijou à la fois inventif et personnel. Après une première aventure étonnante l’année dernière, on réitère l’expérience cette année. Au fil des deux jours, les différentes étapes de confection du bijou, de la conception au polissage, seront explorées. Chacun.e sera amené.e à concevoir son prototype puis à modeler ou mouler, texturer, sécher, poncer, cuire, brosser et polir bague, pendentif ou médaillon, dans une atmosphère conviviale.
L’argile métallique est une pâte constituée de particules de cuivre ou d’argent, amalgamées par un liant non toxique. Elle se travaille comme l’argile et, à la cuisson, le liant brûle pour laisser une pièce en cuivre ou en argent véritable. La cuisson est une opération délicate, le risque que les pièces soient endommagées ne peut être totalement exclu.
Les animatrices
Sandrine Liégeois est artiste plasticienne. Elle a cheminé à travers différentes académies, dans des ateliers de peinture, de dessin, de céramique et de techniques pluridisciplinaires. Juliette Capron est assistante sociale, créative et passionnée par l’humain. Ensemble, elles animent des activités créatives au sein de plannings familiaux et dans un atelier situé à Walhain.
| RÉSERVER |

Entre les murs de l’ancienne halle de coulée, il s’agit d’une invitation à expérimenter les différentes étapes de la fonte au sable, une technique beaucoup utilisée par La Compagnie des Bronzes en ses années prestigieuses, et encore régulièrement dans certaines fonderies d’art actuelles. Chaque projet commence par l’esquisse et sa transposition en un modelage de terre. Ensuite, il faudra tirer parti de la malléabilité du sable pour réaliser un moulage à partir de l’empreinte d’un modèle en plâtre, lui-même réalisé à partir de l’empreinte du premier modelage en terre… Le stage permet d’explorer, en trois jours intenses, l’enchaînement des différentes phases du processus, à la fois artisanal et industriel, jusqu’au moule en sable apte à recevoir le bronze en fusion. La dernière après-midi sera consacrée au finissage de l’objet coulé, avec la ciselure et la patine.
L’animatrice
Françoise Gutman est sculpteuse et céramiste, formée à l’école du 75 et à l’école supérieure des arts plastiques de l’Etat à Mons. Depuis de nombreuses années, elle participe régulièrement à des expositions collectives et personnelles, en Belgique et à l’étranger. Elle est aussi une précieuse animatrice plasticienne attachée aux services éducatifs de plusieurs institutions muséales. Depuis bientôt 10 ans, elle accompagne nos projets qui intègrent la fonte du métal.
| RÉSERVER |

Cet atelier propose d’explorer l’art très graphique de la gravure en enchevêtrant plusieurs pratiques d’impression. Nous commencerons avec la photocopieuse, afin de révéler de nouvelles perspectives d’une image, via l’agrandissement. Travaillée ensuite à la xylogravure, l’image prendra encore une autre apparence, une autre teneur. Le support de bois gravé sera ensuite soumis à la technique de l’estampe avec un transfert à l’encre de Chine sur papier de soie, manuellement. Enfin, grâce au marouflage, un jeu de fonds et de surfaces viendra encore donner de l’épaisseur à l’image. Au fil des quatre journées, l’image évoluera au rythme des gestes, passant par des procédés anciens et des techniques contemporaines.
L’animatrice
Zinaïda Tchelidze est une artiste et enseignante. Elle travaille principalement la sculpture et l’installation, en s’intéressant aux aspects performatifs de l’échange et du partage. Elle explore des gestes récurrents qu’elle tisse à travers ses installations pour interroger les contraintes spatiales, les notions de collectivité et d’isolement. Dans le cadre de sa pratique collaborative, elle travaille avec des artisans, des scientifiques et des artistes afin de tester les frontières entre créativité et (non)savoir.
| RÉSERVER |

Cette immersion dans le textile est l’opportunité de se familiariser avec les divers points et techniques de la tapisserie sur cadre. A partir de fils de toutes textures, de chutes de tissus et de vieux vêtements, chacun.e est amené.e à créer une nouvelle pièce originale, totalement personnalisée et 100% récup ! De fil en aiguille, nous explorerons le patrimoine matériel et les savoir-faire artisanaux lié au design textile d’hier et d’aujourd’hui : l’occasion d’approcher l’étonnante créativité déployée entre les fils de trame et de chaine, à l’aide d’exemples et d’expérimentations.
Vous avez un vêtement dont vous aimez la couleur ou les motifs mais que vous ne mettez plus car il est devenu trop petit, troué, abîmé ? Un foulard ou un tissu dont vous ne savez que faire ? Amenez-les, nous allons les transformer en matière première pour les intégrer dans un tissage que vous allez entièrement réaliser.
L’animatrice
Elisa Maudoux est designer textile. Elle est aussi co-fondatrice de l’ASBL Textilarium et professeure à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège en création textile. Le textile est son laboratoire de recherche, son lieu d’exploration, son champ de création…
| RÉSERVER |

En avant pour explorer le quartier de La Fonderie, s’en inspirer et créer ses propres constructions ! Les bâtiments industriels, les abords et les bords du canal, les rues et les jardins, les parcs et les places seront le terrain d’observation d’une bande de joyeux constructeurs. Ensuite, en assemblant des blocs de lego, en crayonnant ou composant avec du carton ; ils joueront avec les formes, les couleurs et les matériaux pour imaginer une ribambelle d’édifices, de fabriques et d’abris étonnants. Nous rencontrerons quelques grands architectes, découvrirons leurs univers, et à notre tour, nous inventerons des projets fous : des maisons faites uniquement de fenêtres avec des forêts sur les toits, pourquoi pas ! En maquette ou en dessin, équipés de ciseaux, de colle et de pinceaux, nous allons réinventer la ville. Architecte en herbe ou bâtisseur de cabanes, doux rêveur ou créateur fada, que les enfants nous rejoignent pour une semaine de chantier créatif !
Les animateur et animatrice
Mathieu Lauwers et Ninon Leclercq de l’asbl Made in Kit
MADE iN KiT est un espace de création bruxellois basé sur le graphisme participatif et le do-it-yourself. On y amène ses rêves, ses projets, ses envies, sa créativité, ses compétences. On y trouve, pour leur donner forme, une grande boite à outils dans laquelle on puise la formule la plus adaptée à ses besoins : des stages et animations pour petits et grands qui explorent de façon ludique des techniques de création liées au papier et des formations sur des questions techniques ou artistiques, de conception ou de production. Et puis d’autres choses encore, graphiques ou scénographiques, à la demande ou juste par plaisir.
| RÉSERVER |
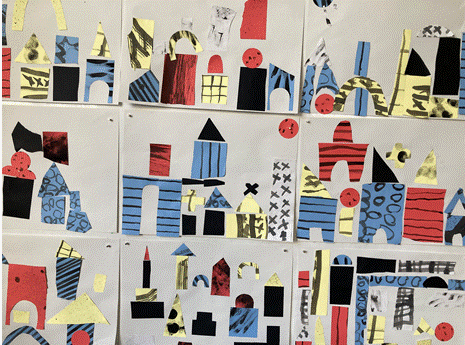
Mais pourquoi donc porter du bleu pour travailler ? Beaucoup de nos vêtements proviennent du monde du travail. Nous les avons adoptés, nous les aimons même, comme ces bonnes vieilles salopettes en toile bleue ! C’est la révolution industrielle qui amène la conception du vêtement de travail. Au début il s’agit d’une blouse grise ou noire pour se protéger des salissures. Ensuite ce sera une veste et un pantalon bleus à la fois solides, confortables, facilement lavables et avec des poches pour ranger les outils. Progressivement, le bleu symbolise le monde ouvrier. Dans la peau des travailleurs par le biais du vêtement, les enfants et leurs parents ou grands-parents en décortiqueront les nuances et les filiations avec le monde du travail, au travers de quelques techniques artistiques dont le dessin de mode. Ils seront amenés à créer des matières de bleu différentes selon les techniques et les papiers, à interpréter d’anciennes photographies d’ouvriers en blouse de travail et à visionner un défilé de mode, à réinventer des vêtements par le dessin, le collage ou la broderie sur papier.
L’animatrice
Styliste, modéliste et designer maille, Aurore Brun anime depuis longtemps des ateliers et stages textile pour enfants et adultes dans divers lieux, dont son asbl Robin Hook. Elle est également chargée de projet à Cyclup, la ressourcerie/centre de tri du CPAS de Bruxelles, rue Haute : un projet d’insertion socioprofessionnelle de récolte de dons de vêtements, à la fois créatif, zéro déchet et inscrit dans une démarche d’économie circulaire.
| RÉSERVER |

C’était tellement bien l’année dernière qu’on remet le couvert cet été ! Nous voilà donc à nouveau de concert avec les Jeunesses Musicales de Bruxelles pour faire vibrer le site de la Fonderie avec des enfants.
Au cours d’une fabuleuse semaine de découvertes dans les espaces et sur le site extérieur de l’ancienne fonderie, les enfants seront amenés à rencontrer différents musicien.nes. Ils et elles leur présenteront leur instrument, leurs pratiques, leurs gestes et leur relation à la musique et à leur métier. Afin d’explorer les sons et de mieux comprendre comment fonctionnent les instruments, les enfants exploreront également les ressources de la Fonderie et s’appuieront sur l’imaginaire que ce lieu magique, son histoire et ses machines suscitent pour fabriquer à leur tour des instruments. Singuliers, loufoques, à cordes ou métalliques, ils feront résonner les murs encore une fois comme jamais…

La Fonderie compte aujourd’hui plusieurs centaines d’objets déployés dans son exposition permanente et, surtout, plusieurs milliers d’objets en réserve, gardés pour mémoire. A l’occasion du prochain déménagement de ses réserves, l’équipe est amenée à revoir sa collection, établie pour beaucoup dans l’urgence et dans des conditions parfois rocambolesques pour sauver les patrimoines industriels de la ville. Ce stage qui associe écriture, photographie, dessin et collage est un espace d’imagination et d’expression sur le passage de l’objet de son contexte d’origine à celui du musée. La réflexion sur la mise en exposition se mêle à celle sur le choix des objets à montrer ou seulement à conserver. Chacun.e sera amené.e à se laisser porter par des sensations, à établir des relations, à imaginer les multiples histoires que les objets évoquent. Au travers de créations communes ou personnelles, de moments collectifs ou particuliers, chaque participant.e confectionnera une représentation singulière du musée… Qui sait, peut-être l’objet d’une prochaine exposition.
L’animatrice
Détentrice entre autres d’un master en Image et réalisation et d’une formation à l’atelier d’écriture, Aurélia Pfend a brassé diverses pratiques qui l’ont amenée à moultes créations. Régisseuse, réalisatrice, coordonnatrice de collectifs et animatrice d’ateliers vidéo, médiatrice culturelle, formatrice ou encore productrice ; elle a été de beaucoup d’aventures, dans des classes, des groupes, des quartiers.
| RÉSERVER |
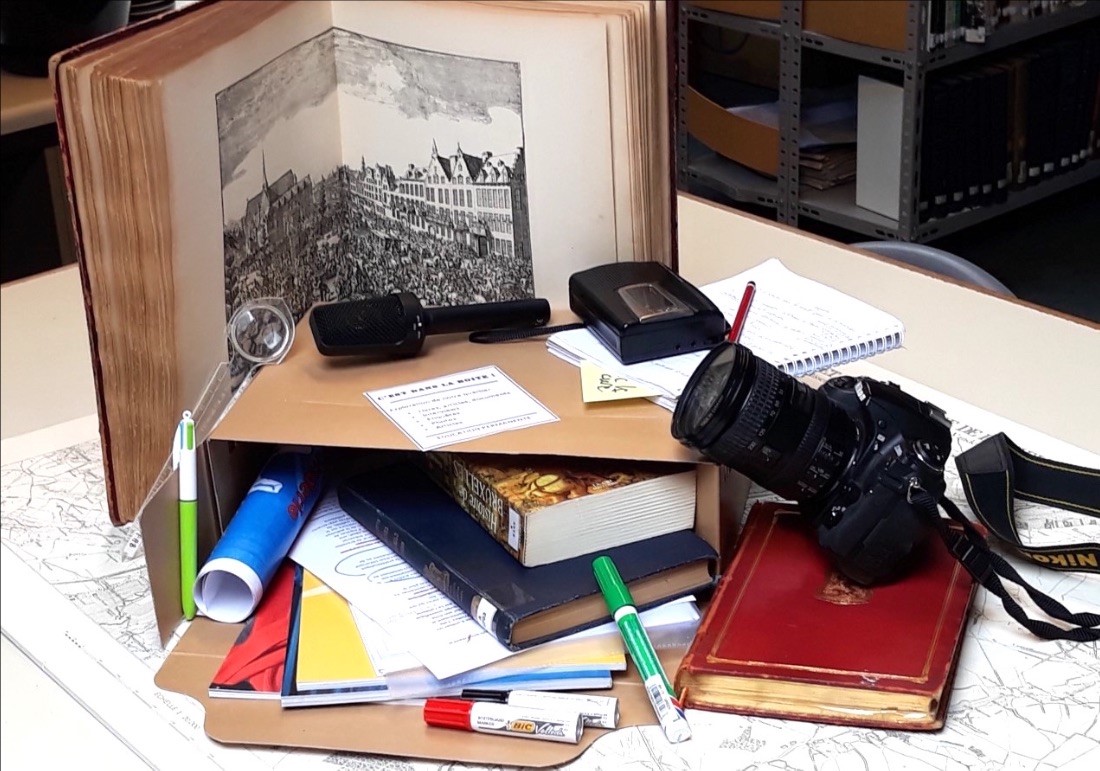
Entre les murs de l’ancienne halle de coulée, il s’agit d’une invitation à expérimenter les différentes étapes de la fonte au sable, une technique beaucoup utilisée par La Compagnie des Bronzes en ses années prestigieuses, et encore régulièrement dans certaines fonderies d’art actuelles. Chaque projet commence par l’esquisse et sa transposition en un modelage de terre. Ensuite, il faudra tirer parti de la malléabilité du sable pour réaliser un moulage à partir de l’empreinte d’un modèle en plâtre, lui-même réalisé à partir de l’empreinte du premier modelage en terre… Le stage permet d’explorer, en trois jours intenses, l’enchaînement des différentes phases du processus, à la fois artisanal et industriel, jusqu’au moule en sable apte à recevoir le bronze en fusion. La dernière après-midi sera consacrée au finissage de l’objet coulé, avec la ciselure et la patine.
L’animatrice
Françoise Gutman est sculpteuse et céramiste, formée à l’école du 75 et à l’école supérieure des arts plastiques de l’Etat à Mons. Depuis de nombreuses années, elle participe régulièrement à des expositions collectives et personnelles, en Belgique et à l’étranger. Elle est aussi une précieuse animatrice plasticienne attachée aux services éducatifs de plusieurs institutions muséales. Depuis bientôt 10 ans, elle accompagne nos projets qui intègrent la fonte du métal.
| RÉSERVER |

Que l’on crochète ses mailles ou que l’on tisse ses lignes, que l’on noue ou que l’on entrelace ; c’est toujours une affaire de fils, de rangs, de couleurs et de textures… De multiples relations existent entre les techniques du crochet et du tissage. Cet atelier est une sorte de laboratoire qui les croise, les tournicote, les explore dans des démarches collaboratives autant que personnelles. Les découvertes techniques et les pratiques créatives se feront tant par le biais de dispositifs ludiques collectifs que par la réalisation d’échantillons ou autres ouvrages individuels.
Les animatrices
Styliste, modéliste et designer maille, Aurore Brun anime depuis longtemps des ateliers et stages textile pour enfants et adultes dans divers lieux, dont son asbl Robin Hook. Elle est également chargée de projet à Cyclup, la ressourcerie/centre de tri du CPAS de Bruxelles, rue Haute : un projet d’insertion socioprofessionnelle de récolte de dons de vêtements, à la fois créatif, zéro déchet et inscrit dans une démarche d’économie circulaire.
Elisa Maudoux est designer textile. Elle est aussi co-fondatrice de l’ASBL Textilarium et professeure à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège en création textile. Le textile est son laboratoire de recherche, son lieu d’exploration, son champ de création…
| RÉSERVER |


Observation, inspiration, création, déambulation…, tels seront les leitmotivs des workshops proposés lors de cette soirée hors du temps.
AU PROGRAMME :

SLOW VISIT ET SKETCHING DANS LE MUSÉE — Dessiner au musée, avec Lucille Streicher et Zoé Médard
Et si prendre le temps de dessiner nous amenait à voir ce qui nous échappe habituellement, à nous balader dans les coins et recoins, à distinguer ce que souvent notre œil voit mais ne regarde pas ? Crayon en main, venez observer les formes, les matières, les jeux de lumières et de perspectives de notre exposition Made in Brussels. Deux artistes-animatrices vous accompagneront dans cette exploration nouvelle de l’exposition, où des détails insoupçonnés, des cohabitations insolites, des atmosphères parfois bien romanesques vous surprendront immanquablement. Que vous soyez expérimenté·e en croquis rapide, désireux·se de tenter une nouvelle expérience ou simplement curieux·se, vous êtes bienvenu·e. Venez avec votre matériel ou… les mains dans les poches. Nous avons tout prévu !
Langue : FR
Horaire : en continu entre 18h et 22h, sans réservation

SLOW VISIT EN MUSIQUE — Dériver au musée, avec Flygmaskin
Aérienne, douce et audacieuse, la musique de Flygmaskin nous emportera dans de nouvelles visions de l’exposition Made in Brussels. Encore une invitation singulière au voyage…
“On peut y lire le souffle du vent, un voyage qui prend soin de ce qui se dérobe au visible. On peut y entendre l’appel sensible de l’errance. La machine, c’est le son, précis, fluide. Le combustible ? Ce mélange singulier des claviers, les dialogues essentiels entre l’accordéoniste, le claviériste, la poésie et le silence.”
Un casque sans fil sur les oreilles, venez muser, musarder, flâner au musée. Venez explorer l’exposition et le site de l’ancienne fonderie d’art de La Compagnie des Bronzes pour y dériver, y dessiner peut-être… tout en restant immergé·e dans l’univers musical délicat de Flygmaskin. Voilà une expérience sensorielle qui entrelace patrimoines, sons et déambulation. Un instant suspendu, une invitation à ralentir, à respirer, à ressentir autrement, à prendre le large… Flygmaskin interprétera son projet Dérives adapté spécialement pour La Fonderie dont vous trouverez quelques extraits sur leur site ici.

WORKSHOP « LA PETITE FABRIQUE DU MUSÉE »
Livrées aux imaginaires et à la créativité des visiteur·ses, des pièces de collection du musée, sorties exceptionnellement du mystère des réserves, seront au cœur de cette expérience. Dans la peau d’un·e conservateur·rice, muséographe ou scénographe, vous découvrirez et observerez les objets avec attention. Vous les photographierez avec précision. Vous créerez des mises en scène sous forme de collages que vous placerez ensuite dans un cadre, avec inspiration. Il ne restera plus qu’à écrire le cartel !
Langue : FR
Horaire : en continu entre 18h et 22h, sans réservation
JEU-CONCOURS : TROUVEZ L’OBJET INSOLITE
Cela fait 25 ans que, dans le cadre des Nocturnes, Brussels Museums suscite des moments privilégiés et surprenants pour découvrir autrement les musées bruxellois et les richesses de leurs collections. Pour fêter ce quart de siècle, les Nocturnes invitent ses publics à participer à un jeu–concours exceptionnel : « Trouvez l’objet insolite ». La Fonderie sera joyeusement de la partie en collaboration avec La Centrale for Contemporary Art, ouverte le même soir.
Le principe : l’équipe de La Fonderie a déniché dans ses collections foisonnantes et hétéroclites un objet, plutôt élégant, qu’elle a soigneusement prêté à celle de La Centrale qui l’a discrètement intégré à ses espaces. Et voilà la première manche de la partie jouée. À vous maintenant ! L’intrus passera-t-il inaperçu ou parviendrez-vous à le débusquer ?
Les règles du jeu
Un indice ? Nos collections ont été constituées dès la création de l’ASBL La Fonderie en 1983. La désindustrialisation a déjà frappé durement Bruxelles et Guido Vanderhust comprend alors l’urgence de préserver le patrimoine industriel et ouvrier de la capitale. Pendant de longues années, au gré d’opérations de sauvetage, d’achats, de versements et de dons, La Fonderie a constitué ses collections. Amples et étonnantes, elles sont un témoignage inestimable tant de l’histoire industrielle que de l’évolution du travail et de la vie sociale et quotidienne à Bruxelles. Elles comprennent de très grandes et lourdes machines – des presses, des machines-outils ou des machines à vapeur – et des objets plus petits, comme des outils, des produits finis, des objets publicitaires ou des équipements domestiques qui chauffent, qui lavent, qui cousent ou qui découpent… Des témoignages oraux, des archives, des photos et des films viennent encore composer ces collections à la fois multiples et uniques. À ce jour, au rayon des objets, on dénombre plus de 13.000 pièces…
Pour en savoir plus sur le concours, c’est ici.
INFORMATIONS PRATIQUES
L’achat des tickets se fait sur le site des Nocturnes ou à l’accueil de notre musée le soir même.

Le Sandwich-Club du mardi, 4e clap !
Pour sa quatrième rencontre, le Sandwich-Club du Mardi fait un focus sur le dispositif des titres-services.
A l’heure où l’Arizona entend déréguler encore davantage le marché du travail et nous faire travailler tous, plus et plus longtemps, il est utile de voir ce qu’il advient des travailleurs (en l’occurrence des travailleuses) aux prises avec un marché du travail peu régulé.
Le marché des titres-services est une création du gouvernement fédéral, celui du gouvernement Arc-en-ciel (2001). Objectifs initiaux du dispositif : lutter contre le travail illégal, augmenter le taux d’emploi féminin et permettre aux utilisateur·trices de concilier plus aisément vie de famille, temps de loisirs et travail domestique.
Si ce marché s’est largement développé depuis sa création, a-t-il permis de lutter contre les inégalités de genre sur le marché du travail, les emplois occupés sont-ils de qualité?
Qui des employeurs, des travailleuses et des ménages utilisateurs tirent le plus avantage de ce dispositif ? Comment le marché des titres-services est-il régulé ? Les entreprises d’insertion et/ou d’économie sociale ont presque toutes quitté ce segment du marché du travail, désormais composé, pour l’essentiel, d’entreprises commerciales mues par la volonté de dégager des profits.
Qu’en est-il des conditions de travail des travailleuses sous contrat titres-services ? Ces emplois peuvent-ils être considérés comme étant “emplois pénibles” ? Le salaire mensuel perçu permet-il aux travailleuses (et à leur famille) de vivre correctement de leur travail ?
Pour en discuter concrètement avec nous, nous recevrons Nicolas Moens (UCL), auteur de l’étude « Donner du sens aux services : analyse du rapport des aide-ménagères en titres-services » 2022, UCL, ainsi que Soizic Dubot, coordinatrice socio-économique de Vie Féminine.
La séance sera suivie par une projection du film documentaire Au bonheur des dames, réalisé par Agnès Lejeune et Gaëlle Hardy, Les films de la passerelle, 2018, 68 min.
Ces rendez-vous ont lieu tous les troisièmes mardis du mois dans notre espace Cafétéria. Un petit bar y est ouvert et il est possible de réserver un sandwich préparé par le projet d’économie sociale Belo.
Chaque séance fait, par ailleurs, l’objet d’un podcast particulier sur Radio Campus, dans l’émission Micro Ouvert.
Documentation : Titres-services : une domesticité subsidiée – Ensemble ! Pour la solidarité, contre l’exclusion n°107
Inscription et commande de sandwich : ici


Difficile à avaler est un documentaire radiophonique réalisé à Clabecq, dans le Brabant Wallon, au cours des deux dernières années. Il nous emmène au fil d’une enquête micro au poing à la découverte d’une culture ouvrière et d’une histoire locale aujourd’hui marquées par la disparition.
Les Forges de Clabecq ont été démolies, à l’exception du laminoir d’Ittre, et le site est en passe d’être complètement réaffecté. À l’instar d’autres anciennes implantations sidérurgiques belges en cours de transformation, comme celles de Seraing ou de Charleroi, la réaffectation du site représente un choix historiographique qui impacte une mémoire collective.
Fernand, ancien ouvrier et délégué syndical, nous ouvre les portes d’un groupe d’anciens des Forges de Clabecq qui militent pour l’obtention des salaires toujours impayés. Tout au long du documentaire, les voix des souvenirs rencontrent les paysages sonores de la disparition des Forges, mais aussi ceux de son activité reconstituée grâce à la base de données collaborative SoundsofChanges et grâce à des enregistrements réalisés à Völklingen (Allemagne) et Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
Loin de vouloir représenter toute l’histoire des Forges, Difficile à avaler propose de rassembler des questions, anciennes et nouvelles, à travers la découverte de témoignages personnels et d’expériences ouvrières et militantes.
Se replonger dans cet épisode de l’histoire industrielle et sociale belge, c’est interroger aux moins deux enjeux liés à son héritage : les enseignements de décennies de lutte ouvrière et l’avenir d’immenses sites aujourd’hui désaffectés.
L’écoute publique dure 38 minutes. Le 5 juin, elle sera suivie d’une discussion en présence d’invités.


Dans la capitale, plus encore que dans les autres villes du royaume, les logements abordables sont devenus une perle rare. Ne payer qu’un tiers de ses revenus pour se loger paraît désormais relever du “privilège” et tandis que la situation s’aggrave d’année en année, rien ne semble en mesure d’entraver la tendance haussière du marché. Coincée entre un narratif catastrophiste et les pages “immo” des quotidiens, la crise du logement abordable nous semble devoir être considérée depuis la racine du problème : alors qu’ils sont une nécessité pour la survie, le logement est aussi une marchandise qui se loue et s’achète sur un marché, au plus offrant.
Mardi 18 mars, le Collectif Solidarité Contre l’Exclusion, Lire et Écrire Bruxelles, La Fonderie et Radio-Campus vous invitent à la troisième rencontre du Sandwich-Club du Mardi. On parlera de la crise du logement à Bruxelles. Pour en discuter concrètement, nous recevrons Hugo Périlleux Sanchez (ULB), auteur d’une thèse en géographie intitulée Extraction de la rente dans le secteur de la location de logements, et Aurélia van Gucht (Maison de Quartier Bonnevie), travailleuse sociale à Molenbeek depuis 1993 et une des fondatrices du projet Alarm.

Ces rendez-vous ont lieu tous les troisièmes mardis du mois dans notre espace Cafétéria. Un petit bar y est ouvert et il est possible de réserver un sandwich préparé par le projet d’économie sociale Belo. Chaque séance fait, par ailleurs, l’objet d’un podcast particulier sur Radio Campus, dans l’émission Micro Ouvert. Première rencontre (21 janvier) : La limitation à deux ans des allocations de chômage, avec Yves Martens (CSCE) et Xavier Polfliet (travailleur social) Deuxième rencontre (18 février) : 2024, on a voté, et puis après ?, avec Caroline Sägesser (CRISP) et Catherine Van Huyck (asbl Modus Vivendi)
DOCUMENTATION : Grande Manifestation pour le Droit au Logement du 6 avril 2025
INSCRIPTION ET RÉSERVATION DE SANDWICH : ici

Les six premiers rendez-vous auront lieu à La Fonderie, rue Ransfort 27 à Molenbeek. Un petit bar y sera ouvert et il sera possible de réserver la veille un sandwich préparé par le projet d’économie sociale BELO (1080)
𝗥𝗘𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 : https://tinyurl.com/scdm0125
𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗘𝗥 : Mardi 21 janvier de 12h15 à 14h00
𝗧𝗔𝗥𝗜𝗙𝗦 : Gratuit
Le sandwich est payant, voir inscription.
𝗟𝗜𝗘𝗨 : Rue Ransfort 27, La Fonderie, Molenbeek
𝗜𝗡𝗙𝗢𝗦 : sandwichclubdumardi@gmail.com
𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘́ : Événement adapté à tous les publics

Mardi 18 février, le Collectif Solidarité Contre l’Exclusion, Lire et Écrire Bruxelles, La Fonderie et Radio-Campus vous invitent à la deuxième rencontre du Sandwich-Club du Mardi. Celle-ci reviendra sur les scrutins électoraux de 2024 en compagnie de Caroline Sägesser (CRISP) et de Catherine Van Huyck (ASBL Modus Vivendi).
Grandes tendances et basculements, mouvements sociologiques, nouveaux paysages politiques à Bruxelles et au fédéral seront au cœur du débat. Nous étions habitués, depuis une quinzaine d’années, au temps, parfois infiniment long, nécessaire à la formation d’un gouvernement fédéral… Cette fois-ci, ce délai se double de la béance du pouvoir régional, voire se triple dans le cas de deux communes bruxelloises dont les collèges sont toujours “faisant fonction” (Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode). Comment se vivent ces situations et avec quelles conséquences sur les acteurs sociaux et culturels de première ligne ?
Le rendez-vous a lieu à La Fonderie Musée bruxellois des industries et du travail. Un petit bar y sera ouvert et il est possible de réserver un sandwich préparé par le projet d’économie sociale Belo ici.
Retrouvez la première rencontre du Sandwich-Club (21 janvier 2025) consacrée au projet de limitation à 2 ans des allocations de chômage sur Radio Campus, dès le vendredi 7 février à 16h dans l’émission Micro Ouvert.
Le 18 mars 2025, le thème de la troisième rencontre portera sur le logement à Bruxelles.
𝗥𝗘𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 : ici
DOCUMENTATION : Carte Blanche, coécrite par Catherine Van Huyck (ASBL Modus Vivendi) et cosignée par 360 associations

Cet atelier est basé sur la visite de l’exposition Made in Brussel pour, ensuite, laisser libre cours aux impressions, aux interprétations et aux sensations qu’elle suscite.
Machines-outils, à écrire, à laver ou linotype ; objets et produits quotidiens parfois oubliés ; cartes perforées, galons et passementerie, planches de catalogues, modèles, gabarits ou brevets… Autant d’éléments de notre exposition permanente à la fois surprenants, évocateurs et ingénieux mais qui surtout invitent à découvrir le fabuleux passé industriel de Bruxelles et les savoir-faire qui étaient associés aux activités de production.
L’atelier propose d’explorer des gestes techniques tout en éveillant la sensibilité artistique, à travers l’expérimentation d’une parmi les trois techniques d’impressions manuelles suggérées. Il s’agit de valoriser les connaissances acquises lors de la visite pour consolider leur assimilation en mobilisant la créativité, la fantaisie et l’imagination des participant.es.
Le choix de la technique d’impression se fait au préalable, lors de l’inscription. Nous pouvons vous conseiller en fonction de l’âge des participant.es et de leur nombre.
Trois propositions
La gravure sur tetrapak est une technique de gravure en creux qui offre des impressions précises et délicates. On grave à l’aide d’un poinçon sur un carton de lait et on imprime à l’aide d’un laminoir. La technique permet de travailler les détails, d’évider les surfaces, de froisser et de découper… Bref d’explorer les milles facettes du tetrapak pour réaliser des gravures sensibles ;
La gravure sur gomme est une technique de gravure en relief. Elle consiste à évider à l’aide d’une gouge certaines parties de la gomme pour ensuite encrer la surface et imprimer le motif ainsi créé. L’encrage et les impressions multiples permettent de jouer avec subtilité de ce médium facile d’accès ;
Le monotype est un procédé d’impression accessible qui laisse place à la surprise. En intervenant directement sur l’encre, nous jouons à laisser des traces, des empreintes, des chemins pour ensuite les imprimer manuellement. Chaque estampe ainsi créée est unique.
Objectifs
Déroulement de l’activité en deux temps

Une soirée « Délestage », c’est une invitation à participer à un exercice pratique et poétique.
Il s’agit d’entrer dans une fiction plausible où l’énergie raréfiée oblige les habitants des villes à inventer de nouvelles manières de faire culture ensemble sans avoir recours à l’électricité.
« Délestage » est un moment d’écoute et de partage qui envisage une certaine idée de la beauté dans la transition à venir, en jouant avec un dénuement technologique volontaire et momentané.
Visite, discussion, cuisine, musique… sans électricité, le tout est orchestré par une performeuse, Clara Thomine, sous forme de récit et de jeu avec le public.
La Fonderie, dont les collections témoignent de la boulimie énergétique de notre civilisation matérielle, accueille la 5e soirée « Délestage » avec enthousiasme et curiosité. Elle jouera le jeu et se délestera pour vous accueillir à cette soirée singulière, à la fois belle et questionnante.
Programme
18h30 : accueil dans le musée
19h : visite performée de l’exposition permanente Made in Brussels. Venez avec votre plus belle lampe de poche !
20h : discussion avec un.e acteur.rice de la transition écologique bruxelloise : recyclerie In Limbo
21h : repas – performance culinaire sans électricité concoctée par le duo Set De Table (Max Ricat & Siméon Droulers)
22h : micro live sets acoustiques par des performeur.se.s locaux
23h : fermeture du musée
Une idée originale de Jeanne La Fonta en compagnie de Louis Neuville avec le soutien précieux de Clara Thomine, Mylène Lauzon, Marc Borgers et Emmanuel Prat.
L’équipe de « Délestage » tient à remercier chaleureusement les 28 intervenant.e.s qui ont participé aux quatre sessions précédentes.
Cette soirée bénéficie du soutien de de la Fédération-Wallonie Bruxelles.
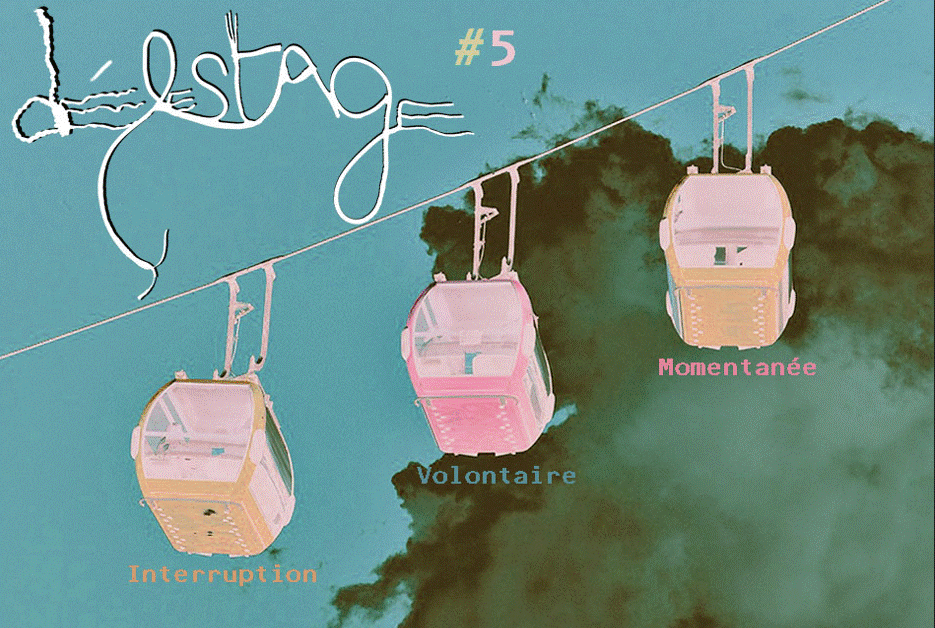
Comme une évidence, Mathilde Schoenauer Sebag a donc choisi La Fonderie pour présenter en première écoute son podcast qui aborde ces sujets avec subtilité et humour. Au creux d’un dimanche après-midi de décembre, nous nous poserons confortablement dans le musée, oreilles tendues et estomacs repus par un bon goûter, pour écouter… écouter et s’abandonner aux programmes inutiles des machines à laver.
Pitch
Lou est une jeune femme rationnelle et habituée à ce que les choses aient un sens. Alors quand elle se rend compte que la plupart des gens n’utilisent pas les programmes de leur machine à laver, elle ouvre l’enquête et entame une mission qui va la dépasser.
Au centre d’archives, elle met la main sur le premier programme inutile jamais inventé, le cycle doux, imaginé par Lucien Grenat. Un personnage sibyllin, mi-standardiste, mi-archiviste, lui fait comprendre qu’il faut empêcher à tout prix l’invention du cycle doux car il est le premier élément d’une chaîne causale menant à la chute de l’humanité. Lou entame alors un voyage temporel pour tenter de convaincre Lucien d’abandonner son invention. Mais la fiction finit par prendre possession des personnages et les voici tous deux éjectés dans un futur gentiment foutoir où l’on assiste à une course de machines à laver.
Programme
14h : accueil dans le musée
14h30 : écoute de 2 épisodes
Épisode 1 : Les cartes électroniques meurent aussi
Épisode 2 : Le cristal zéro
15h10 : entracte
Un temps pour déambuler dans le musée et prendre un goûter à la cafétéria
15h40 : écoute de 2 épisodes
Épisode 3 : Rencontre du troisième cycle
Épisode 4 : À tambour battant
16h30 : fin de l’écoute
Un temps pour échanger, papoter… ou boire un verre
17h15 : fermeture du musée
Pourquoi cette fiction ? par Mathilde Schoenauer Sebag
La fourchette n’a pas évolué depuis des siècles. Le jour où elle a enfin rempli toutes les fonctions pour lesquelles elle avait été imaginée, elle a arrêté d’évoluer. Pourquoi ceci n’a-t-il pas été le cas pour la machine à laver ? Aurait-il pu en être autrement ?
Lou et le mystère du cycle doux est une fiction radiophonique en quatre épisodes qui part de cette interrogation somme toute innocente, mais qui mobilise malgré tout une certaine frustration de se voir imposer des innovations qui n’ont pourtant aucune utilité. Ces questions ont fini par enfler jusqu’à donner 1h40 de tergiversations sur la machine à laver.
Dans cette utopie radiophonique, je suis donc partie de la machine à laver comme symbole de l’objet utile devenu gadget. Objet qui améliore réellement le quotidien, mais progressivement emberlificoté dans des innovations inutiles. Par inutile, j’entends “qui ne diminue pas la pénibilité du travail physique”, “qui ne correspond à aucun désir ou besoin préexistant”. Mon propos n’est pas technophobe, il vise à décaler avec humour nos rapports aux objets techniques et à poser les bases d’un débat collectif autour de la définition de nos besoins.
Cette fiction radiophonique permet également de mettre en exergue le pouvoir de la fiction en tant qu’outil révolutionnaire et outil de soin. C’est le second propos qui est tenu ici, en filigrane. Révolutionnaire, parce que l’on peut modifier un élément du passé, infléchir la courbe temporelle, esquisser les contours d’un futur souhaitable. Et malgré l’aspect fictionnel de ces modifications, se figurer un futur fait partie des façons de le rendre plus probable (1). C’est en portant notre attention sur un futur qui doit exister, en se posant les questions collectivement, en imaginant, fantasmant, que quelque chose opère en nous. L’horizon bouché se retrouve parcouru par de tremblantes lignes de fuite, qui se mutent en lignes de désir (2). La fiction est également un outil de soin, parce que rendre visite au passé permet un certain apaisement. Les schémas simplistes s’écroulent, libérant un espace pour convertir le ressentiment, l’amertume et l’impuissance en énergie mobilisante et joyeuse.
(1) Je recherche une forme d’efficacité symbolique comme l’entend Claude Levi Strauss, faisant référence au pouvoir des symboles et des mises en récits sur nos vies.
(2) Je souhaite ici renverser l’actuelle tendance à inonder nos imaginaires de dystopies, quoiqu’elles aient un grand pouvoir d’alerte – c’est la voie prise par exemple par Benjamin Abitan dans La préhistoire du futur. Le parti pris ici a été au contraire de rechercher des univers réalistes comme ceux que l’on peut retrouver dans Bâtir aussi, recueil de fictions spéculatives écrites par le collectif de l’Antémonde.
Remerciements
Constant, Leslie, Maxime, Miguel, Anass, Michèle, François Jarrige, Razmig Keucheyan, Gil Bartholeyns, André Gorz, Quynh Delaunay, Manuel Charpy, Ivan Illitch, Anna Barseghian, Thierry Weil, Victor Focquet, Mehdi Bayad, Amélia Nanni, Chahid Bestrioui et la machine à laver de Marie dont le filtre anti-parasite a fait les frais de mon amateurisme.
Bibliographie
1893 L’âge de l’ersatz – William Morris
1926 L’idéal du cassé – Alfred Sohn Rethel
1958 Du mode d’existence des objets techniques – Gilbert Simondon
1966 « Je suis sincère avec moi-même » et autres lieux communs : La machine est un objet neutre dont l’homme est le maître – Jacques Ellul
1972 Test Achats – Archives – Bibliothèque royale de Belgique
1972 Marie Claire Maison – Archives – Bibliothèque royale de Belgique
1981 Autopsie d’une machine à laver – Yves Stourdzé / https://www.cairn.info/revue-le-debat-1981-10-page-15.htm
1994 La machine à laver en France. Un objet technique qui parle des femmes – Quynh Delaunay
2016 Negotiating with the future : incorporating imaginary future generations into negotiations, – Yoshio Kamijo, Asuka Komiya, Nobuhiro Mifune et Tatsuyoshi Saijo
2019 Les besoins artificiels – Razmig Keucheyan
2021 What do people say when they become « future people » ? Positioning Imaginary Future Generations (IFGs) in General Rules for Good Decision Making – Toshiaki Hiromitsy, Yoko Kitakaji, Keishiro Hara et Tatsuyoshi Saijo
2021 L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent – Gil Bartholeyns et Manuel Charpy
2022 Devenir futurier – Yoann Moreau / https://www.utopiana.art/en/devenir-futurier
Références sonores
1991 Leapday night – David Behrman
2016 Ultimate Care II – Matmose panneau latéral
2018 Bâtir aussi – Les ateliers de l’Antémonde
2019 La préhistoire du futur – Benjamin Abitan, France Culture
2021 Rouge vif – Mehdi Bayad
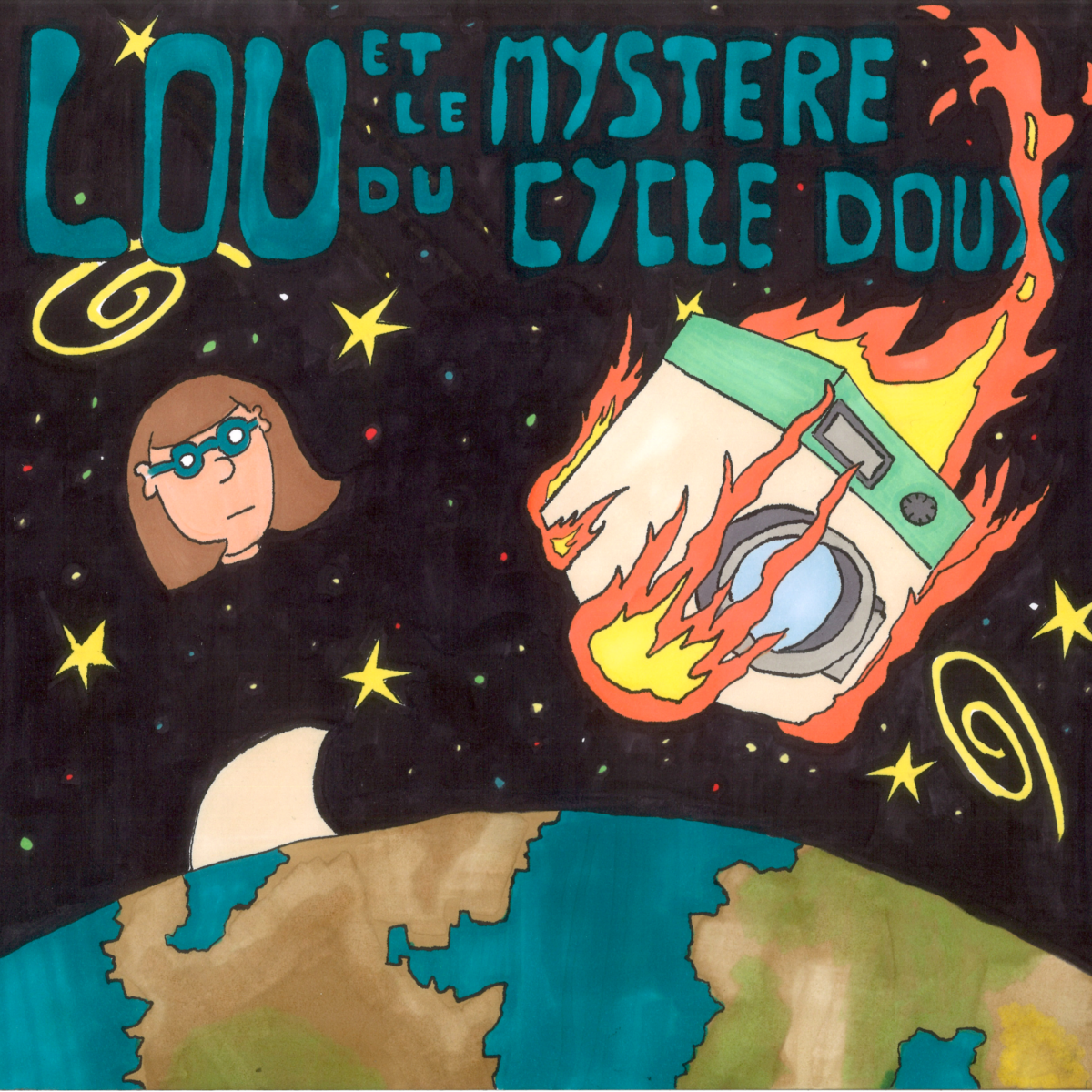
Le musée de l’ASBL La Fonderie accueille d’octobre 2025 à juin 2026 l’exposition Beldavia. Votre nouvelle terre d’accueil. Cette expo-action interactive et critique montrent aux visiteur·euses les obstacles rencontrés par les migrant·es dans leur quête d’un logement et d’un permis de séjour.
C’est dans ce contexte que le projet d’atelier d’éducation permanente Les dérouté·es est né. Nous désirons donner la parole aux personnes concernées et leur permettre de partager leurs expériences de recherche d’emploi ou de mise au travail avant d’avoir obtenu leurs papiers, quelles qu’aient été ces expériences, pénibles ou moins pénibles, avec ou sans aide, couronnées de succès ou non.
Cela prendrait la forme de détournement d’images issues de notre centre de documentation, que les participant·es pourront détourner à leur guise afin de partager leurs histoires. Une manière de partager, se moquer, dédramatiser des situations vécues lors de leur emploi ou dans sa recherche. Une façon de diffuser, par le langage de l’humour, les témoignages des participant·es.
A l’issue de 4 rencontres, le résultat final (des séries d’images détournées) sera imprimé aux dos des tickets de l’exposition Beldavia à partir de Mars 2026 . Il sera également disponible en ligne avec une fiche pédagogique pour les travailleur·euses, animateur·ices, formateur·ices, enseignant·es qui souhaiteraient aborder ce sujet avec leurs publics.
Les rencontres auront lieu le dimanche après-midi, de 13h30 à 16h30 les 11, 18, 25 janvier et le 1er février. La participation à l’atelier est gratuite et les inscriptions sont ouvertes.
Il est normal de vouloir en savoir plus sur le contenu d’un atelier, sur sa philosophie ou sur ses animateurs et animatrices avant de s’y inscrire. N’hésitez pas à nous appeler.
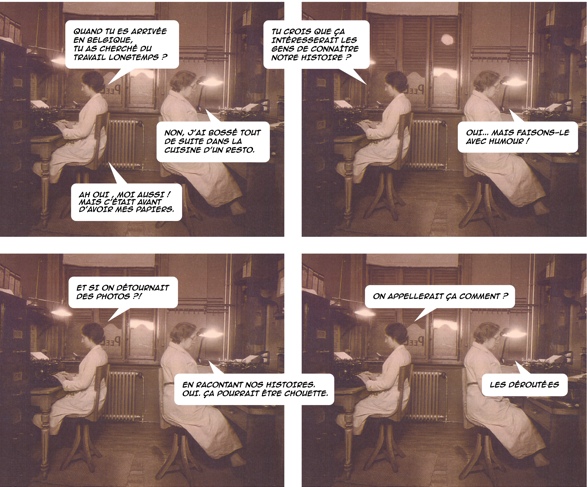
Située sur le site de l’ancienne Compagnie des bronzes de Bruxelles, La Fonderie incarne un lieu emblématique, témoin du passé industriel de la capitale. Nous travaillons à la mise en lumière du patrimoine lié directement à ce passé et la multitude de thématiques et problématiques qu’il soulève via différentes activités.
Vous réaliserez principalement la mise en forme graphique des outils de promotion des activités de La Fonderie ainsi que la mise en page des publications.
Plus d’informations dans le lien ci-dessous
Candidature – Graphiste
Mathias Mellaerts – Directeur
mmellaerts@lafonderie.be
Rue Ransfort 27, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

La Fonderie, située sur le site historique et industriel unique de l’ancienne Compagnie des Bronzes à Molenbeek, recherche un partenaire pour gérer sa cafétéria. Ce lieu atypique, entouré de friches et d’espaces végétalisés, offre une atmosphère singulière, propice à une expérience Horeca originale.
Le futur partenaire aura l’opportunité de proposer une offre de restauration diversifiée qui s’adapte aux visiteurs du musée, aux habitants du quartier. En plus de cela, il pourra participer à la programmation culturelle du site.
Ce projet représente une occasion unique de s’associer à un lieu patrimonial exceptionnel, tout en collaborant avec des producteurs locaux et en attirant de nouveaux publics.
Plus d’informations dans le lien ci-dessous
Candidature – Collections
Mathias Mellaerts – Directeur
mmellaerts@lafonderie.be
Rue Ransfort 27, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

L’association Marcel Hicter pour la Démocratie Culturelle, asbl d’éducation permanente, propose l’édition 2022 de sa formation Res Urbis.
Lancée en 2001, la formation Res Urbis s’adresse aux acteurs culturels bruxellois privilégiant un rapport novateur à la ville. Elle vise à renforcer leurs capacités à développer leur projet, à comparer leurs pratiques et comprendre les enjeux dans lesquels ils évoluent (politique de la ville, politique et actions culturelles, enjeux sociaux, politiques et économiques).

Res Urbis est axée sur la conception de projets culturels et alterne :
Chaque participant confronte ainsi son projet avec les réalités du terrain bruxellois, belge et européen et enrichit son réseau et sa connaissance des acteurs de ces terrains.
Dossier d’inscription à la formation

Description de l’outil/du service
Quand le travail se cherche est un dossier d’exploitation sur la thématique du travail qui se base sur un corpus de film.
Ce premier opus est centré sur la question de la recherche d’emploi et propose une réflexion quant aux modes de sélection, les causes et conséquences de la recherche et/ou du statut de chercheur.euse d’emploi. Les activités peuvent cependant être réalisée indépendamment du visionnage des films.
Objectif
L’objectif de ce dossier est de porter un regard critique et émancipateur sur la question de la recherche d’emploi et des ressentis qui peuvent s’accompagner. D’être à la fois vecteur d’empouvoirement pour les personnes en recherche d’emploi et sensibilisant pour les personnes travaillant dans ce domaine.
Année de création 2024
Public
Ce dossier s’adresse aux personnes en recherche d’emploi ou aux animateurs et animatrices désirant travailler sur le sujet. Il peut également être le moyen de sensibiliser un public autour du sujet de la recherche d’emploi.
Comment l’utiliser ?
Le dossier liste et explique une série d’activités à mettre en place avant ou après avoir visionné les films présentés. Le temps de réalisation de ces activités peut varier entre une et deux heures.
Outil/Service en ligne
| TÉLÉCHARGER LE DOSSIER |

Description de l’outil/du service
Ce dossier invite les groupes à aborder une série de questions, débats et ateliers en utilisant leurs savoirs propres comme base de travail. Il peut être utilisé avant ou après avoir suivi le parcours Tour et Taxis, un patrimoine de classe mondiale et, pour une bonne partie des activités proposées, peut même être utilisé tout à fait indépendamment de la visite.
Objectif
Faire émerger des groupes d’utilisateurs un savoir qu’ils seront ensuite amenés à partager et structurer. Aborder une série de questions de société à partir de l’exposition, ou indépendamment de celle-ci.
Année de création 2024
Public
Ce dossier s’adresse aux formateurs, enseignants et groupes d’adultes dans un cadre d’éducation permanente, de formation, d’études…
Comment l’utiliser ?
Le dossier liste et explique une série d’activités à mettre en place avant ou après avoir suivi le parcours. Le temps de réalisation de ces activités peut varier entre une et trois heures.
Outil/Service en ligne
| TÉLÉCHARGER LE DOSSIER |
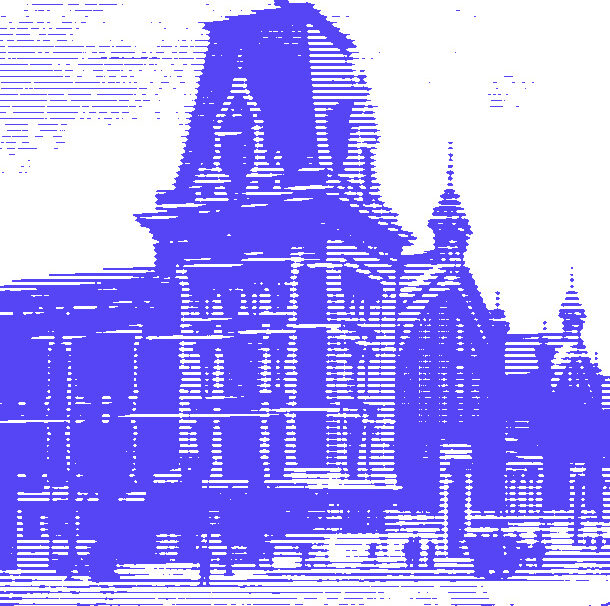

Tout au long de l’été, Nicolas Gutiérrez Muñoz a mené une expérience artistique inhabituelle, exploratoire et évolutive, inspirée par les histoires, les contours, les matières et les couleurs du site du Musée de La Fonderie.
Inspiré par les notions de vestige et de trace, l’artiste a choisi d’évoquer la désindustrialisation et, de manière plus large, la condition et l’identité ouvrières. Au fil des semaines, il a arpenté les différents espaces du site et est intervenu de-ci de-là, offrant au regard des visiteurs des installations imprévues et questionnantes, mais aussi de nouvelles perceptions de l’ancienne usine de la Compagnie des Bronzes.
Nicolas travaille au plus près des matières, les associe, collabore avec le temps et le climat, joue avec les transformations que ceux-ci impriment sur ses installations. Ses œuvres laissent le champ libre au détour, au hasard et à l’exploration.

Après presque trois mois, nous vous invitions à explorer avec Nicolas l’aboutissement de cette belle expérience, ce dimanche 29 septembre 2024 dès 17h lors du finissage de l’exposition. À 17h30, Nicolas partira avec vous déambuler sur le site à la découverte de ses installations.
Ce sera l’occasion de rallumer notre four à pain, construit, de la première brique au maçonnage final, par nos stagiaires de l’été. Kasimierz y enfournera tartes et pizzas, avant d’entamer l’automne et de préparer l’année prochaine.



La Fonderie sort également de ses réserves, pour l’occasion, plusieurs recueils officiels de marques déposées au Conseil des Prud’homme précisément au cours de l’année 1925. Feuilleter ces registres, c’est se plonger dans les années folles. C’est aussi s’immerger dans le monde des créateurs industriels. Briques de beurre, huiles, chocolats, grille-pains, gaufriers, tubes de cirage ou boîtes de biscuits, cuisinières, aspirateurs et autres articles ménagers, pharmaceutiques ou de quincaillerie…. Tout est déploiement graphique déclinant la ligne brisée aux angles vifs ou arrondis et les formes stylisées, exotiques ou aérodynamiques de l’Art Déco. Les polices géométriques, la typographie Futura, les visages solaires et les motifs régulièrement répétés rappellent des souvenirs de produits connus, souvent depuis l’enfance, ou révèlent des images publicitaires parfois désuètes mais… Oh combien séduisantes !
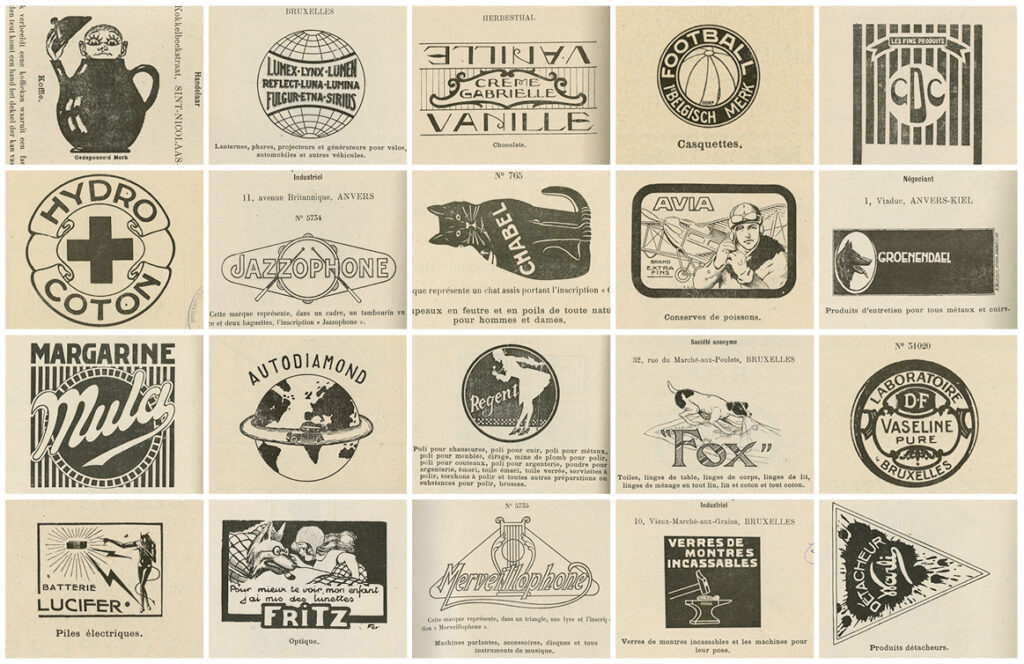
À partir d’un corpus d’images et d’objets, La Fonderie propose un atelier de sérigraphie préparé avec Christine Mawet, Charlotte Poels et les élèves du secteur des Arts Appliqués de l’école Sainte-Bernadette d’Auderghem. Pour les adeptes de cette technique d’impression ancestrale mais particulièrement explorée au début du 20e siècle, l’atelier permettra de décliner en couleurs une série de marques, logos et signatures industrielles déposés durant l’année 1925. Prêts à être singularisés par vos soins, des tote-bags seront disponibles à prix démocratiques à l’accueil de notre musée mais vous pouvez aussi bien entendu apporter vos propres textiles !
Musée et atelier en continu, de 14h à 17h – sans réservation préalable

La cantine associative ZOT proposera, comme à son habitude, de savoureux sandwichs, un plat du jour et des boissons. Le tout sur les ondes musicales de Yegor. Dans la halle de coulée, sa musique mènera les visiteur·euses, les familles, les passant·es… vers un autre monde, aux portes de notre réalité.
Daydreaming est une invitation à un voyage à travers des histoires et des contes de fées racontées via des sonorités musicales. C’est une escapade vibrante pour se laisser envoûter par des ambiances mêlant harmonieusement divers styles musicaux : ambient, chillout, électronique, électroacoustique et wave op.

Trois départs sont prévus au coin des rues des Béguines et Joseph Diongre pour ce parcours à travers deux cités de l’entre-deux-guerres à la fois très représentatives du concept de la cité-jardin et de l’implication de leurs architectes, Joseph Diongre et Henri de Saulnier, dans la problématique du logement social. Voisines, elles ont toutes deux été construites en moins de 5 ans au sein du « Nouveau Molenbeek». Nous découvrirons leurs particularités et leurs similitudes à la fois dans leurs conception et réalisation mais aussi dans leurs évolutions, au gré des opportunités et défis urbanistiques et sociaux depuis un siècle.
Plus d’infos et réservations : Cliquez ici !
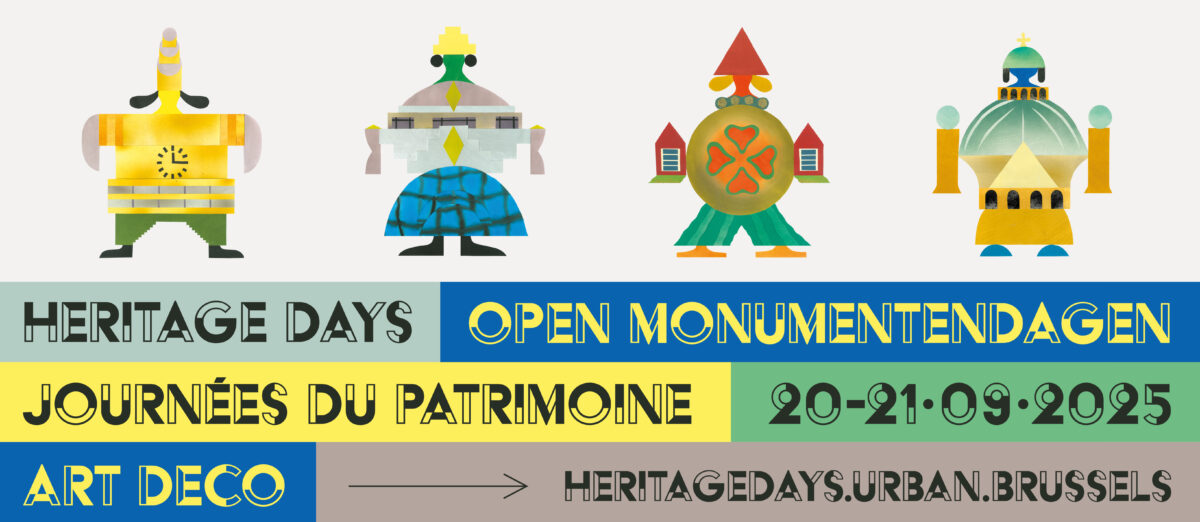
Ce sont les années des projets titanesques à Molenbeek, du percement du métro à l’autoroute urbaine du boulevard Machtens. S’y mêlent la planification urbanistique des administrations et les destructions du patrimoine mais aussi la lutte et la militance de mouvements citoyens dont émerge La Fonderie. Portée par Guido Vanderhulst, dans le sillage d’autres initiatives autour du paysage urbain et du droit à la ville pour tous, elle deviendra un lieu d’actions, de débats et de projets articulant la nécessité de préserver les patrimoines industriels à celle d’en faire des lieux vivants ayant un sens pour les habitants de la ville.
Le 15 septembre, dans le cadre des Heritage Days consacrés aux Nouveaux Patrimoines, nous mettrons le focus sur cette histoire récente qui s’élabore depuis la faillite de la Compagnie des Bronzes, dans le sillage d’autres initiatives autour du paysage urbain, du droit à la ville pour tous et des musées de société.
Trois temps forts jalonneront l’après-midi.
De 14h à 17h, Plus belle ma Ville, un atelier pour les familles dans la halle de coulée
Les participant·es seront invité·es à couler des matériaux divers dont du plâtre coloré et du béton teinté, dans des moules simples. Les modules ainsi réalisés seront ensuite assemblés les uns aux autres pour former des ensembles, des unités d’habitation, des aménagements urbains, à la manière d’un grand jeu de construction collectif. Ainsi, la ville se déploiera au fur et à mesure de l’après-midi sur une grande surface au sol, croisant les réflexions sur ses fonctions, ses usages individuels ou collectifs ainsi que les notions de préservation, de planification, de destruction, de réutilisation ou de construction.
Un atelier animé par Marion Fabien. Plasticienne tout terrain formée aux Beaux Arts d’ Angoulême, à la Cambre et à l’Académie du soir en céramique à Bruxelles ; elle sculpte, observe, arpente, colle, dessine et travaille la ville et les rencontres avec les gens. Marion oscille entre son atelier et les paysages où elle intervient et crée du lien. Elle propose entre autres des ateliers d’art plastique dans les écoles, les musées, les quartiers, la rue…

A 14h, Marche ta Ville, au départ de La Fonderie
Marche ta Ville est une version particulière de notre classique visite consacrée au quartier de la Fonderie au temps où Bruxelles était la deuxième ville la plus industrialisée après Manchester, en Angleterre. Aujourd’hui, nous en faisons une balade insolite qui ouvre des portes habituellement fermées, dévoilant les imbrications du territoire, et intègre témoignages visuels autant que sonores pour arpenter, observer et écouter les places, les rues, les bâtiments, les jardins, les gens… Tout au long du parcours, les marcheurs seront amenés à faire émerger les traces de l’évolution historique, sociologique et économique du quartier, à travers les projets du présent. Au départ de La Fonderie, la balade dessinera une boucle vers le Parc de la Fonderie, aménagé par le bureau René Pechère au début des années 1990 sur un emplacement riche d’un long passé usinier. Claire Gatineau y a capté les sons, les voix, les paroles qui s’y croisent depuis la fête de l’éléphant en juin dernier. Autant de captures sonores qui constitueront le moment fort de la balade, avant de reprendre un chemin inhabituel vers le site de l’ancienne fonderie d’art de la Compagnie des bronzes. Elles racontent, animent les imaginaires et posent la question de l’avenir de ce parc voisin de notre site, discret mais plus présent qu’il n’en a l’air pour les habitants.
Claire Gatineau réalise des documentaires, des fictions et des entretiens sonores en tant qu’auteure indépendante. Habitante du quartier du vieux Molenbeek, elle y a tissé de nombreuses collaborations artistiques, initiatives citoyennes et amitiés. Travaillant aussi dans les domaines du dessin, de la peinture et de l’écriture, elle a réalisé plusieurs créations liées à la commune où elle vit.
A 17h30, La Fonderie du vieux Molenbeek, projection du film suivie d’une rencontre
En 1985, six ans après sa faillite, Marianne Osteaux réalisait un film sur le site de l’ancienne Fonderie, y interrogeant à la fois d’anciens ouvriers et plusieurs porteurs du projet de réaffectation (voire de rénovation) de l’époque. Le film s’ouvre sur le toit percé de la grande halle de l’ancienne fonderie et sur les machines oubliées. On y assiste au sauvetage, souvent rocambolesque, du patrimoine de la Compagnie des Bronzes. On y aborde la nécessité de sauver ce patrimoine unique, grand témoin de la vie ouvrière du Vieux Molenbeek et de Bruxelles. On y questionne le sens de sa préservation face aux enjeux de la ville. On y présente les projets d’alors avec, à l’appui, d’autres expériences de réaffectation et d’expériences muséales dont l’écomusée de l’Avesnois en France. Cette projection sera suivie d’une rencontre-débat, durant laquelle, presque 40 ans plus tard, le projet de la Fonderie sera réenvisagé. La réalisatrice sera présente, ainsi que Marion Alecian pour l’ARAU, Claire Scohier pour l’IEB, Nicolas Navarro, professeur de muséologie à l’université de Liège, et Christine Schaut en tant que sociologue spécialiste de la mise à l’épreuve des politiques de la ville par leurs usager.ère.s.

Le festival Feral est organisé annuellement par le Cifas, lieu d’apprentissage et d’expérimentation pour l’art vivant dans la ville et ses lisières basé à Bruxelles. Feral est le temps fort de la programmation du Cifas. Il porte une réflexion sur les urgences politiques et sociales actuelles et leur prise en main par les artistes. Feral se penche sur l’art vivant dans la ville et ses lisières; il questionne le commun et ses aspérités, l’urbanité et la ruralité, le paysage et l’intimité.
Programme d’interventions et de rencontres artistiques qui vient influer de l’art le quotidien bruxellois, Feral peut s’inviter sur un bateau, aux abattoirs, dans une boutique ou lors d’un carnaval. C’est un festival urbain, interstitiel, périphérique et féral.
Ces 12-13-14 septembre, le festival se tiendra à La Fonderie-Musée bruxellois des industries et du travail (Molenbeek), à La Bellone et le long du canal.

Thématique et programme 2024
Cette année, Feral explore les rituels contemporains comme des leviers de force collective.
On en fait le constat : aujourd’hui tant d’artistes ont recours au rituel dans leur pratique ou le mobilise. Qu’ils soient rituels de soin, de réparation, de passage ou rituels pour la transformation, la lutte et les alliances (on pense bien sûr aux lacs insurgés), ils ont en commun de proposer au public d’autres pactes de connexion et de participation là où le spectacle pourrait en marquer les limites.
Qu’est-ce que le rituel fait à l’art ? ↔ Qu’est-ce que l’art fait au rituel ?
Pourquoi avons-nous besoin de formats qui nous rassemblent autrement ? Qu’est-ce que cela raconte de notre société ? De ses peurs ? De sa mobilisation ?
Aidé·es par une sélection gourmande et attentionnée d’artistes, chercheur·euses, militant·es qui partageront récits, analyses et expériences à vivre, mais aussi en mobilisant nos propres souvenirs, nous vous proposons de partir en traversée.
Nous suivrons une ligne du temps qui ne sépare pas,
Nous nous demanderons si le rite est un outil pour contrer le désenchantement du monde,
Nous célébrerons la terre,
Nous questionnerons le passage de l’intime à l’espace public,
Nous nous demanderons qui a le droit de changer les traditions et le folklore,
Nous nous outillerons pour l’action et la justice sociale,
Nous imaginerons de nouvelles manières d’accueillir,
Nous convoquerons la magie,
Nous ne serons sans doute pas toujours d’accord,
Nous désenvouterons,
Nous attiserons le feu,
Nous mangerons des sandwichs mous,
Nous jouerons de la flûte,
Nous ne serons sûrement pas toujours d’accord.
Et si nous devions inventer un rituel artistique pour la ville, quel serait-il ?
En préambule, Workshop – Laboratoire d’Imagination Insurrectionnelle – 10 et 11 septembre
Comme introduction à Feral, Isa Frémeaux & Jay Jordan du Laboratoire d’Imagination Insurrectionnelle donnent un workshop de Désobéissance Magick. Pendant deux jours, iels exploreront avec les participant·e·s l’utilisation des rituels et de la magie comme outils pour les mouvements sociaux radicaux en lutte contre le capitalisme pétro-patriarcal-colonial.
Deadline pour postuler : 1er septembre, minuit CET
Pour en savoir plus, c’est ici
En parallèle, MolenFest – 12 au 22 septembre
Parallèlement au festival Feral se tient le MolenFest : un programme articulant danse, cirque, théâtre, discussions et cinéma se tenant à la place communale, dans le Quartier Maritime, la rue Manchester, le parc de Ninove et le long du canal pour explorer comment Bruxelles peut devenir une capitale européenne de la culture inclusive et plurielle en 2030.
Le programme est en ligne ici

Depuis plus de 40 ans, La Fonderie développe ses singularités et déploie des actions spécifiques dans le paysage socioculturel, patrimonial et muséal bruxellois. Si La Fonderie est plurielle, c’est que son histoire l’a menée à multiplier ses missions, avec cohérence et en harmonie avec ses valeurs premières.
Aujourd’hui, La Fonderie vit un moment clé : son existence est mise à mal, entre autres, par des difficultés financières et par l’opération gigantesque de sauvetage de ses collections qui devra se faire au risque de perdre tout un pan de l’histoire ouvrière, sociale et industrielle de la capitale.
À travers la programmation de l’été qui arrive, nous vous invitons donc à (ré)expérimenter La Fonderie et ses multiples identités. Nous proposons diverses approches : visiter, arpenter, questionner, mettre en réflexion, jouer, imaginer, cheminer, écouter, ressentir, découvrir, fabriquer, rencontrer… Des chemins parfois détournés nous mèneront d’expériences en expériences.
Nos stages et ateliers nous amènent à explorer différentes techniques artistiques, comme un écho à cette fabuleuse conjugaison des art et industrie qui singularise la Compagnie des Bronzes (1854-1979) dont nous occupons le site de l’ancienne usine.
Une autre résonnance : dès le 10 juillet, l’artiste Nicolas Gutiérrez Muñoz réinterpétera les vestiges de notre site. Ses installations investiront nos ruines et nos anciennes machines, progressivement durant 3 mois. Nicolas utilisera le passage de temps, l’imprévu et le questionnement pour réinventer ses œuvres tout au long de l’exposition.
Les 12, 13 et 14 septembre, le festival Feral prendra ses quartiers à La Fonderie. Organisé par le CIFAS, il interroge et ré-invente notre rapport à la ville en stimulant les pratiques artistiques dans l’espace public. Ici les histoires se confrontent. La Compagnie des Bronzes produisait des statues monumentales, bien souvent dans un objectif de propagande politique au service de l’État. Des années plus tard, à partir de la 2e moitié des années 1970, le Collectif La Fonderie fera partie de ces associations pionnières revendiquant la revitalisation des quartiers meurtris pas la désindustrialisation et abandonnés par les autorités publiques. Que le Cifas ait choisi La Fonderie pour abriter son festival nous touche particulièrement tant il y a du sens à questionner nos rapports à l’espace urbain dans le contexte de ce site.
Le 15 septembre, dans le cadre des Heritage Days, nous mettrons le focus sur notre histoire récente, celle qui s’élabore depuis la faillite de la Compagnie des Bronzes, dans le sillage d’autres initiatives autour du paysage urbain, du droit à la ville pour tous et des musées de société.
Trois temps forts charpenteront la journée. Un atelier pour les familles où chacun.e pourra couler du plâtre, coloré ou non, ou du béton, teinté ou non, dans des moules simples pour ensuite assembler les formes sur une grande surface au sol. La ville miniature se déploiera au fur et à mesure de l’après-midi, croisant les réflexions sur ses fonctions, ses usages individuels ou collectifs ainsi que les notions de préservation, de planification, de destruction ou de construction. En parallèle, une marche particulière au sein du Petit Manchester bruxellois prendra la forme d’une exploration sensitive pour faire émerger les mémoires du quartier. Nous allons arpenter, regarder, ressentir, écouter, imaginer, se laisser surprendre… La journée se terminera par la projection – suivie d’une rencontre-débat – d’une pépite, d’un ovni ou plus simplement d’une archive inestimable : La Fonderie du vieux Molenbeek, un film réalisé par Marianne Osteaux en 1985 sur le site de l’ancienne fonderie de la Compagnie des Bronzes six ans après sa faillite. Elle y interrogeait d’anciens ouvriers et plusieurs porteurs du projet de réaffectation de l’époque. Quanrante ans après cette première aventure, souvent rocambolesque, nous envisagerons nos nouvelles aventures avec quelques acteurs du film, plusieurs intervenants provenant entre autres d’autres associations bruxelloises liées à la préservation du patrimoine et à la réflexion sur les enjeux de la ville tels que l’ARAU et l’IEB. Nous y discuterons de la ville, de ses mobilisations citoyennes, de ses patrimoines et du rôle d’un musée de société tel que le nôtre.

Depuis juillet 2024, l’artiste Nicolas Gutiérrez Muñoz arpente et investit peu à peu le site du Musée de La Fonderie, jadis occupé par une fonderie d’art réputée, la Compagnie des Bronzes. Il y poursuit une expérience artistique évolutive, exploratoire et singulière, inspirée par les histoires, les espaces, les volumes, les matières et les couleurs du lieu.
La notion de vestige et de trace guide le travail de l’artiste depuis plusieurs années. Pour son projet à La Fonderie, il a choisi le titre Le linceul du vieux monde emprunté à la chanson d’Aristide Bruant Les Canuts, ces ouvriers.ères qui tissaient la soie à Lyon, connus.es pour leur révolte de 1831. L’intention de l’artiste est d’évoquer la fermeture du site industriel et, de manière plus large, la condition ouvrière (conditions de travail, désindustrialisation et délocalisation, identité ouvrière…) en utilisant le temps qui transforme ses installations et les fait évoluer pendant toute la durée de sa résidence.

Nicolas travaille au plus près des matières, les associe, collabore avec le temps et le climat, joue avec les transformations que ceux-ci impriment dans la durée sur ses installations. Ses oeuvres laissent le champ libre au détour, au hasard et à la découverte.
Tout au long de ce processus créatif et évolutif initié au début de l’été, Nicolas emballe certaines anciennes machines du site avec des toiles de coton blanc et de la corde rouge. Après plusieurs semaines, il en récupère certaines et les fixe sur des châssis. Les traces d’oxydation et les imprévus liés au passage temps se révèlent sans que l’on ait pu prédire le résultat. Un cube de 6 m3 fabriqué avec du ciment mélangé à du pigment vert faisant référence à l’usure et à un passé révolu vient confronter son volume à ceux des ruines et des machines du site. Des portraits d’ouvriers trouvés dans l’iconothèque de La Fonderie sont transférés sur des petits supports en ciment blanc. Nicolas associe aussi béton, ciment et pigments sur différents supports dispersés sur les ruines.

Ses oeuvres progressives et en évolution ponctuent différents espaces et recoins, offrant au regard des visiteurs des installations imprévues et questionnantes, mais aussi de nouvelles perceptions de notre site usinier.

Vous pouvez suivre le travail de Nicolas en venant et revenant cheminer sur notre site qui se transforme peu à peu. Lors d’un de vos passages, vous aurez peut-être l’occasion de rencontrer l’artiste, de le voir travailler. Nous vous tenons également au courant de l’évolution de ce projet et de ses mutations via nos réseaux.
Le résultat de cette expérience artistique sera visible lors du finissage de l’exposition, le 29 septembre dès 17h :

La Fonderie, située sur le site historique et industriel de l’ancienne Compagnie des Bronzes à Molenbeek, recherche un partenaire pour gérer sa cafétéria. Ce lieu atypique, entouré de friches et d’espaces végétalisés, offre une atmosphère singulière, propice à une expérience Horeca originale.
Le futur partenaire aura l’opportunité de proposer une offre de restauration diversifiée qui s’adapte aux visiteurs du musée et aux habitants du quartier. En plus de cela, il pourra participer à la programmation culturelle du site.
Ce projet représente une occasion unique de s’associer à un lieu patrimonial exceptionnel, tout en collaborant avec des producteurs locaux et en attirant de nouveaux publics.
Plus d’informations dans le lien ci-dessous
Appel à projet – Partenaire Horeca
Mathias Mellaerts – Directeur
mmellaerts@lafonderie.be
Rue Ransfort 27, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

La Fonderie, située sur le site historique et industriel de l’ancienne Compagnie des Bronzes à Molenbeek, recherche un partenaire pour gérer sa cafétéria. Ce lieu atypique, entouré de friches et d’espaces végétalisés, offre une atmosphère singulière, propice à une expérience Horeca originale.
Le futur partenaire aura l’opportunité de proposer une offre de restauration diversifiée qui s’adapte aux visiteurs du musée et aux habitants du quartier. En plus de cela, il pourra participer à la programmation culturelle du site.
Ce projet représente une occasion unique de s’associer à un lieu patrimonial exceptionnel, tout en collaborant avec des producteurs locaux et en attirant de nouveaux publics.
Plus d’informations dans le lien ci-dessous
Appel à projet – Partenaire Horeca
Mathias Mellaerts – Directeur
mmellaerts@lafonderie.be
Rue Ransfort 27, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

“Mon musée de rêve éveillé prend maintenant forme, dans cette publication.
C’est une démarche utopique mais bien ancrée dans le réel, fictive mais pas moins concrète. C’est une tentative destinée à nous faire rêver autant qu’à nous garder éveillés sur nos réalités.
Nous nous sommes demandé : à quoi, à qui sert un musée? Que veut-on réellement mettre en lumière, là, tout de suite, dans la réalité de nos quotidiens?
Alors on a dessiné et discuté, découpé et gommé, retracé au crayon et repassé au feutre avec l’envie d’ouvrir enfin les musées à ceux qui trop souvent n’osent pas y entrer.
Car oui, franchir le seuil d’un musée n’est pas à la portée de tou.te.s. Certain.e.s n’en ont pas les moyens, d’autres pas l’habitude, sans parler de cette peur bien légitime, celle qui nous renvoie à notre propre milieu social. Peur de ne pas comprendre, de ne pas savoir, de ne pas trouver sa place dans cet espace.
Rêver un musée, c’est y penser dans toute sa démesure. C’est imaginer un espace muséal, l’habiller, l’habiter, comme s’il était nôtre. Tout est permis, faites-vous plaisir. Telle était la consigne.
Et si on utilisait le musée pour achever ce que nos vies ont dû mettre un jour de côté?
Ou pour rendre leur juste valeur à celles sans qui les musées, et même toute la société ne tiendrait plus debout?
Et si le musée nous permettait d’agrandir la musique et de nous faufiler dans ses instruments, telles des petites souris? Si on faisait fi des murs des musées pour transformer nos quartiers en lieux d’exposition à l’air libre?
Partant de là, les musées hautains qui sont les cauchemars de certains deviennent les musées de rêve de tout un chacun.”
Texte collectif

« Mon Musée de Rêve », fruit du travail collectif de nos participantes : Claire, Pasqualine, Jennifer et de leur animateur Rémi. Cette publication, onirique, touchante et drôle, interroge le concept de musée et s’intéresse aux moyens de rendre ces endroits accueillants et accessibles.
Infos
Mon Musée de Rêve est en vente à l’accueil du Musée bruxellois des industries et du travail. (8€)
Une fiche pédagogique contenant des pistes d’exploitation de la publication pour les groupes d’adultes est disponible sur demande au Service éducation permanente :
ep@lafonderie.be – 02 413 11 83 – 0499 134 955
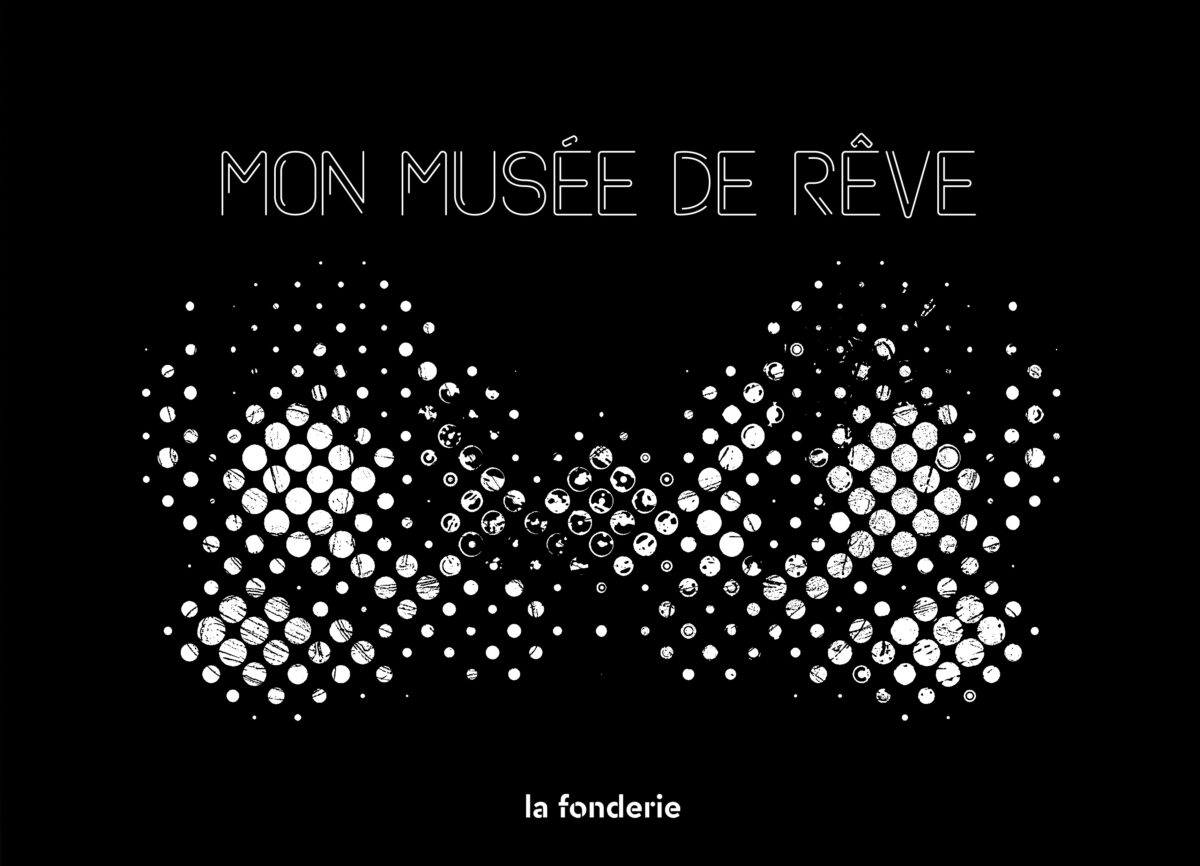
Dans un quartier animé du Vieux Molenbeek, à deux pas de La Fonderie, se niche, le long de la rue de l’Éléphant, le Parc de La Fonderie. L’éléphant (molenbeekois) serait le surnom donné à la gigantesque et bruyante usine de fabrication mécanique Cail et Halot qui occupa le site au 19e siècle. Après la faillite, le site connut différentes fonctions, parfois étonnantes. Au début des années 1970, à l’image de la désindustrialisation qui meurtrit le quartier et ses habitants, il n’est plus qu’une friche. En 1991, grâce au collectif d’habitants et de travailleurs sociaux du Projet Fonderie qui revendique une revitalisation du quartier, le Parc de La Fonderie vient remplacer le terrain vague et offrir un espace vert et tranquille à la population environnante et aux passants.
Depuis l’année passée, les habitants du quartier se réunissent au mois de juin pour investir et fêter leur parc.

En 1839, l’entreprise Derosne et Cail (plus tard Cail et Halot) ouvre ses portes à Molenbeek. L’usine fabriquait des équipements pour sucreries, du matériel ferroviaire, des machines à vapeur… et était surnommée l'”éléphant” en raison de sa taille et du brondissement qui s’en échappait. Après la dissolution de la société Cail et Halot en 1900, le site connaît plusieurs occupations successives (savonnerie, atelier de décoration, chaudronnerie, refuge pour animaux, entrepôt de brasserie…) jusqu’à devenir une friche lorsque s’effondre l’industrie à Bruxelles. À Molenbeek, l’ancien petit Manchester belge, cette histoire est méconnue, mais elle est encore perceptible dans le paysage urbain, le tissu social et la démographie.

En 1905, le vaste site de l’usine fut coupé en deux par la rue de l’Éléphant. Les bâtiments de l’usine furent remplacés, d’un côté, par des immeubles d’habitation en 1978 et, de l’autre côté, par l’actuel Parc de La Fonderie en 1991. L’architecte paysagiste Luc Bazelmans a conçu le parc comme une évocation de l’architecture régulière des jardins français avec sa symétrie, ses lignes géométriques, ses compositions végétales sculpturales… Seuls le portail d’entrée d’origine et le mur d’enceinte de la rue de l’Éléphant ont été conservés et complétés par divers témoins du patrimoine industriel intégrés comme éléments décoratifs (socles, fontaines…) dans une commémoration post-moderne du site historique. Aujourd’hui, le Parc de La Fonderie baigne dans une atmosphère feutrée. Il offre un répit à l’agitation et à la densité de ce qui est redevenu l’un des quartiers résidentiels les plus industrialisés de Bruxelles.
La Fête de l’Éléphant donne l’occasion à des artistes d’interroger le site à partir de sa réalité socio-économique, historique, architecturale et naturelle. Elle est le produit de nombreuses utopies qui ont évolué en même temps que les contextes sociaux, économiques et culturels changeants et dont le caractère local peut être lié à des débats interculturels et transnationaux. Son indéniable rapport au temps permet également d’actualiser les pratiques mémorielles issues de la tradition du monument du 19e siècle et de les relier à des méthodes qui privilégient la participation et le dialogue. L’exposition est une invitation à réaliser des travaux dans les paramètres imprévus et simultanément surréglementés de l’espace public; à formuler des perspectives imaginées, spatiales, critiques et parfois même contrastées comme condition pour remettre en question le statu quo actuel. Cet espace post-industriel qui, au fil du temps, échappe de plus en plus aux désignations et aux fonctions imposées par l’organisme de contrôle, s’y prête bien.

Dans ce doute urbain, les œuvres d’art n’ont pas besoin d’être des propositions d’un avenir meilleur, elles peuvent chercher leur propre parallèle avec le présent. En reliant la notion de “public” au visiteur – un groupe hétérogène d’écoliers, de familles, de personnes âgées, de chiens, de joggeurs, de prétendants et de baigneurs qui se sont déjà appropriés l’espace et ne visitent peut-être pas littéralement les interventions artistiques temporaires, mais en font plutôt l’expérience en se déplaçant parmi elles – l’art, dans toute son autonomie, peut ajouter une narration indispensable. L’exposition ne se veut donc pas impérative, mais entraîne le parc dans une brève et énergique parenthèse où les gens se rencontrent par curiosité pour l’art et pour l’échange social.
Également au programme, des tours guidés, des ateliers pour petits et grands, des performances musicales, des repas conviviaux, des papotes et collectes audio de témoignages, des jeux, de la danse participative… par et pour les habitants et tous les promeneurs curieux.
Programme complet : http://www.fetedelelephant.be/

Une expérience unique à vivre en plein-air sur le site de l’ancienne fonderie d’art avec David Natidze : un artiste à la fois sensible et rigoureux qui, au-delà de sa création personnelle, collabore fréquemment à des chantiers de restauration tels que celui des statues de la Grand-Place ou de la Cathédrale Saint-Michel et Gudule à Bruxelles.

Ce stage s’adresse aussi bien aux débutant.es qu’aux personnes plus expérimentées. Il est conçu pour que chacun.e reçoive une attention et des commentaires personnalisés, tout en abordant les principes fondamentaux de la sculpture et l’utilisation de divers outils, techniques et matériaux. La longue et double expérience de David Natidze en tant que sculpteur et comme restaurateur garantit un apprentissage technique rigoureux tout en favorisant l’expressivité de chacun.e. Chaque participant.e partira d’un bloc de calcaire tendre (pierre de Savonnières – dimensions approximatives 30x20x18 cm) pour réaliser son projet.
| RÉSERVATION |
L’anglais sera la langue de communication principale durant le stage


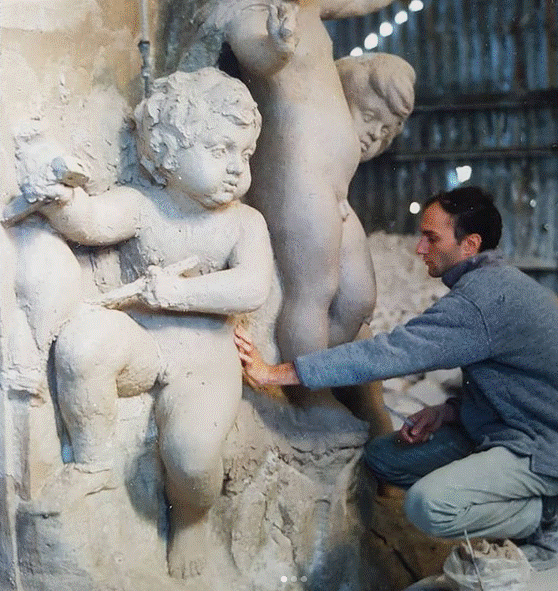
Tout au long de l’été, nos stages se déclineront sur le site de la Fonderie au gré des matières, des techniques et des imaginaires. En parallèle, nous inaugurons une nouvelle proposition : un stage intergénérationnel de 8 jours ou de quelques jours (selon chacun.e) répartis sur tout l’été pour découvrir, avec Marion Fabien, les différentes étapes de la construction d’un four à pain en terre crue. Lors du banquet de la fin des stages, le vendredi 30 aout, nous l’inaugurerons tous ensemble.
Etape 1
Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet
Usine à briques
Chacune de ces journées se présente comme un atelier ouvert où l’on vient apprendre à réaliser des briques en terre crue (un mélange de sable, paille, terre). Il s’agit d’agencer les matériaux, de préparer la terre à la bonne texture et de mouler la brique. Quand les briques seront sèches, la mise en oeuvre du four pourra commencer !
 Etape 2
Etape 2
Mardi 16 et mercredi 17 juillet
Agencement des parois, sole et dôme
Selon quelques calculs précis, on commence par déterminer les mesures du four, afin que le rapport entre sa hauteur et la largeur de la sole lui permette de ne pas se fissurer, craquer ou s’enfumer. Ensuite, il faut préparer le gabarit (en carton ou bois fin) du dôme et déterminer l’emplacement et les dimensions de la porte. Une fois les différents matériaux préparés, on réalise la sole en briques réfractaires (découpe, ajustement, placement) ainsi que le dôme de sable et la voûte en terre, sable et paille. Sur cette structure, on disposera et maçonnera les briques. Encore une fois, la mise en oeuvre réalisée, on est parti pour une période de séchage !
Etape 3
Samedi 24 août : finissage du four. Réalisation de la dernière couche de terre et finition de la forme extérieure, maçonnage. Enlevage de la butte de terre et découverte de la voûte intérieure. Un enduit final d’argile avec décor personnifié (pochoirs et empreintes) constituera la dernière couche du four, la touche finale ! Petit feu (préchauffage du four)
Lundi 26 août : réalisation de petits trophées et totems sur briques. Lors des premières étapes de juillet, mus par une énergie débordante, nous avons fabriqué trop de briques. Nous allons en faire des trophées : pochoirs et travail à l’engobe de terre rouge.
Petit feu (préchauffage du four)

Banquet final
Vendredi 30 août
Préparation du banquet : pâtes et croûte diverses
Nous passerons joyeusement la journée à parler de cuisine et à préparer les mets du banquet. À 18h, le four sera prêt ; chacun.e sera amené.e à cuire pain, pâtes et aliments en croûte de terre, pour partager ce dernier moment de la saison 2024 des stages estivaux.
Le four entamera ensuite une longue vie à la Fonderie ! Nous le voulions pour créer des moments particuliers et conviviaux et pour nous rapprocher du sens qu’avait la production du pain au sein des coopératives du monde ouvrier. Nous sommes déjà en train d’imaginer beaucoup de choses. Nous vous en reparlerons !
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| INSCRIPTIONS |


Mais pourquoi donc porter du bleu pour travailler ? Et pourquoi les rayures horizontales bleues et blanches de la marinière nous embarquent immédiatement aux lointains horizons à bord d’un voilier, ou plus simplement au bord d’une plage ? Beaucoup de nos vêtements proviennent du monde du travail. Nous les avons adoptés, nous les aimons même, comme ces bonnes vieilles salopettes en toile bleue ! C’est la révolution industrielle qui amène la conception du vêtement de travail. Au début il s’agit d’une blouse grise ou noire pour se protéger des salissures. Ensuite ce sera une veste et un pantalon bleus à la fois solides, confortables, facilement lavables et avec des poches pour ranger les outils. Progressivement, le bleu symbolise le monde ouvrier ; avec Aurore Brun, les enfants en décortiqueront les nuances et les filiations avec le monde du travail, au travers de quelques techniques artistiques dont le dessin de mode.
Styliste, modéliste et designer maille, Aurore Brun anime depuis longtemps des ateliers et stages textile pour enfants pour diverses associations, dont Robin Hook. Elle est également chargée de projet à Cyclup, la ressourcerie/centre de tri du CPAS de Bruxelles, rue Haute : un projet d’insertion socioprofessionnelle de récolte de dons de vêtements, à la fois créatif, zéro déchet et inscrit dans une démarche d’économie circulaire.

La Fonderie vous propose de couler votre sculpture en bronze selon la technique de la fonte au sable. Vous avez réalisé un modèle de fonderie en plâtre, en bois, en plastique ou dans un autre matériau et vous souhaitez le couler en bronze ? Au cours de cette journée, vous réalisez votre moule en sable à La Fonderie et vous coulez votre brut de coulée.
Chaque participant réalise un (seul) moule à partir d’un ou plusieurs châssis. La Fonderie met à votre disposition deux formats de châssis :
Pour comprendre les possibilités et les contraintes de cette technique, référez-vous au vadémécum du stagiaire pour le bas-relief ou le vadémécum pour le volume plein.
| RÉSERVATION |


La Fonderie vous propose de couler votre sculpture en bronze selon la technique de la fonte au sable. Vous avez réalisé un modèle de fonderie en plâtre, en bois, en plastique ou dans un autre matériau et vous souhaitez le couler en bronze ? Au cours de cette journée, vous réalisez votre moule en sable à La Fonderie et vous coulez votre pièce.
Chaque participant réalise un (seul) moule à partir d’un ou plusieurs châssis. La Fonderie met à votre disposition deux formats de châssis :
Pour comprendre les possibilités et les contraintes de cette technique, référez-vous au vadémécum du stagiaire pour le bas-relief ou le vadémécum pour le volume plein.
| RÉSERVATION |


Envie de façonner un bijou en argent fin selon les techniques traditionnelles des bijoutiers touaregs ?
Cette journée d’initiation à la bijouterie mais aussi d’immersion dans la culture touarègue, est l’occasion de découper, peser, fondre, couler, frapper, recuire, poinçonner, limer et polir l’argent fin pour créer votre bijou unique : des boucles d’oreille ou une bague. Au terme de la journée, nous prendrons le thé.

Originaire d’Agadez, au Niger, Mohamed Ajidar est issu d’une longue lignée de bijoutiers. Formé dans l’atelier familial depuis l’âge de 8 ans, la bijouterie est pour lui une seconde nature. Il appartient à la communauté Inadan, terme employé pour désigner les artisans touaregs qui travaillent le bois, le métal et le cuivre.
Sandrine Liégeois a cheminé à travers différentes académies, dans des ateliers de peinture, de dessin, de céramique et de techniques pluridisciplinaires. Psychologue, elle anime des ateliers créatifs et groupes de parole dans un planning familial. Elle est co-fondatrice et présidente de l’asbl Strong Together qui soutient des projets Nord/Sud.
| COMPLET |

Découvrez l’art de la passementerie éco-responsable dans cet atelier d’un jour. On y plonge dans l’artisanat en recourant à des matériaux recyclés pour créer des bordures, des tresses et des pompons élégants.
Un voyage à la fois fantaisiste, pratique et familier, où la créativité rencontre le savoir-faire artisanal et se conjugue à la durabilité pour des décorations uniques et intemporelles.
| COMPLET |

En avant pour une exploration sensible du musée à travers la découverte de techniques d’impression ludiques ! Nous partirons de l’observation de la collection de la Fonderie, ses machines et ses objets, ses cartes et ses mécanismes, afin d’identifier ce qui nous inspire et nous touche. Nous jouerons ensuite à en extraire des images pour les déployer à travers trois techniques d’impression : la gravure sur gomme, la gravure sur tetrapak et le cyanotype.
| RÉSERVER |
La gravure sur gomme permet de créer des tampons. L’encrage et les impressions multiples permettent de jouer avec subtilité de ce médium facile d’accès.
La gravure sur tetrapak est une technique de gravure en taille douce qui permet de travailler les détails et de réaliser des impressions délicates.
Le cyanoptype est un procédé photographique ancien grâce auquel on obtient des images en négatif bleu de Prusse. Cette technique initie au procédé « magique » de la photographie et offre un résultat immédiat.
L’imagination et la créativité des participant.es sont conviés ! Trois jours graphiques entre images et imaginaires du musée, au bout desquels chacun.e repart avec ses productions et les connaissances techniques suffisantes pour reproduire les procédés d’impression chez soi.
| RÉSERVER |

Une journée particulière qui célèbre le patrimoine à travers des travaux d’aiguille. Les participants s’immergeront dans le monde diversifié des techniques de broderie, chaque point tissant une histoire inspirée des traditions culturelles.
De dessins simples en motifs intemporels, cet atelier croise l’apprentissage de points et gestes et la beauté des savoir-faire transmis de génération en génération. On y explore comment, grâce à la broderie, transformer, garder, upcycler, rehausser et singulariser nos textiles ; chaque point contribuant à la réutilisation et au renouvellement du tissu ! Avec Luisa, la finesse du point s’installe dans nos vies quotidiennes.
| RÉSERVATION |


Envie de façonner un bijou en argent fin selon les techniques traditionnelles des bijoutiers touaregs ?
Cette journée d’initiation à la bijouterie mais aussi d’immersion dans la culture touarègue, est l’occasion de découper, peser, fondre, couler, frapper, recuire, poinçonner, limer et polir l’argent fin pour créer votre bijou unique : des boucles d’oreille ou une bague.
| COMPLET |
Au terme de la journée, nous prendrons le thé.

Originaire d’Agadez, au Niger, Mohamed Ajidar est issu d’une longue lignée de bijoutiers. Formé dans l’atelier familial depuis l’âge de 8 ans, la bijouterie est pour lui une seconde nature. Il appartient à la communauté Inadan, terme employé pour désigner les artisans touaregs qui travaillent le bois, le métal et le cuivre.

Sandrine Liégeois a cheminé à travers différentes académies, dans des ateliers de peinture, de dessin, de céramique et de techniques pluridisciplinaires. Psychologue, elle anime des ateliers créatifs et groupes de parole dans un planning familial. Elle est co-fondatrice et présidente de l’asbl Strong Together qui soutient des projets Nord/Sud.
| RÉSERVATION |

Pour la première fois, nous nous associons avec les Jeunesses Musicales de Bruxelles pour faire vibrer le site de la Fonderie avec des enfants !

Au cours d’une fabuleuse semaine de découverte, les enfants seront amenés à rencontrer différents musiciens. Ceux-ci leur présenteront leur instrument, leurs pratiques, leurs gestes et leur relation à la musique et à leur métier. Afin d’explorer les sons et de mieux comprendre comment fonctionnent les instruments, les enfants exploreront les ressources de la Fonderie et s’appuieront sur l’imaginaire que ce lieu magique, son histoire et ses machines suscitent pour fabriquer à leur tour des instruments et les faire résonner.

FR 🚲 Un atelier repair café vous permettra de dépoussiérer votre vieux vélo. Quelques réparations, et hop, vous pourrez enfourcher votre bolide plus rapide qu’un avion à réaction !

📅 𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗘𝗥 : 11h à 22h
🤑 𝗧𝗔𝗥𝗜𝗙𝗦 : Brunch à définir €
activités : gratuites
📍 𝗟𝗜𝗘𝗨 : Rue Ransfort 27 à La Fonderie
👨🏻🤝👨🏻 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘́ : Familial, mais tout le monde est le bienvenu
𝗔𝗖𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗘́𝗦
12h à 16h Atelier percussions et capoeira
11h – 12h Yoga
16h30 – 17h30 Concert de Sarah Carlier
www.instagram.com/sarahcarlierofficiel/
14h – 17h Atelier repair vélo DIY
Visite à vélo :
Départ de La Fonderie à 15h et 17h
Lien de réservation de votre visite en vélo
15h : http://lafonderie.qweekle.com/…/parcours-velo-fete-du…
17h : http://lafonderie.qweekle.com/…/parcours-velo-fete-du…
Brunch
Jeux pour enfants
Chateau gonflable
Ventes des fameux cahiers de La Fonderie
NL Deze woensdag 1 mei, kom brunchen in onze tuin en ontspan in de zon met een goede Brusselse Binche en vrienden, terwijl je je kinderen laat spelen in het springkasteel, trommelen, capoeira dansen of molkky spelen. 🎵😋
🚲 Een repair café workshop stelt je in staat om je oude fiets op te knappen. Een paar reparaties en hup, je kunt op je snelle rakker springen sneller dan een straaljager!
📅 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 : 11u tot 22u
🤑 𝗣𝗥𝗜𝗝𝗭𝗘𝗡 : Brunch te bepalen €
activiteiten: gratis
📍 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗧𝗜𝗘: Rue Ransfort 27 in La Fonderie
👨🏻🤝👨🏻 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗘𝗞 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟: Familie, maar iedereen is welkom
𝗔𝗖𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗘𝗜𝗧𝗘𝗡
12u tot 16u Percussie- en capoeira-workshop
10u – 11u Yoga
16u30 – 17u30 Concert van Sarah Carlier www.instagram.com/sarahcarlierofficiel/
14u – 17u DIY fietsreparatieworkshop
Fietsrondleiding:
Vertrek vanaf La Fonderie om 12u, 15u en 17u.
Link naar het reserveren van uw fietsbezoek
12h : http://lafonderie.qweekle.com/…/parcours-velo-fete-du…
15h : http://lafonderie.qweekle.com/…/parcours-velo-fete-du…
17h : http://lafonderie.qweekle.com/…/parcours-velo-fete-du…
Vertrek vanuit La Fonderie om 12u, 15u en 17u Brunch Spelletjes voor kinderen Springkasteel Verkoop van de beroemde notitieboekjes van La Fonderie

La balade aux alentours de la Fonderie est l’occasion d’observer le développement d’un quartier particulier au sein de la ville. L’évolution du logement, entre anciens logis et réaffectations de bâtiments industriels, est le point d’observation principal. De ce grand angle urbanistique, appuyé de cartes, images et outils d’approche, on resserre ensuite le point de vue sur l’architecture. L’articulation entre la forme, la fonction et les techniques des matériaux charpente la lecture des façades. De l’échelle de la ville aux lignes de la façade, les enfants font le lien entre l’urbaniste et l’architecte.
De retour à la Fonderie, ils réalisent ensuite une ville imaginaire sur un plateau 3D. Aménager une ville, c’est l’occasion de croiser les fonctions individuelles ou collectives – habiter, travailler, se détendre, apprendre – avec les modes de déplacement et le cadre de vie. En partant du passé industriel le long du canal de Bruxelles, de ses conséquences urbanistiques et sociales et de la civilisation matérielle qui caractérise nos sociétés depuis les 19e et 20e s, Il s’agit d’un exercice sur les enjeux contemporains de la ville.
Objectifs
Sensibilisation aux enjeux actuels de la ville – apprendre à regarder, décoder et discuter la ville ;
Apprentissage d’un vocabulaire spécifique : technique, architectural, urbanistique, patrimonial ;
Capacité à lire des cartes et des images en relation au quartier visité ;
Capacités de planification, d’imagination et de stratégie pour concevoir un projet de ville répondant à une série de contraintes, critères et objectifs de développement harmonieux, durables et résilients ;
Capacité de travail en équipe et de confrontation des idées ;
Apprentissage par le jeu, la concentration et la collaboration.
Déroulement
Introduction au site de l’ancienne Compagnie des bronzes – et au quartier dans lequel il se trouve : Le petit Manchester belge ;
Balade d’observation, avec outils d’approche ;
Conception en 3D sur un plateau de quatre quartiers en tenant compte de contraintes et caractéristiques (jeu hybride mêlant maquettes et jeux de cartes) et réunion des quartiers en une ville ;
Explicitation et débat sur les développements et enjeux actuels de la ville.

En nous fournissant chaleur, lumière et mouvements divers, différentes sources d’énergie ont donné, au cours de l’aventure humaine, un sacré coup de main à nos énergies musculaires. Au cœur de cette animation, l’histoire des découvertes et de l’exploitation des sources d’énergies se découvre à travers l’observation et la manipulation. S’y inscrivent les notions de durabilité et d’écologie qui nous amènent aujourd’hui à reconsidérer notre rapport au monde. Ainsi, l’exploration de quelques machines, dont la machine à vapeur, se poursuit par celle de l’éolienne et des cellules photovoltaïques. Les énergies renouvelables sont envisagées, dans leur mise en perspective historique, comme alternatives aux sources d’énergies plus polluantes. Le réchauffement climatique et la nécessité d’économies d’énergie sont enfin abordés sous l’angle d’un jeu. Celui-ci explore les petits gestes du quotidien qui permettent de réduire les gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.
Objectifs
– Présentation de La Fonderie et des machines du musée /sensibilisation à l’histoire des sciences et des techniques dans un contexte industriel aujourd’hui muséal ;
– Apprentissage et classement des sources d’énergies / approche de machines élémentaires et de leur fonctionnement de base ;
– Observation et expression autour des résultats des observations ;
– Apprentissage d’un vocabulaire spécifique ;
– Compréhension du réchauffement climatique et de ses impacts sur le contexte de vie / sensibilisation au développement durable ;
– Sensibilisation à l’importance de la recherche scientifique et des nouvelles technologies liées à l’exploitation harmonieuse des ressources naturelles ;
– Apprentissages par le corps, les gestes et la concentration.
Déroulement
– Introduction au site de la Fonderie et aux sources d’énergies utilisées à l’époque du fonctionnement de l’usine ;
– Module participatif autour des sources et des formes d’énergies visant la compréhension de ce que sont les sources renouvelables et non renouvelables ;
– Démonstration du fonctionnement d’un moulin à eau et d’une machine à vapeur ;
– Montage de maquettes permettant d’expérimenter la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables : éoliennes et cellules solaires ;
– Sensibilisation, via un jeu Mémo éco-gestes, aux enjeux liés au réchauffement climatique et à la nécessité de comportements plus sobres et économes en énergies.
L’animation se veut active, rythmée et participative
A destination du cycle supérieur de l’enseignement fondamental
Mémo éco-gestes – Règles du jeu
Mémo éco-gestes – cartes recto verso
Mémo éco-gestes – explications effet de serre
Dossier pédagogique – les énergies renouvelables
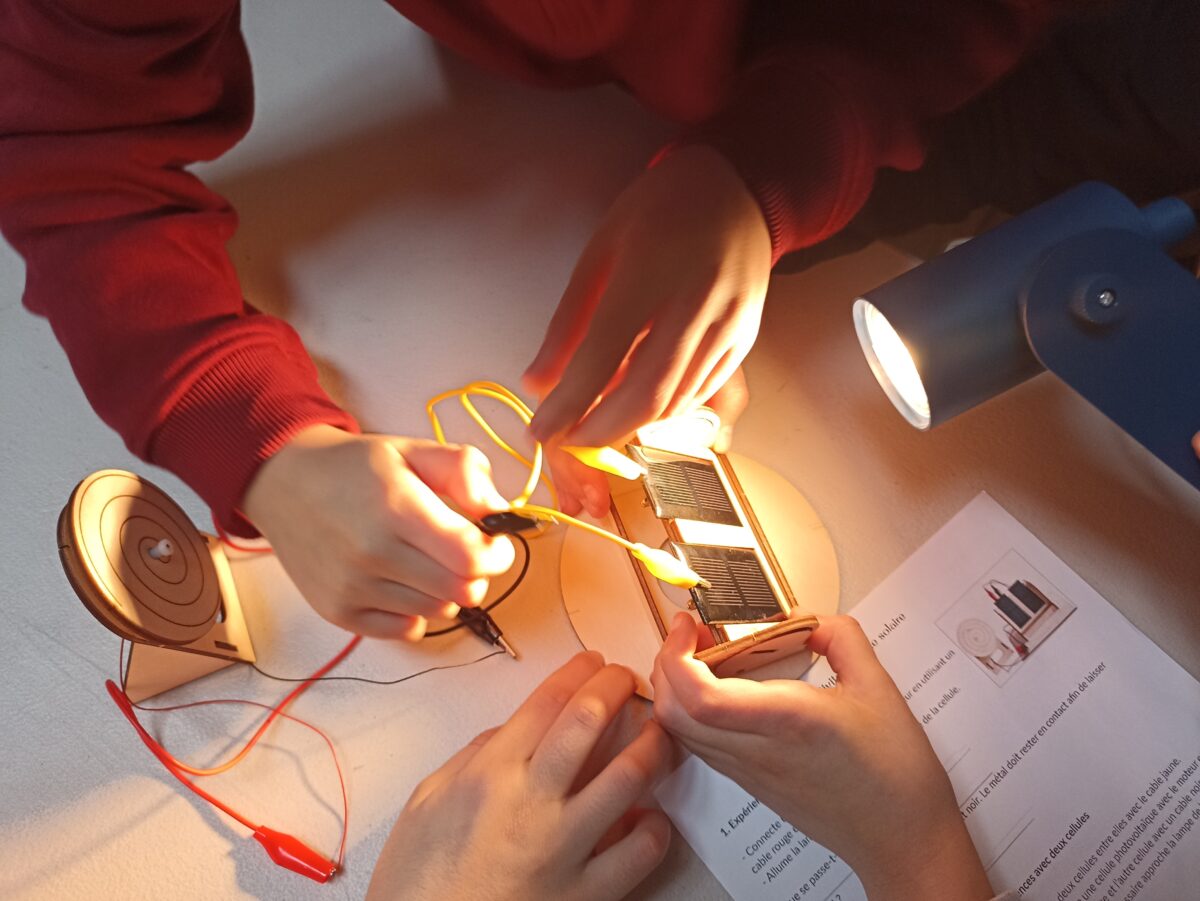
De septembre 2022 à mars 2023, un groupe de personnes porteuses de handicaps et d’accompagnants s’est réuni régulièrement dans les locaux de l’asbl Bataclan.
Les équipes du Bataclan, d’Anaïs, de La Fonderie et Dennis Marien étaient conscients d’innover de trois façons : d’une part en mettant ensemble des personnes porteuses de handicaps très différents les uns des autres, d’autre part en réalisant une BD avec ces personnes et enfin en abordant le thème du handicap dans la recherche d’emploi ou dans la vie professionnelle. A notre connaissance, en Belgique, un tel projet n’a encore jamais été mis sur pied.
Alphonsine, Aziza, Bediaa, Elise, Jihane, Serge et Surya ont d’abord raconté leur histoire, sous l’angle du travail mais pas seulement, sous la forme d’un groupe de parole. Ils.elles ont appris à se connaître et à fonctionner ensemble.
Beaucoup de notes ayant été prises pendant cette étape du groupe de parole, nous avions alors matière à écrire un scénario. Cette écriture a été ponctuée de petits exercices destinés à familiariser les membres du groupe avec le dessin : tout le monde, y compris les personnes qui ne voient pas ou mal, a dessiné.
 Une planche de la BD “Travail et Handicap”
Une planche de la BD “Travail et Handicap”
La réalisation de la BD s’est faite en binômes : chaque personne en situation de handicap a travaillé avec un.e dessinateur.trice professionnel.le valide. Il s’agit là d’un véritable projet inclusif.
L’animateur BD principal, Dennis Marien, toujours en dialogue avec les témoins, a ensuite finalisé la mise en page et la BD est finalement publiée par Vite Editions.
Vous pouvez acheter la publication à l’accueil du Musée bruxellois des industries et du travail (15€).
Le livre est accompagné d’une fiche pédagogique et de pistes d’exploitation pour groupes d’adultes. Vous pouvez recevoir la fiche sur simple demande à abrunelle@lafonderie.be.

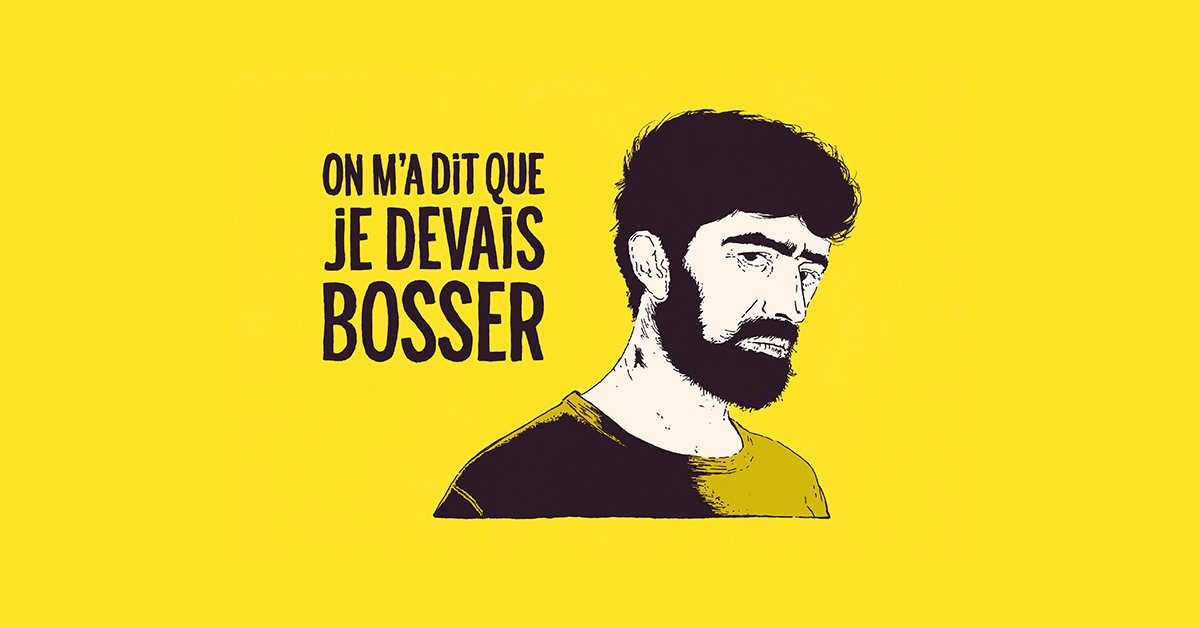
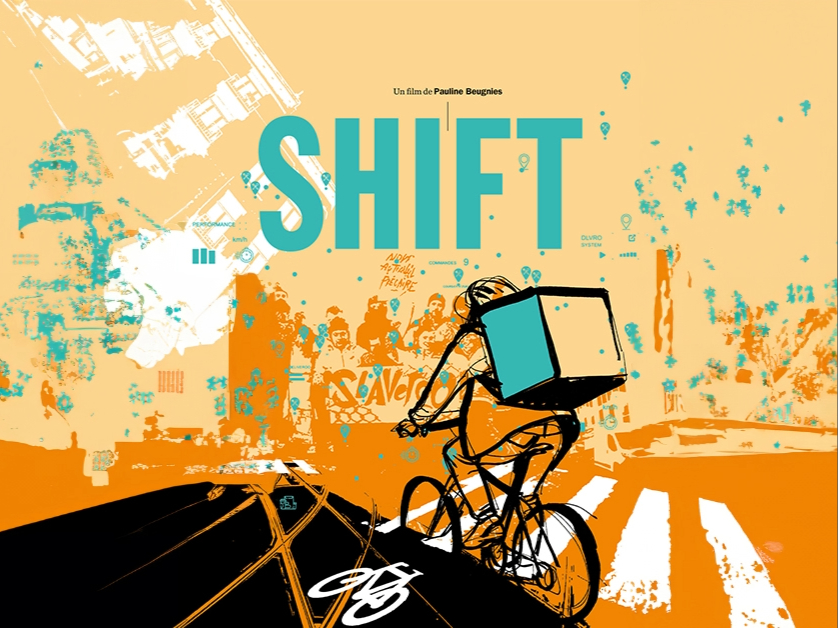
👨🏻🤝👨🏻 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘́ Pour les adultes, bien que tout le monde soit le bienvenu.


![]() 𝗥𝗘𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 : reservation@lafonderie.be
𝗥𝗘𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 : reservation@lafonderie.be
La réservation est souhaitée, mais pas obligatoire.
![]() 𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗘𝗥 : 7 novembre
𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗘𝗥 : 7 novembre
18h : Accueil
18h30 à 19h : Écoute du documentaire radiophonique
19h à 20h : Rencontre-débat
Il est important d’arriver à l’heure afin de ne pas déranger l’écoute des autres auditeur.ices.
![]() 𝗧𝗔𝗥𝗜𝗙𝗦 : 5€ à payer à l’entrée du musée
𝗧𝗔𝗥𝗜𝗙𝗦 : 5€ à payer à l’entrée du musée
![]() 𝗟𝗜𝗘𝗨 : Rue Ransfort 27 à La Fonderie
𝗟𝗜𝗘𝗨 : Rue Ransfort 27 à La Fonderie
👨🏻👩🦰 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘́
Pour les adultes, bien que tout le monde soit le bienvenu.
Dans le cadre de notre nouvelle exposition “Unfree labor”, venez écouter un documentaire radiophonique et participez à une rencontre-débat autour de la transformation de la prison de Forest et de Saint-Gilles en un musée.
Transformons la prison de Forest en un lieu de mémoire, d’histoire, d’ouverture d’esprit et de réflexion critique à l’heure où les différents «Masterplans Prisons» investissent massivement dans la construction de nouvelles prisons, à l’encontre des analyses criminologiques qui mettent en évidence l’impact négatif d’une telle politique.
En 2021, alors que le transfert des détenus de la prison de Forest vers celle d’Haren est décidé, des citoyens, des universitaires et des avocats créent une ASBL nommée 9m2 en référence à la taille d’une cellule. Ensemble, ils lancent le projet de créer dans la prison délaissée un musée et un centre de documentation, d’exposition et de recherche. Cette fermeture, c’est l’opportunité que le lieu devienne un espace de sensibilisation, de réflexion et de débats citoyens sur l’enfermement et le système pénal. Qu’est-ce que cela signifie de priver des personnes de liberté, pour elles et pour l’ensemble de la société ? Qu’est-ce que cela dit de notre société ? Quels liens entre l’histoire de cette prison et celle de la justice belge ?

📅 𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗘𝗥 : jeudi 9 novembre, de 18h à 20h
🤑 𝗧𝗔𝗥𝗜𝗙𝗦 : Gratuit, pas d’inscriptions
📍 𝗟𝗜𝗘𝗨 : Rue Ransfort 27 à La Fonderie
👨🏻🤝👨🏻 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 : tout le monde est le.la bienvenu.e
Cette lecture publique extraordinaire vous fera réfléchir, rire, et peut-être même verser une larme ou deux. Cette soirée mettra en vedette les textes créatifs issus de notre atelier d’écriture sur le cimetière, la mort et nous.

Connaître l’histoire du pays d’accueil sert-il à quelque chose ? Quelle est la valeur ajoutée de toutes ces heures passées dans une salle de classe ? Est-il vraiment possible de résumer 200 ans d’histoire en trois heures ?
Ces doutes sont légitimes. Nous sommes soumis à une course éternelle, et toutes ces réflexions théoriques semblent n’avoir aucune importance pour notre quotidien. Et pourtant, l’histoire se manifeste partout : dans nos habitudes alimentaires, l’urbanisation de nos villes, et les langues parlées par nos voisins…
Comprendre l’histoire du pays permet de créer un nouvel ancrage avec ce lieu, ses habitants, ses coutumes et ses habitudes.
La Fonderie vous invite à un atelier participatif où vous découvrirez les événements fondateurs de l’histoire de la Belgique indépendante. Nous les reconstruirons ensemble et déterminerons les fils conducteurs. Entre autres sujets, nous aborderons l’histoire politique et sociale, l’immigration, la colonisation et les origines de la sécurité sociale.
| COMMANDER VOTRE ATELIER |
Un parcours guidé dans le centre-ville de Bruxelles, intitulé « Bruxelles pour les (s)nuls », constituera un atout pour cet atelier.

![]() 𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗘𝗥 :
𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗘𝗥 :
Toute la soirée : Découverte de notre exposition Unfree Labor disponible gratuitement.
18h30 : Documentaire radiophonique de “Mise au vert et petits oignons”.
![]() 𝗧𝗔𝗥𝗜𝗙𝗦 :
𝗧𝗔𝗥𝗜𝗙𝗦 :
Docu : au chapeau en fonction de vos moyens
Expo : GRATUITE
Quiches : 5 euros
![]() 𝗟𝗜𝗘𝗨 : Rue Ransfort 27 à La Fonderie
𝗟𝗜𝗘𝗨 : Rue Ransfort 27 à La Fonderie
𝗦𝗬𝗡𝗢𝗣𝗦𝗜𝗦
Des prisonniers jardiniers, des potagistes souffrant d’addictions ou maltraité.es par le travail, des « vieux.eilles» à la mémoire défaillante, un aveugle passionné de tomates, livrent leurs rapports sensibles au jardin ; un jardin qui ne peut prendre soin de ses usager.es que si celleux-ci prennent soin de lui. Celleux que certain.es qualifient de différent.es, hors cadre, sont surpris les mains dans la terre, grattant, semant, bêchant. Ces personnages extraordinaires démontrent, avec humour, les bienfaits de l’hortithérapie. Au fil des saisons, iels s’émerveillent de la naissance des jeunes pousses, de la valse des salades, du piquant des piments, de la timidité des tomates ou encore de l’audace du haricot…Avec elleux, laissez-vous bercer par les sons de la nature. Cette mise au vert interpelle ; sommes-nous vraiment traités aux petits oignons ?
𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘́
Pour les adultes, bien que tout le monde soit le bienvenu.
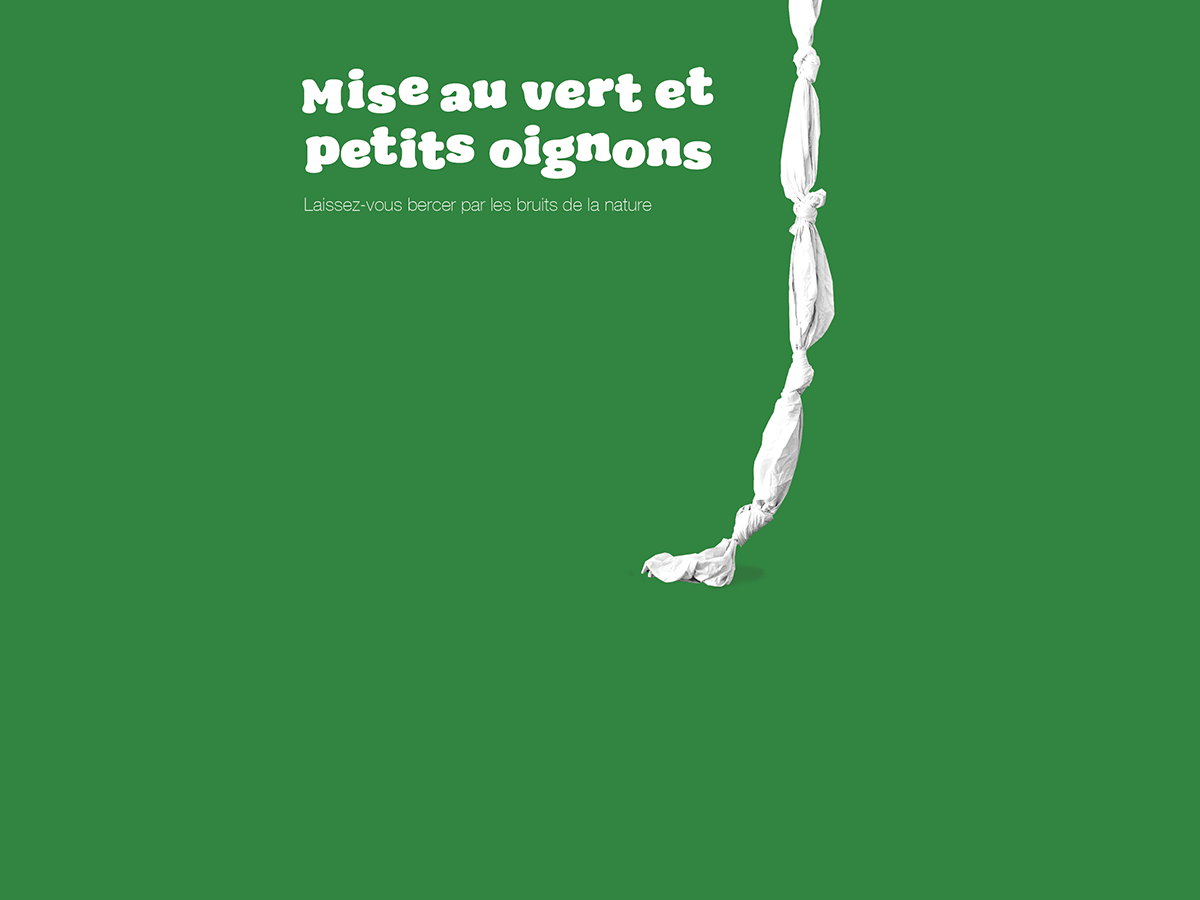
Nous vous invitons à venir écouter quelques-uns de ces textes, parfois lus par leurs auteurs et autrices, lors d’une lecture publique à la guinguette de La Fonderie le jeudi 28 septembre, de 18 à 20h. Vous aurez aussi l’occasion de boire un verre et d’échanger avec les lectrices et les lecteurs.
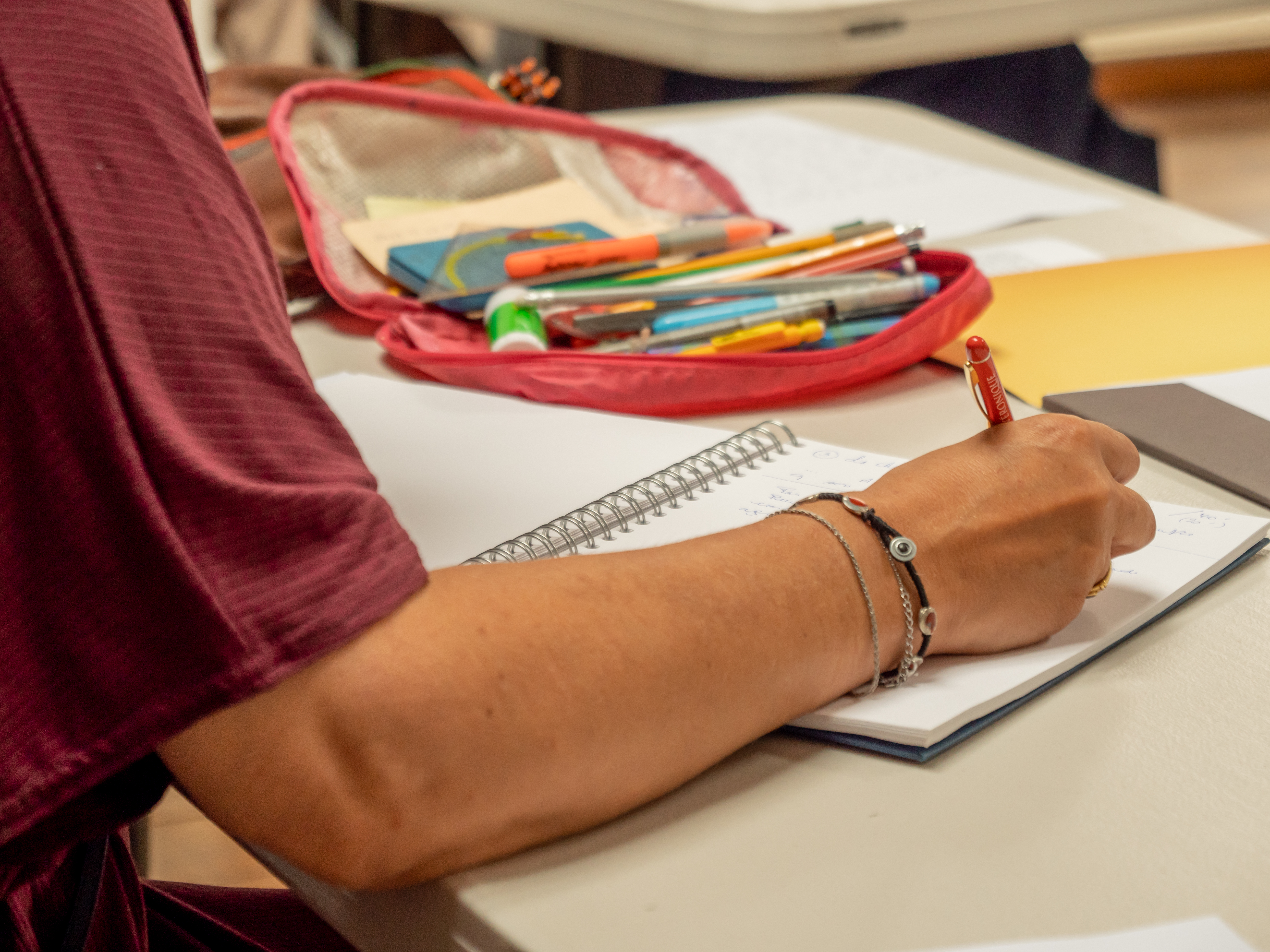
Multicéréales ou l’histoire des céréales à travers les civilisations
D’où viennent les aliments qui constituent notre quotidien alimentaire ? De quels continents proviennent les corn flakes, le café, les carottes ou le melon ? Qu’ils aient été importés chez nous il y a plusieurs siècles ou quelques années, nous consommons aujourd’hui des aliments provenant des quatre coins du monde. Souvent, nous connaissons peu leur origine et leur voyage d’un continent à l’autre. Cette première approche historique met avant tout en lumière la cuisine comme lieu de rencontre des différentes cultures. C’est ensuite la découverte particulière de quatre céréales qui est sur le couvert : le blé, le maïs, le mil et le riz. Un point de départ pour expérimenter la fermentation, la transformation de céréales en farines et réaliser de bons petits gâteaux… à déguster sur le champ !
A destination du cycle supérieur de l’enseignement fondamental

Unfree Labor est une construction collective. Le propos, le choix des contenus et leur traduction scénographique sont le fruit d’une co-construction par des étudiants, leurs enseignants et quatre musées, dont la Fonderie. L’amorce du projet était la question de la limite entre le travail libre et le travail non-libre. Quatre focus ont émergé sur des situations, pour certaines familières pour d’autres moins. A l’instar du processus collaboratif qui a abouti à l’exposition, nous proposons à chaque groupe-classe de progressivement construire et illustrer collectivement un point de vue en confrontant les notions de sens, de choix et de responsabilité liées au fait de travailler pour gagner sa vie. La réalisation de missions dans l’exposition, la découverte de témoignages, le partage d’idées, la mise en situation et la joute verbale permettent de confronter réalités concrètes et textes officiels, rapports de domination et d’exploitation, rôles respectifs dans ces mécanismes et marges de manœuvre vers d’autres formes de travail.
A destination des classes de l’enseignement secondaire

Année de création : 2023
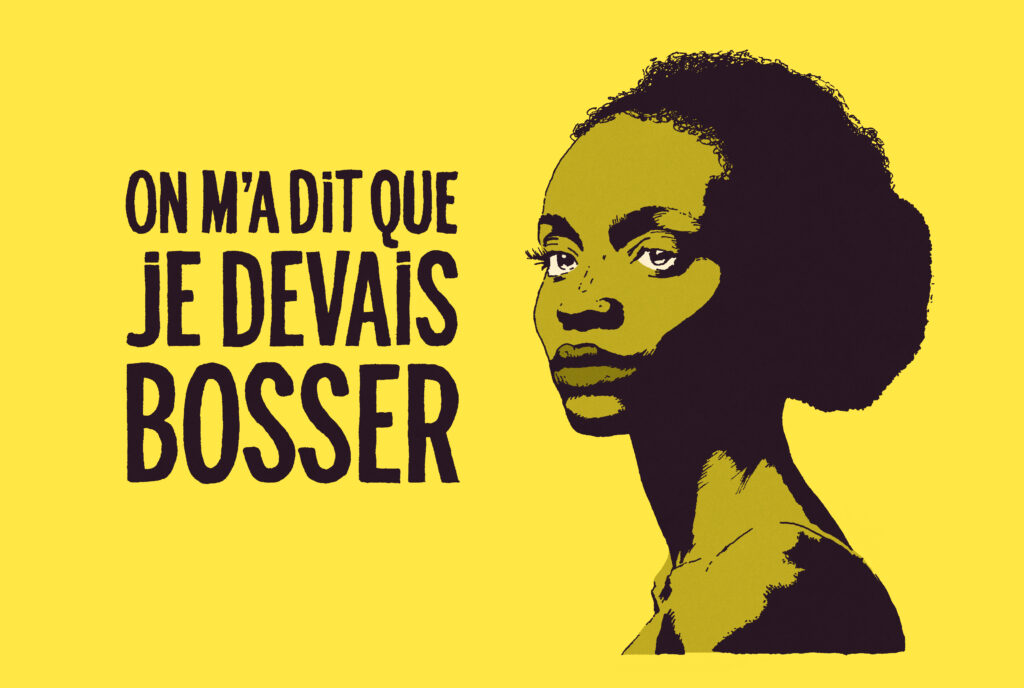
LA DEMARCHE
Saison 1 :
Sortant tout juste des études secondaires ou avec déjà une belle carrière derrière eux.elles, les 9 participant·es au projet On m’a dit que je devais bosser initié par La Fonderie dans le cadre de l’exposition Unfree labor ont réalisé ensemble un podcast. Si aucun·e n’est spécialiste de la question du travail forcé ou non-libre, toutes et tous en ont fait l’expérience, ont un avis et/ou s’interrogent sur ce phénomène.
Après quelques séances de réflexion et débats, soutenu·es par une animatrice en éducation permanente et un réalisateur, ils et elles se sont mis·es au travail – non forcé – pour vous présenter un podcast en plusieurs épisodes mêlant fiction et documentaire et dont les sujets ont été librement choisis.
Le projet a permis d’aborder sous un angle particulier les droits liés au travail. Il encourageait la réflexion des participant·es, la mise à distance et la pratique d’un certain esprit critique.
L’outil produit a les mêmes objectifs et peut servir de support à la réflexion et au débat pour d’autres groupes d’adultes.
Saison 2 :
En 2025, le projet change de thème et aborde le travail d’un point de vue intergénérationnel. 3 générations se sont rencontrées : des jeunes étudiant·es de secondaire, en stage civique à La Fonderie, des personnes en âge de travailler et des seniors de l’ASBL Âges et Transmission.
La place du travail dans nos vies, notre rapport à la consommation et son impact sur l’environnement, le salariat et l’auto-entreprenariat. Voilà les 3 sujets autour desquels ils et elles ont pu échanger afin de réaliser les 3 nouveaux épisodes.
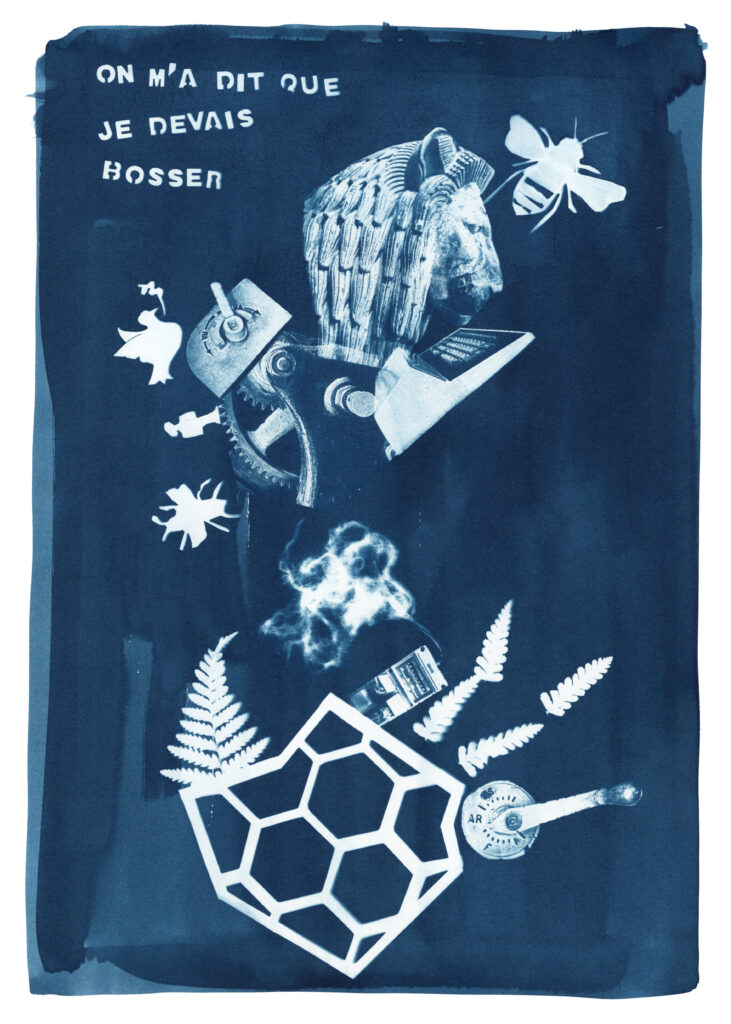
Qui peut utiliser le podcast ?
Les formateurs, animateurs et enseignants travaillant avec des groupes d’adultes.
Avec quel type de public ?
Tout groupe ayant la volonté de débattre sur le sujet du travail, du travail contraint, du travail dans le cadre scolaire obligatoire, du travail des migrant·es ou du burnout.
Avec la saison 2, les sujets de la place du travail dans la vie, la consommation et ses conséquences climatiques, le travail salarié et l’auto-entreprenariat sont également abordables.
Outil en ligne
Écoutez le podcast “On m’a dit que je devais bosser sur Spotify.
Ou écoutez le podcast “On m’a dit que je devais bosser sur Youtube
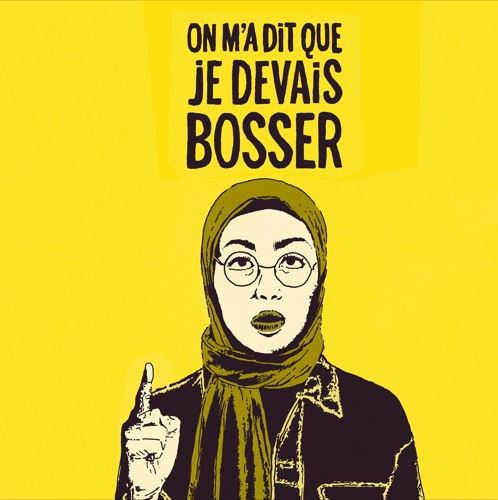
Illustrations par Rémi Desmots.
Un projet du service éducation permanente de La Fonderie. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région Bruxelles-Capitale.
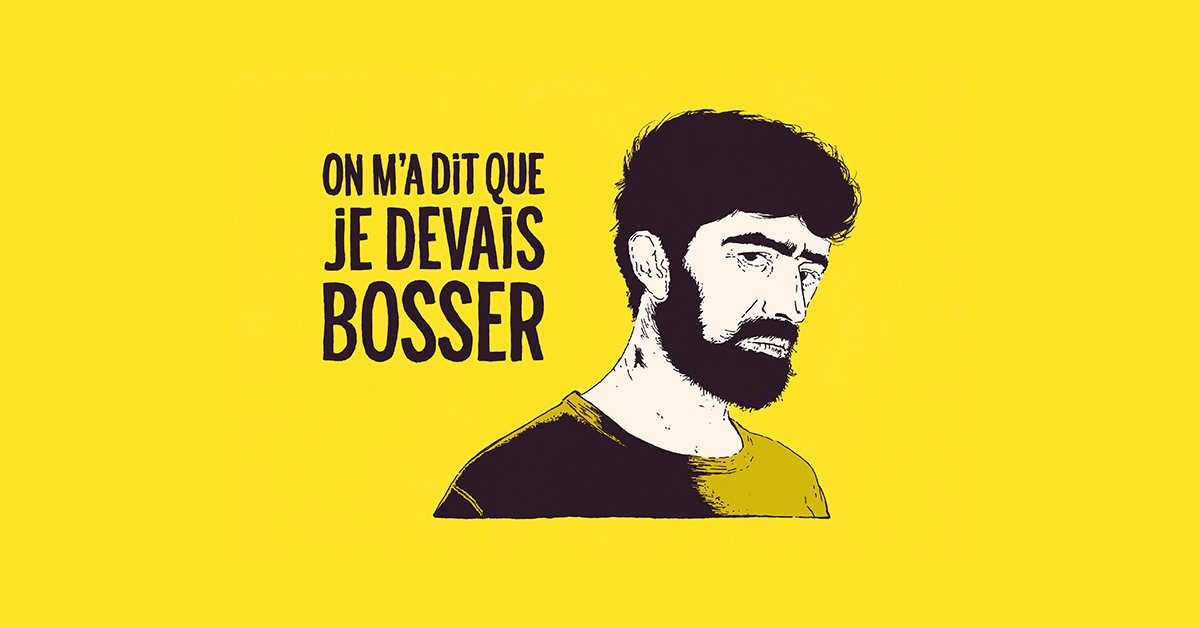
 ® Françoise Gutman réalise une coulée publique 2022
® Françoise Gutman réalise une coulée publique 2022
“Je travaille sur la grandeur et la petitesse, le lisse et le rugueux, les couleurs et le brut, les humains et l’architecture.”
Avec 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗼𝗶𝘀𝗲 𝗚𝘂𝘁𝗺𝗮𝗻, découvrez la technique traditionnelle de la fonte au sable, dans le cadre de l’ancienne Compagnie des Bronzes, une authentique ancienne fonderie d’art. Vous pourrez fabriquer et emporter votre propre objet ou tout simplement profiter du spectacle de la coulée, accompagnés par les rythmes des claviers et de l’accordéon des musiciens de Flygmaskin. Les expositions permanente et temporaire du musée seront ouvertes ainsi que notre guinguette où vous pourrez trouver un peu de réconfort avec un chocolat chaud, un café ou une soupe bien chaude de notre chef Kazimierz. 😊
Flygmaskin vous propose un concert au casque. Ce sera l’occasion de déambuler librement, de flâner dans le lieu tout en profitant des coulées. Le duo invite au voyage vers l’intime, l’art, la poésie, la nature. Et chacun suit à son rythme l’accordéon, le clavier et le silence. Les casques, l’espace, la musique, forment alors le fil où le lieu et le son s’entremêlent, se subliment, et nous incitent à respirer, à prendre le temps de prendre le large…
Et étant donné qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, vous aurez également la possibilité de déguster la délicieuse soupe maison de La Fonderie ! Sans aucun doute, la perspective d’un après-midi particulier, dans un cadre inoubliable.
 ® Halle de coulée à La Fonderie 2023
® Halle de coulée à La Fonderie 2023
Depuis des années, nous croisons Françoise entre deux groupes scolaires, dans un stage ou une journée de formation à La Fonderie. Son animation « les apprentis du métal » est une des activités phares de notre programmation éducative, et Françoise a donné l’occasion à des centaines d’apprentis bronziers, petits ou grands, novices ou spécialistes, de mieux comprendre la magie du travail du bronze. Elle nous a accompagnés avec un grand professionnalisme dans de nombreux projets, que ce soit l’élaboration du module « bronze » de l’exposition permanente ou encore dans la création des pavés qui jalonnent le chemin vers le musée des égouts. Françoise répond toujours « présente » à nos demandes, même pour les projets les plus fous.

Françoise Gutman, c’est qui ?
Sculptrice-Céramiste
Diplômée du « 75 » Bruxelles en céramique (1980) et de l’École supérieure des arts plastiques et visuels de l’état à Mons en sculpture (1985).
Mention au prix de sculpture d’Uccle en 1978 et 2008 et au prix Médiatine en 1987.
Depuis 1982, participe régulièrement à des expositions collectives (Belgique) et personnelles (Belgique, Suisse, France, Turquie).
Animatrice plasticienne aux services pédagogiques de différents musées dont La Fonderie dès 2016 et autres institutions culturelle ou sociale.


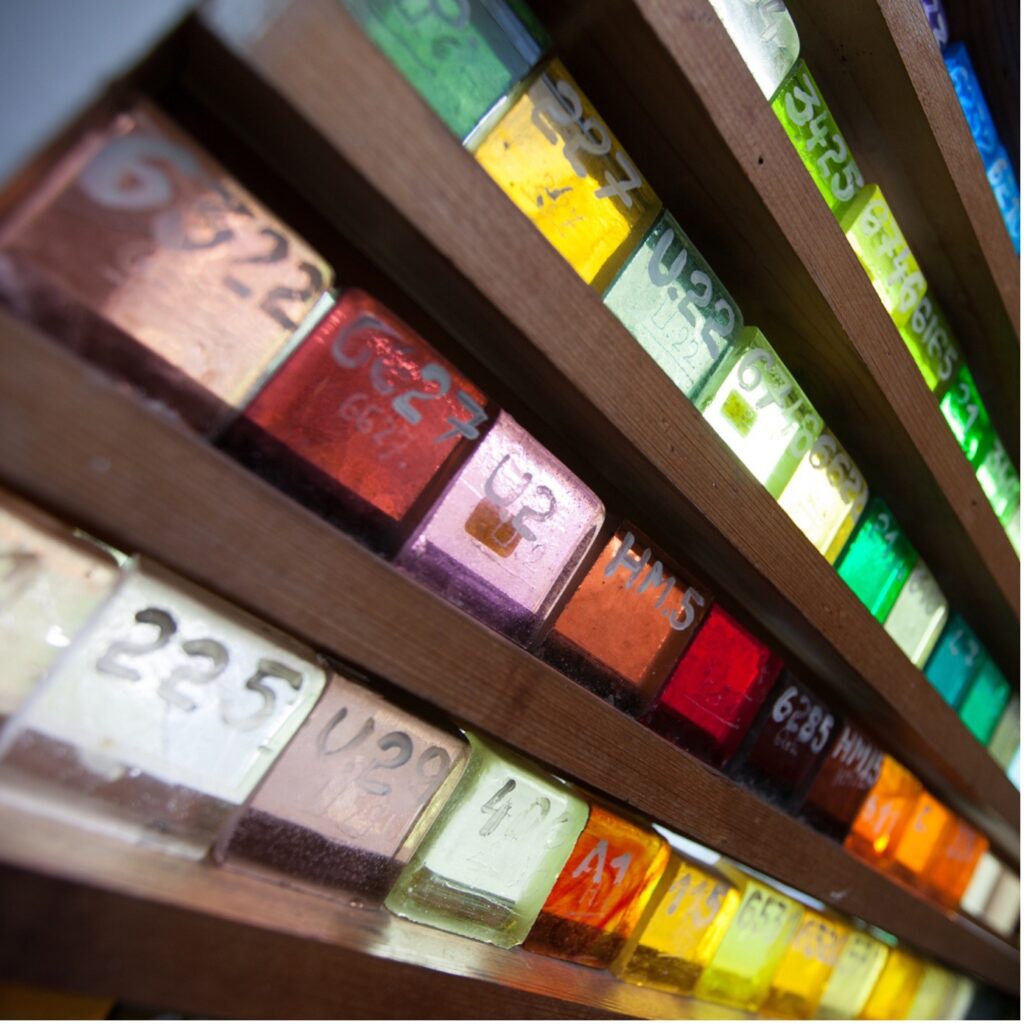
L’activité artisanale se partage entre la création artistique de vitraux contemporains ou traditionnels et la restauration du patrimoine ancien. Utilisé au Moyen Âge dans les églises, les cathédrales et certaines demeures de prestige, le vitrail continue sa lancée, traversant les époques et s’adaptant aux différents styles, effectuant un retour spectaculaire à l’époque Art nouveau puis Art Déco.
https://heritagedays.urban.brussels/en/programme/schaerbeek/versicolore-workshop/
Grâce à son large stock de verres anciens, son expérience éprouvée et sa maîtrise de nombreuses techniques, l’atelier peut donc restaurer à l’identique nombre de verrières ayant subi le ravage des années. Mais la création occupe elle aussi une part importante et qu’il soit figuratif ou abstrait, le vitrail illumine toujours joliment de ses couleurs un bâtiment, qu’il s’agisse d’un restaurant, d’un hôtel de maître, de bureaux ou d’édifices religieux.

 L’Art Nouveau relégué au musée ou dans les bouquins d’art ? ça n’est certainement pas le cas à La Fonderie. Profitez de notre atelier sérigraphique organisé par les élèves de l’école Sainte-Bernadette d’Auderghem pour créer vos tote-bags version mode 1900.
L’Art Nouveau relégué au musée ou dans les bouquins d’art ? ça n’est certainement pas le cas à La Fonderie. Profitez de notre atelier sérigraphique organisé par les élèves de l’école Sainte-Bernadette d’Auderghem pour créer vos tote-bags version mode 1900.
L’atelier a lieu en continu de 13h à 18h ce dimanche et des sacs en toile seront en vente sur place pour 5 euros.
Profitez également de la journée sans voiture pour faire un tour à vélo et visitez l’exposition “Made in brussel” et “Unfree Labor” disponible en ce moment à La Fonderie.

Description de l’outil/du service
Ce dossier invite les groupes à aborder une série de questions, débats et ateliers en utilisant leurs savoirs propres comme base de travail. Il peut être utilisé avant ou après avoir suivi le parcours Bruxelles pour les snuls et, pour une bonne partie des activités proposées, peut même être utilisé tout à fait indépendamment de la visite.
Objectif
Faire émerger des groupes d’utilisateurs un savoir qu’ils seront ensuite amenés à partager et structurer. Aborder une série de questions de société à partir de l’exposition, ou indépendamment de celle-ci.
Année de création 2023
Public
Ce dossier s’adresse aux formateurs, enseignants et groupes d’adultes dans un cadre d’éducation permanente, de formation, d’études…
Comment l’utiliser ?
Le dossier liste et explique une série d’activités à mettre en place avant ou après avoir suivi le parcours. Le temps de réalisation de ces activités peut varier entre deux heures et une année.
Outil/Service en ligne
| TÉLÉCHARGEZ LE DOSSIER |

Description de l’outil
Ce dossier invite les groupes à aborder une série de questions, débats et ateliers en utilisant leurs savoirs propres comme base de travail. Il peut être utilisé avant ou après la visite de l’exposition Unfree labour ou tout à fait indépendamment de l’exposition.
Objectif
Faire émerger des groupes d’utilisateurs un savoir qu’ils seront ensuite amenés à partager et structurer. Aborder une série de questions de société à partir de l’exposition, ou indépendamment de celle-ci.
Année de création
2023
Public
Ce dossier s’adresse aux formateur·ices, enseignant·es et groupes d’adultes dans un cadre d’éducation permanente, de formation, d’études…
La plupart des activités proposées sont tout public mais une activité en particulier est destinée à un public FLE ou alpha.
Comment l’utiliser ?
Le dossier liste et explique une série d’activités à mettre en place autour des thématiques de l’exposition. Le temps de réalisation de ces activités peut varier entre deux heures et une année.
Outil/Service en ligne
| TÉLÉCHARGEZ LE DOSSIER |
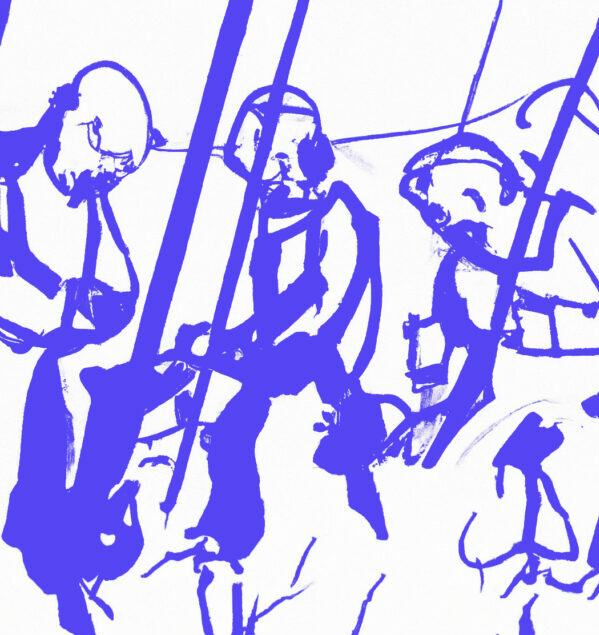
PROGRAMMATION EN COURS DE CONSTRUCTION POUR L’HIVER








Cette visite guidée vous emmène à la découverte du cimetière de Laeken, le plus ancien cimetière bruxellois encore en fonction. La première Reine des Belges, Louise-Marie d’Orléans, avait émis le souhait d’y être enterrée à sa mort en 1850. Elle y sera rejointe quinze ans plus tard par le roi Léopold Ier.
Après cet événement, l’aristocratie et la haute bourgeoisie ont également voulu être enterrées à Laeken. De nombreuses personnalités y reposent. Nombre de chapelles de style néogothique appartiennent à des familles notables du 19e siècle. Pour ne citer que quelques noms : le bourgmestre Volxem, l’architecte Poelaert, la Famille Vaxelaire, la famille Halot (proche des Cail & Halot)… On y trouve également des bronzes remarquables dont l’un des exemplaires du Penseur de Rodin.
| RÉSERVER VOTRE PLACE |

À la Fonderie, Lou Cocody-Valentino propose un atelier de modelage en papier mâché pour les enfants du 14 au 17 aout, entre 14h30 et 16h30. Gratuit, sur inscription : andrea@pali-pali.com
Lou Cocody-Valentino est une artiste basée à Bruxelles. Elle réalise des œuvres et expérimente avec tout ce qu’elle peut recycler : en imprimant des formes sur papier et tissus, en faisant fondre des plastiques, ou encore en sculptant du papier-mâché. 🌻


SYNOPSIS
Lorsque Baby et Charlie se rencontrent, elles ne savent pas encore que leur histoire d’amour fera basculer leurs vies. 7 ans plus tard, Lisa devenue Nicky, s’interroge sur les véritables raisons qui l’ont poussé à en faire un film.


Viens profiter du jardin de la Fonderie durant un gouter électronique par Mosfet Club et de nombreux jeux de la ludothèque d’Anderlecht de 12h à 20h !


Le mardi créatif est un rendez-vous collectif avec soi-même.
… Comment ça ? Et bien il s’agit de se fixer un rendez-vous avec soi-même pour déconnecter de la réalité, du travail, des stress ambiants et prendre le temps de créer.
Et quand on dit créer, on parle de construire, peindre, écrire, mixer, monter… bref créer dans le sens du terme le plus large possible !
Rendez-vous à partir de 19h à la guinguette de la Fonderie ! 😃

On ne change pas une équipe qui gagne, pour la sixième édition de noob night :
Trois Noobers (intervenants) viennent partager leurs aventures, expériences, anecdotes, dans un bar sympa, avec une atmosphère bienveillante et décontractée. Chaque Noober prend la parole pendant 15 minutes, et s’en suit une séance de questions-réponses. Si tu ne prends pas le micro, tu peux juste venir écouter les histoires de Noobers, en sirotant un verre, entouré.e de chouettes personnes !
En français !
Ce vendredi 25 août, revivez la sortie de résidence du collectif Ciné Luso 2023.
L’ensemble des artistes de la résidence présentent, en plein air à la Fonderie, le film qu’ils ont réalisé collectivement en un temps record, en l’espace de trois semaines. Le programme de la soirée s’annonce riche, avec un programme très spécial pour toutes et tous !
Entrée et activités gratuites
Dès l’introduction du chemin de fer en Belgique en 1835, une liaison ferroviaire à travers la capitale fait l’objet de multiples débats. Déjà dans les années 1850, ses premières ébauches sont mises sur la table. Les travaux cependant ne débutent que 50 ans plus tard pour se terminer après la Deuxième Guerre Mondiale. Ce n’est qu’en 1952 que le premier train traverse Bruxelles par la nouvelle Jonction Nord –Midi.
La visite vous invite à parcourir l’histoire fascinante des plus longs travaux publics du centre de la capitale, et à découvrir les effets produits sur le développement de la ville hier et aujourd’hui.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |


Avons-nous toujours la possibilité de choisir notre travail ? Pourquoi certaines catégories de personnes sont-elles susceptibles d’être reléguées dans des emplois de seconde zone ? Sommes-nous invariablement déterminés à contribuer à un marché de l’emploi inégalitaire ou avons-nous, comme consommateur, la possibilité d’un choix ?
L’article 23 de la Déclaration universelle stipule : « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Toute personne, sans aucune discrimination, a droit à un salaire égal pour un travail égal ».
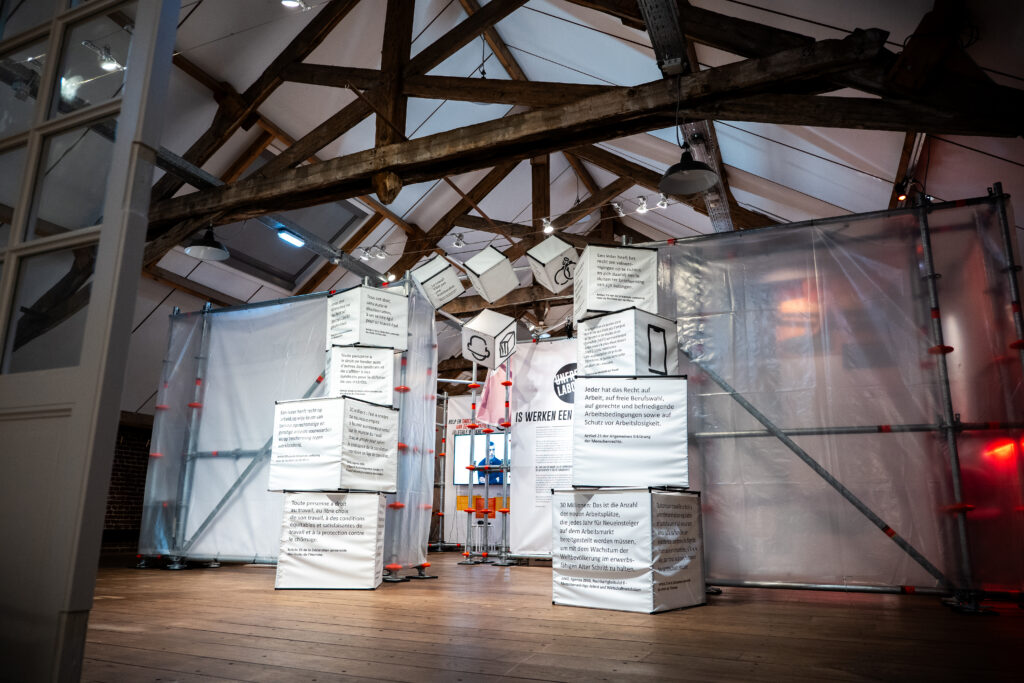
L’exposition « Unfree Labor » nous invite à explorer la transition floue entre un travail libre et non libre. Loin d’être cantonné à des périodes les plus noires de notre histoire récente, le travail contraint demeure aujourd’hui encore une réalité. Les visiteurs y apprendront que l’absence de choix implique inévitablement une relation de dominance-subordination.

Que signifie véritablement la notion de choix pour les travailleurs du 21e siècle ?
« Unfree Labor” est une exposition engagée qui invite les visiteurs à réfléchir et à prendre position sur des situations vécues aujourd’hui en Allemagne, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Dans nos pays riches et dits démocratiques, quelle est notre marge de liberté en prenant un emploi ? Dans quelle mesure la coercition économique, juridique ou émotionnelle pousse-t-elle une personne à accepter un travail pouvant présenter des conditions injustes ?
Allemagne, Belgique, Luxembourg : trois pays si proches, mais aussi parfois très différents dans leurs rapports à l’emploi. A travers le cas des livreurs à vélo, des travailleurs domestiques, des abattoirs, du travail du sexe sur internet ou du travail carcéral, cette exposition nous propose de réfléchir aux réalités vécues par nombre de travailleurs précarisés.
A qui profite ce système ? Quels en sont les effets sur les personnes concernées ? Et comment promouvoir un travail plus équitable ?
« Unfree Labor » est une exposition qui informe mais pose aussi beaucoup de questions qui dérangent. Elle souhaite aider le visiteur à mieux comprendre ce monde du travail que nous partageons.
L’exposition est également le résultat d’une démarche active d’étudiants d’universités et d’établissements supérieurs de ces trois pays et qui apporte un regard novateur et inédit de la jeune génération sur des questions sociétales.
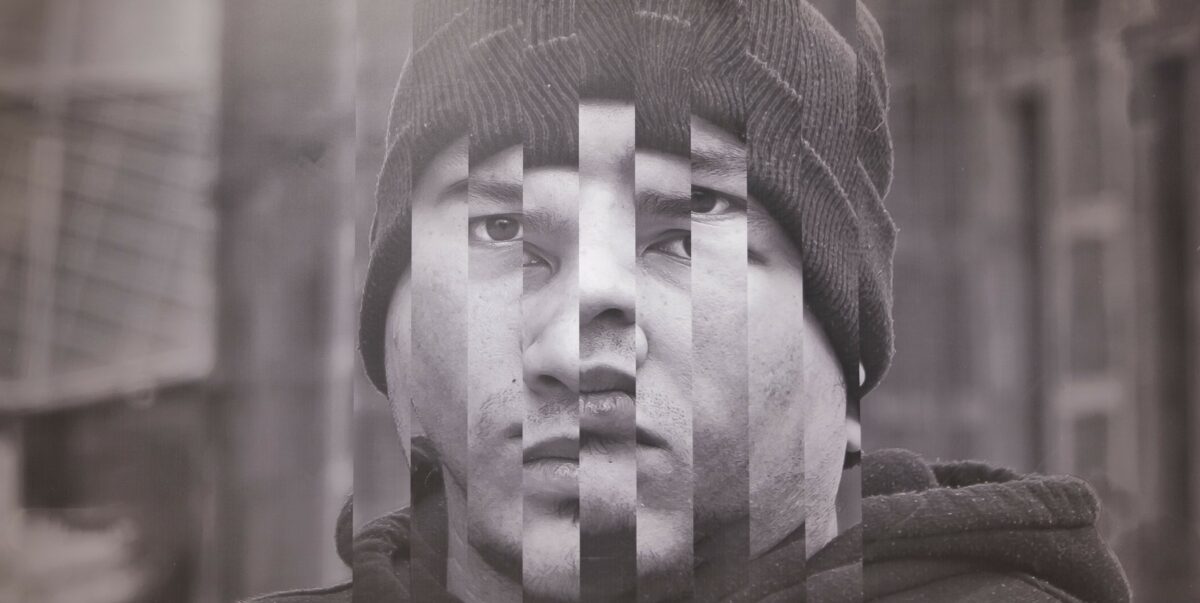

| RÉSERVER VOTRE TICKET |
Avons-nous toujours la possibilité de choisir notre travail ? Pourquoi certaines catégories de personnes sont-elles susceptibles d’être reléguées dans des emplois de seconde zone ? Sommes-nous invariablement déterminés à contribuer à un marché de l’emploi inégalitaire ou avons-nous, comme consommateur, la possibilité d’un choix ?
L’article 23 de la Déclaration universelle stipule : « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Toute personne, sans aucune discrimination, a droit à un salaire égal pour un travail égal ».
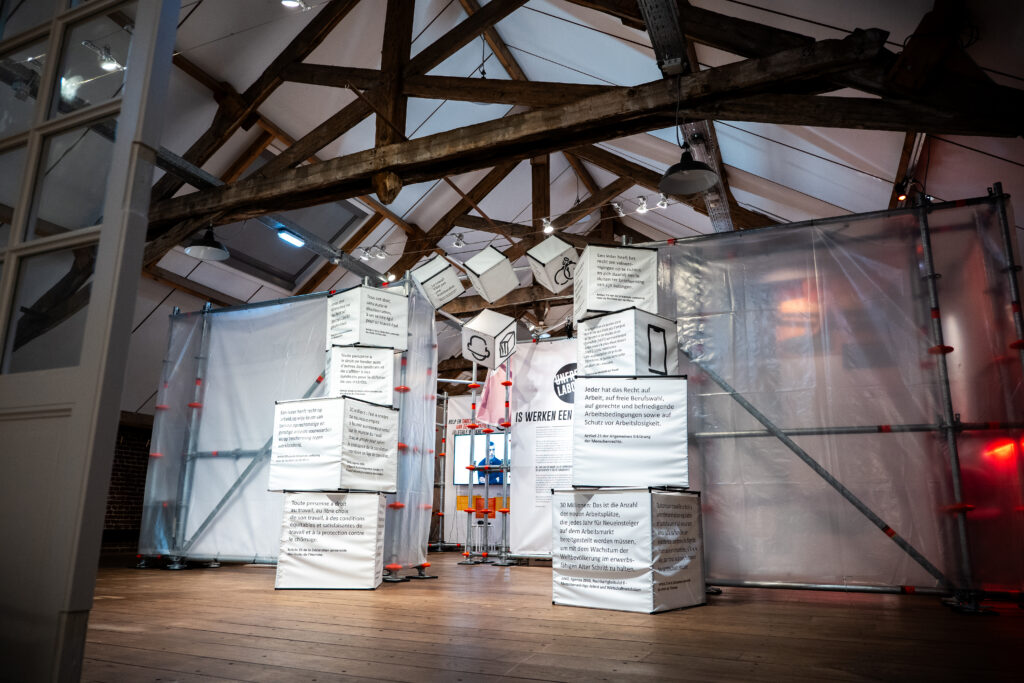
L’exposition « Unfree Labor » nous invite à explorer la transition floue entre un travail libre et non libre. Loin d’être cantonné à des périodes les plus noires de notre histoire récente, le travail contraint demeure aujourd’hui encore une réalité. Les visiteurs y apprendront que l’absence de choix implique inévitablement une relation de dominance-subordination.

Que signifie véritablement la notion de choix pour les travailleurs du 21e siècle ?
« Unfree Labor” est une exposition engagée qui invite les visiteurs à réfléchir et à prendre position sur des situations vécues aujourd’hui en Allemagne, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Dans nos pays riches et dits démocratiques, quelle est notre marge de liberté en prenant un emploi ? Dans quelle mesure la coercition économique, juridique ou émotionnelle pousse-t-elle une personne à accepter un travail pouvant présenter des conditions injustes ?
Allemagne, Belgique, Luxembourg : trois pays si proches, mais aussi parfois très différents dans leurs rapports à l’emploi. A travers le cas des livreurs à vélo, des travailleurs domestiques, des abattoirs, du travail du sexe sur internet ou du travail carcéral, cette exposition nous propose de réfléchir aux réalités vécues par nombre de travailleurs précarisés.
A qui profite ce système ? Quels en sont les effets sur les personnes concernées ? Et comment promouvoir un travail plus équitable ?
« Unfree Labor » est une exposition qui informe mais pose aussi beaucoup de questions qui dérangent. Elle souhaite aider le visiteur à mieux comprendre ce monde du travail que nous partageons.
L’exposition est également le résultat d’une démarche active d’étudiants d’universités et d’établissements supérieurs de ces trois pays et qui apporte un regard novateur et inédit de la jeune génération sur des questions sociétales.
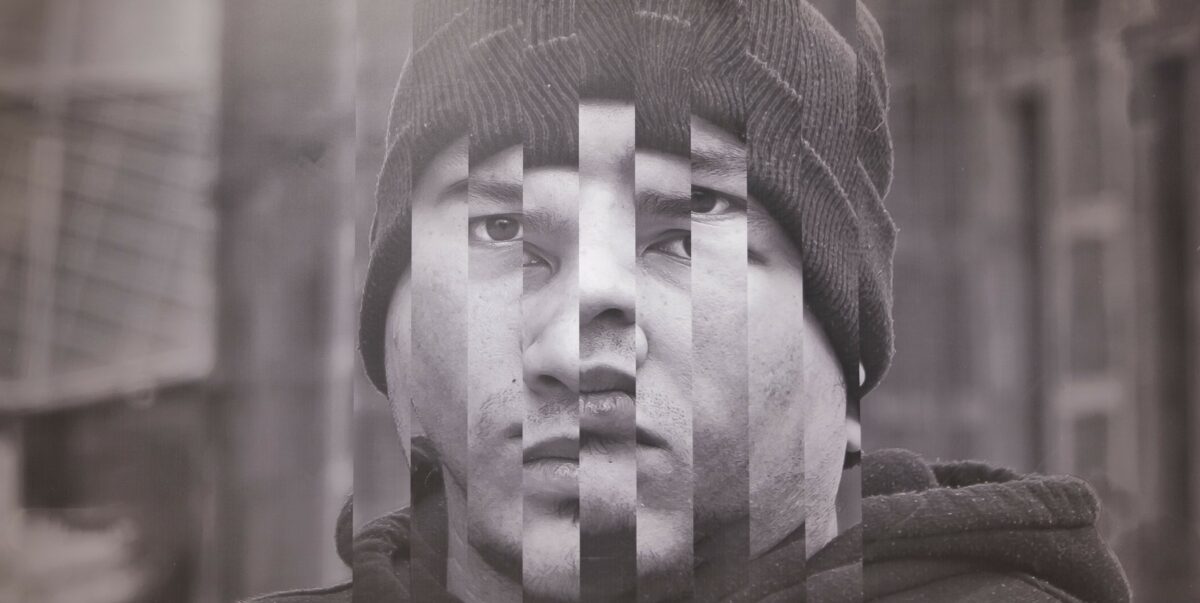

Que nous ayons un emploi ou que nous n’en ayons pas, que nous soyons jeunes ou que nous soyons âgés, que ce soit à l’école ou à l’usine, que ce soit par choix ou par nécessité… nous travaillons tous. Rejoignez-nous pour écrire votre travail.

La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail s’intéresse à toutes les formes du travail. Nous vous proposons un atelier d’écriture pour explorer le travail sous toutes ses coutures. Nul besoin d’être une grande écrivaine, un prof de français ou un·e petit·e génie de l’orthographe. L’envie d’écrire est la seule condition pour participer.
Venez écrire votre travail avec nous. Aidez-nous à documenter le monde du travail…
Le projet Une vie de labeur dispose de son propre site internet. Vous pouvez y retrouver des textes écrits par les participants. Consultez-le en cliquant ici.
Publics
À partir de 16 ans
Ateliers en soirée 2026 – Une vie de labeur
Les lundis, de 18h30 à 20h30 : 16 + 23 + 30 mars + 20 avril + 11 et 18 mai + 1 + 8 + 15 juin.
Prix : 30€ pour les 9 soirées. En vous inscrivant, vous vous engagez à participer le plus souvent possible.
Contact et inscriptions
ep@lafonderie.be – 02 413 11 83 – 0499 134 955

Nous vous invitons à un parcours contemplatif le long des canaux peints par Alexandre Obolensky. La pratique de la présence attentive ou mindfulness nous fera entrer dans un autre temps afin de mieux percevoir et ressentir ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur de nous. La séance intégrera également un brin de poésie et d’imagination de la matière selon Bachelard.
Jennifer Batla est historienne de l’art, guide conférencière et auteure de textes de médiation culturelle. Elle s’entraîne à la présence attentive, appelée également mindfulness, depuis maintenant plus de dix ans. Elle est certifiée par l’UCL pour l’enseignement de cette pratique auprès des jeunes.
| RÉSERVEZ VOTRE TICKET |

Nous vous invitons pour une promenade immersive à la (re)découverte du canal de Bruxelles, dépeint par un artiste phare de la scène belge : Alexandre Obolensky. Une invitation à prendre un temps d’arrêt, à la flânerie et à la contemplation.

Connu comme peintre de décors de théâtre, opéra, ballet et exposition, Alexandre Obolensky (Bruxelles, 1952-2018) a également développé une œuvre personnelle autour du canal de Bruxelles.
Au fil des lumières et des paysages, le canal se métamorphose.
L’exposition invite à une balade sensible et contemplative, à la découverte d’une série de peintures troublantes par leur réalisme, qui nous exposent un canal pluriel capté par l’œil de l’artiste et interprété selon sa technique picturale. Les œuvres sont des appels à s’arrêter, à observer et à questionner notre regard, notre perception de ce canal inscrit dans le paysage bruxellois, mais encore souvent méconnu.
Photographier puis dé-photographier par la peinture, telle était la manière de procéder d’Obolensky.
Au travers du regard de l’artiste, cette promenade libre invite aussi à la découverte de son processus du création. Du choix de l’angle de vue à la transposition picturale par le quadrillage, l’exposition fait découvrir les différentes étapes d’une technique précise et rigoureuse.
L’exposition s’adresse à un large public, aux amateurs d’art comme aux observateurs curieux, petits et grands, grâce à l’intégration de dispositifs interactifs dans le parcours du visiteur.
Un catalogue de l’exposition est également proposé pour poursuivre la balade de chez soi ou dans les pas de l’artiste le long du canal.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l’artiste est également disponible l’ouvrage Alexandre Obolensky, rétrospective sur sa carrière de peintre de décors et sur son travail personnel. Illustré de nombreuses photographies et accompagné de témoignages d’observateurs et de collaborateurs privilégiés, il retrace une vie de peinture, un métier unique et particulier entre opéras, théâtres, grandes expositions et travail intime.

ATELIER COMPLET
Vous avez réalisé un modèle de fonderie en plâtre, bois, plastique ou autre matériau et vous souhaitez le couler en bronze. Accompagné par Françoise Gutman, vous réaliserez votre moule en sable et vous coulerez votre pièce. Le tout en une journée à la Fonderie !
Chaque participant réalise un (seul) moule à partir d’un ou plusieurs châssis. La Fonderie met à votre disposition deux formats de châssis :
• rectangulaire L :40/ l :20/ h :5 cm (pour un bas-relief)
• circulaire D : 15/ h :5 cm (pour un volume plein).
Pour comprendre les possibilités et les contraintes de cette technique, référez-vous au vadémécum du stagiaire pour le bas-relief ou le vademecum pour le volume plein.
| RÉSERVATION |

Cette visite vous emmène à la découverte de l’histoire industrielle et ouvrière de Bruxelles. Le « quartier des Fabrique », situé entre les boulevards centraux et le canal, est l’un des plus vieux quartiers industriels de la capitale.
L’industrialisation y débute dès la première moitié du 19e siècle ; elle est dense et diversifiée. On y voit pousser comme des champignons, sur un périmètre relativement réduit, des brasseries, imprimeries, papeteries, dépôts… mais aussi de nombreuses habitations ouvrières. Encore aujourd’hui, cette partie du centre-ville conserve de nombreux anciens bâtiments industriels remarquables que vous allez découvrir durant la balade.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
Retour vers la page des visites individuelles.

Vous avez toujours rêvé manipuler avec adresse et efficacité la canette, le volant ou le releveur de fil sans savoir comment se confronter à la machine : ce stage est pour vous ! Trois jours pour comprendre et expérimenter les multiples possibilités de la machine à coudre, en confectionnant des accessoires simples, pratiques et uniques à partir de coupons de tissus. Tous les points sont permis ! Qu’ils soient droits, invisibles ou en zig zag, ne passez pas à côté du chas de l’aiguille et venez donc créer ces petites confections qui vous manquent : pochettes en tout genre, serviettes diverses, totebag ou autres petites inventions.
| RÉSERVATION |


PROGRAMME
VISITE CONTÉE : LE CANAL D’OBOLENSKY (FR)
Rencontres impromptues au bord du canal.
Performances contées et chantées
“Elles sont femmes des berges, filles du ruisseau. Elles se tiennent au bord des tableaux comme au bord de l’eau. Elles chantent et murmurent aux oreilles de qui veut bien les entendre. Croiserez-vous leurs sillages?”
Performances de et par Julie Renson (conte) et Colienne Vancraen (chant).
Dans le cadre du projet Contes au musée (Fédération de conteurs professionnels).
→ En continu
WORKSHOP : DESSINE COMME OBO’ (FR)
Enfourchez un vélo imaginaire et laissez-vous emporter par les images du canal vu par Obolensky. Dessinez votre part du décor sur un quadrillage, puis reportez-le, en grand cette fois, dans l’atelier.
Atelier par Pauline Meunier, Responsable pédagogie pour La Fonderie
→ En continu
STANDING GUIDE : EXPOSITION MADE IN BRUSSELS (FR/NL)
Guide volant bilingue FR/NL
→ En continu
EXTRA-MUROS : BALADE SONORE (FR)
Promenade entre le Musée des Égouts et La Fonderie.
→ Plus d’informations sur la page du Musée des Egouts.

Notre visite vous emmène à la découverte de l’histoire mouvementée des années trente à travers le patrimoine du quartier de l’Altitude Cent.
Le «mardi noir» du 29 octobre 1929 interrompt un courant des Années folles et marque le début d’une nouvelle ère. Les années trente s’imposent avec une crise économique, le chômage, des bouleversements sociaux, la crainte d’un nouveau conflit mondial… Pourtant, c’est aussi la période de l’introduction des premiers congés payés, de l’Exposition universelle et de la démocratisation du sport. C’est l’époque des cafés-dansants, des cinémas, de la radio et du Centenaire de la Belgique. Bref, c’est une décennie qui en dit long sur toutes les ambivalences d’une histoire que vous allez découvrir au long de cette balade.
Ce parcours n’est disponible pour une commande qu’à partir de l’octobre 2024.
| RÉSERVER VOTRE TICKET |

Appel à participant.e.s
Dans le cadre de l’exposition du Musée bruxellois des industries et du travail, intitulée Unfree labor, La Fonderie vous propose un atelier de réflexion, d’écriture et de réalisation d’un podcast sur le thème du travail forcé. Pour vous y inscrire, vous ne devez pas être un.e spécialiste de la question. Nous produirons ensemble notre propre définition du travail forcé et échangerons à propos de ce que nous avons envie d’en dire.
Calendrier :
Lundis 18 et 25 septembre de 18h15 à 20h45 > de quoi on parle ?
Lundi 2 octobre de 18h15 à 20h45 > visite guidée de l’exposition, échanges et réflexion
Samedi 7 octobre de 9h30 à 16h30 > comment on en parle ?
Lundi 9 octobre de 18h15 à 20h45 > formation technique et écriture scénographique
Samedi 14 et dimanche 15 octobre de 9h30 à 16h30 > tournage et ambiance sonore
Lundi 6 novembre de 18h15 à 20h45 > dérushage et plans
Lundis 13 et 20 novembre de 18h15 à 20h45 > montage
Lundi 11 décembre à 18h15 > écoute
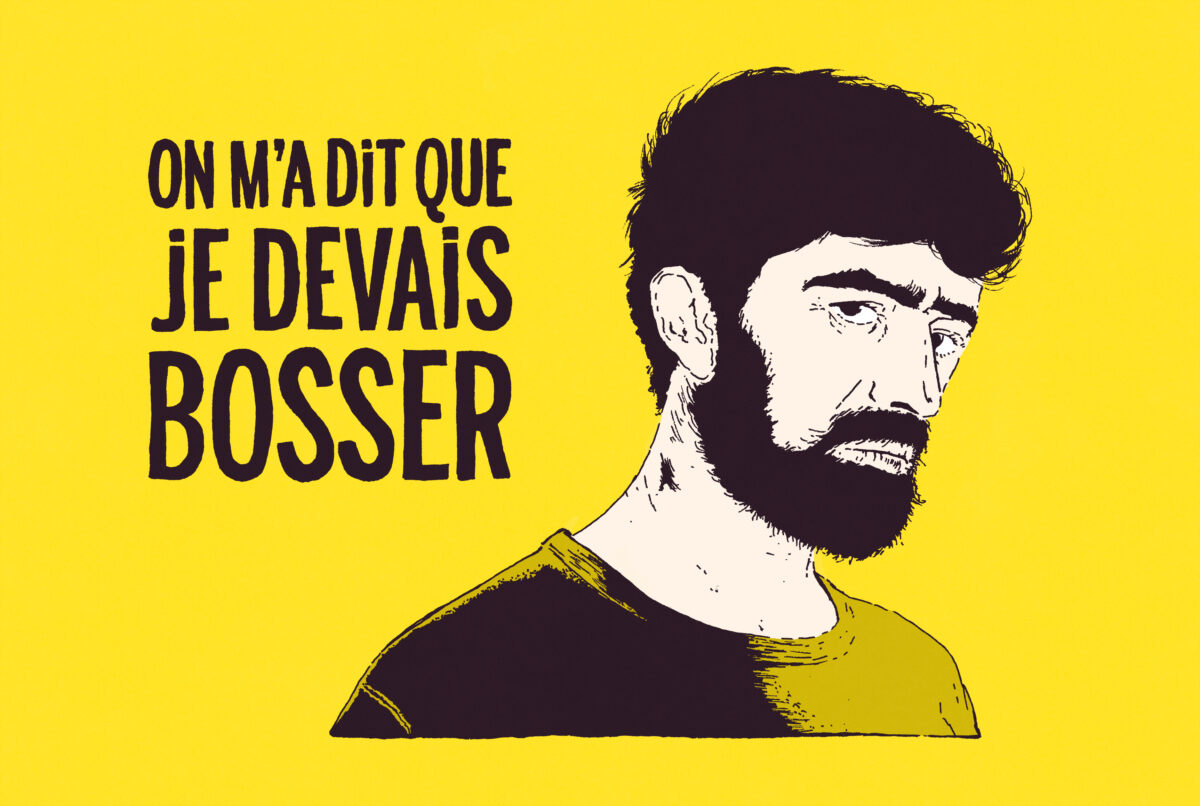
Cela fait un peu plus d’un siècle que, pour la première fois, la loi belge engageait la responsabilité de l’Etat sur la construction de logements publics. La loi de 1919 révolutionne ainsi le marché d’habitations destinées aux personnes ayant des revenus modestes. Plusieurs quartiers industriels de Bruxelles, y compris ceux de Molenbeek, voient une expansion de leur nombre. Au cours du siècle, les ambitions et objectifs des pouvoirs publics varient et les logements sociaux prennent des formes diverses. Molenbeek en abrite toujours une partie importante.
La Fonderie vous invite à découvrir l’évolution de leur histoire, depuis la construction des habitations populaires et ouvrières au 19e siècle jusqu’aux questions contemporaines portant sur la « mixité » des logements. Au long de la balade, vous allez ainsi apprendre comment les enjeux socio-politiques d’alors et d’aujourd’hui ont contribué à façonner le développement urbanistique, socio-économique et socioculturel de Molenbeek et de toute la Région bruxelloise.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis :
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

Le développement ferré de Bruxelles participe certainement à l’industrialisation de cette ville au cours du 19e siècle. Depuis son inauguration en 1871, la ligne L28 (baptisée « la ceinture Ouest ») a déterminé l’évolution industrielle, économique et sociale, ainsi que l’urbanisation de la capitale. Des industries bruxelloises, précédemment installées dans le Pentagone, se sont désormais redéployées selon un axe nord-sud suivant ses voies ferrées.
La Fonderie vous emmène à (re)explorer cette ceinture ferroviaire et ses gares, ainsi que son histoire de l’apogée de sa gloire à nos jours.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis :
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

Ce bâtiment sobre, avec une remarquable bow-window, porte le nom de ses propriétaires actuels : the Quaker House. Pourtant, parmi les connaisseurs il est aussi connu sous le nom de Georges Hobé, du nom de l’architecte qui l’a construit en 1899. Au cours du 20e siècle, la maison Hobé connaît différents occupants et propriétaires avant d’être acquise par le Conseil Quaker pour les affaires européennes. Ces derniers ont lancé une grande campagne de restauration des décors intérieurs, notamment des papiers peints, qui se sont déroulés entre 2009 et 2011.
La Fonderie vous invite à la découverte de cette réalisation de Georges Hobé, qui compte parmi ses premières œuvres en tant qu’architecte. Vous serez accompagnés par notre guide, qui est par ailleurs, régisseur de ce bâtiment remarquable, qui a suivi tous les travaux de restauration de A à Z.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis :
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
Retour vers la page des visites individuelles

Avec une diversité de tailles, de formes, de matériaux de construction, de styles et de droits de propriété, une vingtaine de cités-jardins sont édifiées en périphérie de Bruxelles dans le contexte de la reconstruction après la Première Guerre mondiale. L’engouement pour ce modèle, destiné à faire face au « déficit du logement », ne dure cependant qu’une décennie. Apparu à la suite de la Conférence nationale de l’Habitation à bon marché de 1920, il est abandonné en faveur de la construction en hauteur après le 3e Congrès international d’architecture moderne (C.I.A.M.), organisé à Bruxelles en 1930.
Cette visite guidée vous présente trois cités, proches les unes des autres, qui ont été construites en moins de 5 ans dans le “Nouveau Molenbeek”. Nous découvrirons leurs différences et similitudes à la fois dans leur conception et réalisation, mais aussi dans leur évolution d’hier à aujourd’hui, au gré des opportunités et défis urbanistiques et sociaux apparus depuis 100 ans.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis :
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

Des changements apportés par la révolution industrielle touchent tous les aspects de la vie quotidienne, notamment les loisirs. Dès le 19e siècle, les lieux de fêtes et de sorties changent profondément à Bruxelles. Cela affecte la grande bourgeoisie ainsi que la noblesse, mais sans doute plus encore les classes populaires. Après des journées de travail longues et pénibles, les Bruxellois de condition plus modeste profitent de leurs moments libres pour faire la fête, danser, s’amuser et se détendre.
La Fonderie vous amène à la découverte d’anciennes salles de fêtes, de théâtres, de cinémas, de bistrots… qui ont vu se divertir, s’encanailler ou militer — voire les trois à la fois ! — des générations de Bruxellois.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis :
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
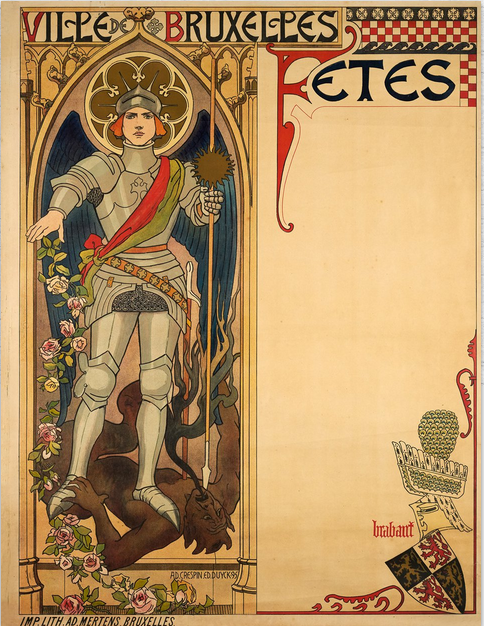
Il est difficile d’imaginer que les dernières fortifications militaires de Bruxelles ne sont démantelées qu’à la fin des années 1840. Sur leur tracés sont ouverts de larges boulevards destinés comme ailleurs à la promenade mais aussi à des fonctions bien différentes de celles du haut de la ville.
Les alentours du canal et du chemin de fer adoptent en effet des colorations plus industrielles. Assez vite, cette partie de l’ancienne enceinte se déclinera certes en immeubles résidentiels, mais aussi en bâtiments utilitaires, en usines et en entreprises. Au cours de notre balade, nous vous invitons à découvrir cette artère mal connue des Bruxellois, ainsi que ses multiples aménagements urbains qui continuent de transformer et de secouer la ville aujourd’hui.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis :
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
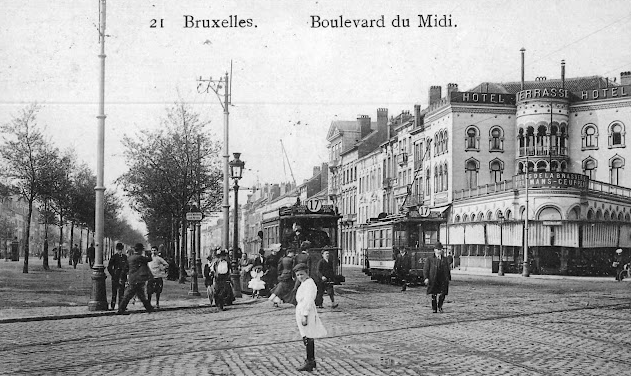
La zone entre la station de métro Mérode et la chaussée de Louvain est surtout connue pour ses rues bordées de splendides maisons de la fin du 20ᵉ siècle. La majeure partie du quartier de Linthout a été urbanisée suite à la construction des boulevards de la grande ceinture pendant le règne de Léopold II, notamment avec l’ouverture du boulevard Brand Whitlock. Pourtant, derrière ces charmantes rues en damier se cache un important centre industriel.
La Fonderie vous invite à découvrir la cité ouvrière de Linthout, un des deux derniers exemples des plus vieux ensembles de logements ouvriers de toute l’agglomération bruxelloise. Venez apprendre l’histoire de ces habitations ouvrières pour mieux comprendre le contexte du développement de ce lieu industriel hors du commun.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis (à partir du mai 2024):
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

La Fonderie vous présente un petit bijou oublié de Saint-Josse, construit au milieu du 19e siècle au cœur de la commune.
Depuis un millénaire, l’urbanisation bruxelloise est intimement liée à son patrimoine religieux. Comme beaucoup de villes dans nos régions, Bruxelles évolue à proximité des lieux de culte: des églises, des couvents et des chapelles… Aujourd’hui ce patrimoine se décline en un large ensemble de bâtiments aux morphologies, échelles et styles divers.
Au cours de ces balades nous abordons ou découvrons ce qu’apportent différentes périodes historiques à l’architecture religieuse grâce aux avancées des techniques de construction, aux nouveaux matériaux et aux changements de conception spirituelle.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis (à partir du novembre 2024):
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
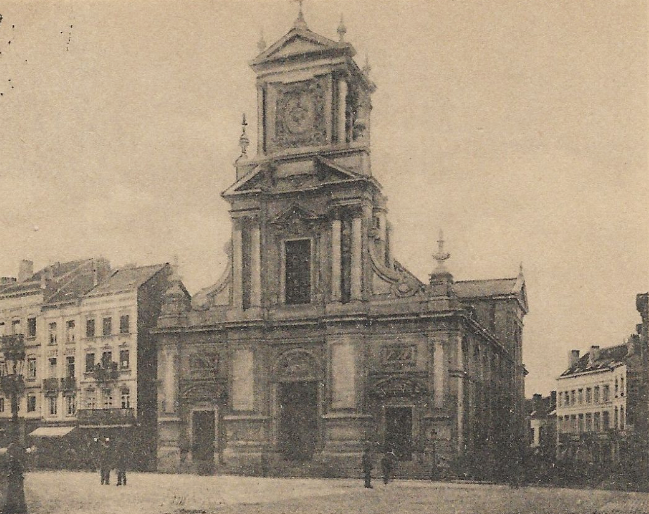
Depuis un millénaire, l’urbanisation bruxelloise est intimement liée à son patrimoine religieux. Bruxelles évolue à proximité des lieux de culte : des églises, des couvents et des chapelles… Et ces derniers évoluent avec Bruxelles suivant des avancées dans les techniques de construction, l’apparition de nouveaux matériaux, ainsi que des évolutions de conception spirituelle et des bouleversements sociaux-politiques.
La Fonderie vous invite à la collégiale des Saints Michel et Gudule et dans ses alentours pour une visite dans le temps. Vous allez remonter l’histoire de Bruxelles pour découvrir les traces du progrès que notre œil voit mais ne regarde pas.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis :
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

Venez suivre une route d’antan dans un ancien quartier populaire au cœur de Bruxelles. Le Béguinage et l’hospice Pacheco, le Marché aux poissons et les Halles Saint-Géry… Tous ces endroits bien connus vous dévoileront leurs secrets. Comment vivaient les Bruxellois au cours des 19ᵉ et 20ᵉ siècles ? Et comment évoluait leur environnement ?
Cette balade est conçue et vous proposée par un guide indépendant spécialisé dans l’histoire du mouvement ouvrier.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis :
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
Retour vers la page des visites individuelles
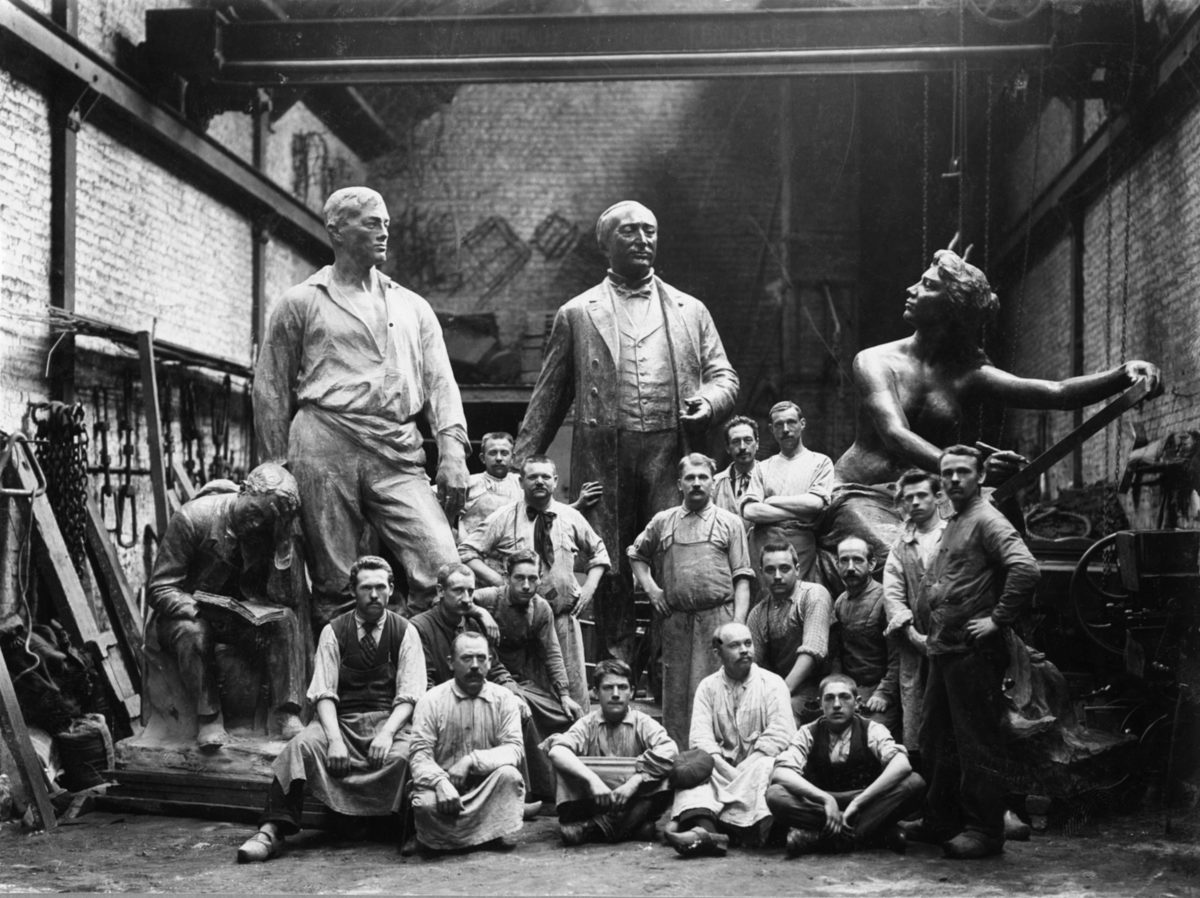
D’un premier jet, ce parcours ressemble à de nombreux itinéraires « les plus instagrammables » entre le haut et le bas de Bruxelles. Chaque jour, des centaines de touristes s’y rendent pour admirer les statues du Petit Sablon, poser pour une photo sur la Grand-Place ou prendre un café devant le panorama du Palais de Justice.
Mais qu’y apprendra un.e Bruxellois.e d’une longue ou d’une courte date ?
Cette visite s’adresse à des curieux qui cherchent à comprendre comment la politique et les institutions façonnent notre quotidien, ainsi que les conséquences de la (dés)industrialisation sur l’urbanisation et, surtout, sur la population bruxelloise.
Le parcours couvre différents aspects sociétaux, tels que le logement, le travail, l’éducation et l’urbanisme, depuis le début du 19e siècle jusqu’à nos jours.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
Les organisations actives dans le domaine des parcours de citoyenneté ou des BAPA peuvent combiner ce circuit avec notre atelier intitulé ‘L’histoire de Belgique en 180 minutes.’
RETOUR VERS LE CATALOGUE DES PARCOURS
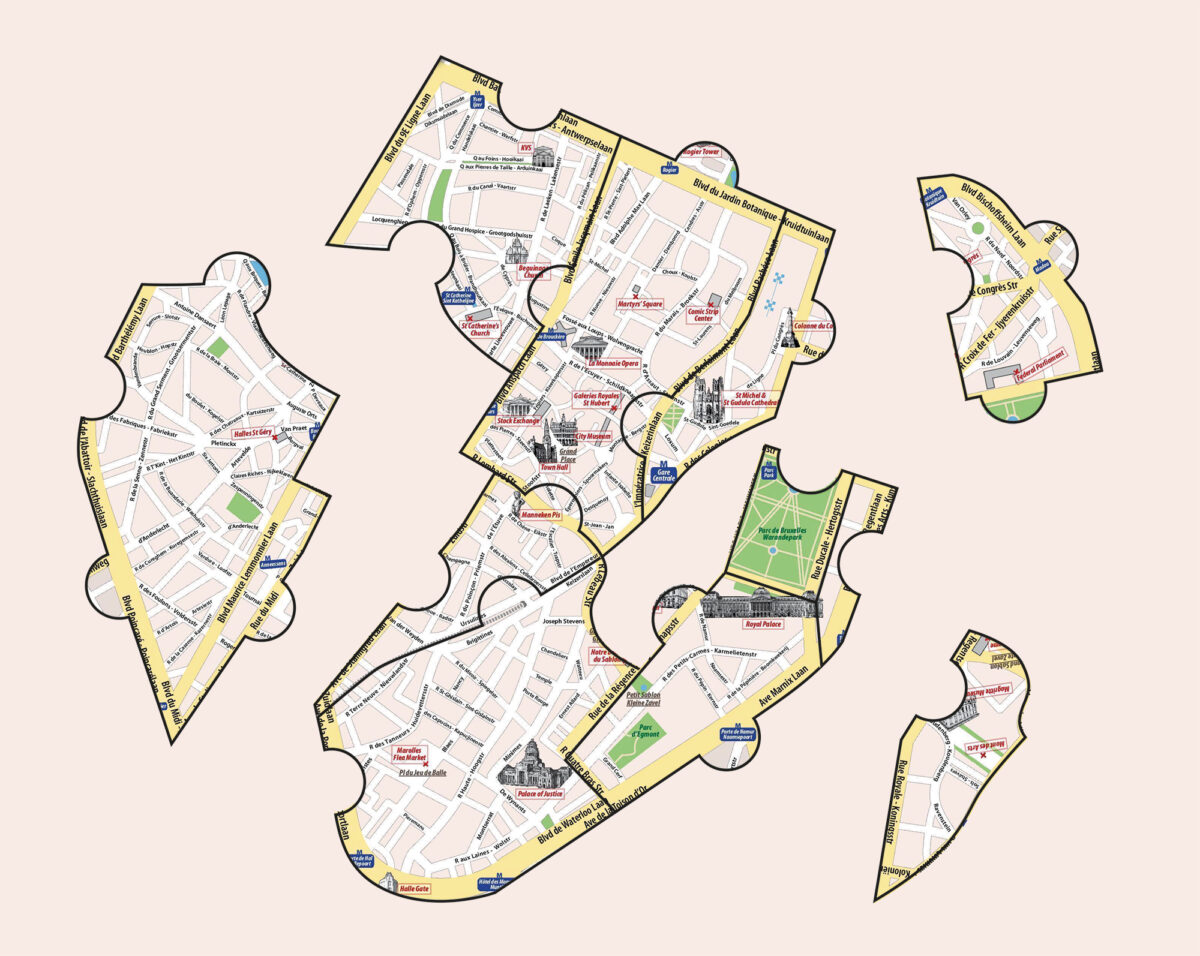
La Fonderie vous invite à la rencontre avec le passé (post)-industriel de la région bruxelloise.
On commence par explorer le site de l’ancienne Compagnie des Bronzes (1854-1979), une entreprise métallurgique spécialisée dans la réalisation de statues monumentales, de luminaires et d’objets de décoration en bronze. Cette fonderie d’art implantée aux abords du canal symbolise la croissance économique et industrielle de Bruxelles au 19e s, jusqu’à l’après deuxième guerre mondiale. Installée dans un des quartiers les plus industrialisés du pays pendant une centaine d’année, elle a participé à l’essor de ce quartier surnommé le Petit Manchester. Elle diffusait ses produits sur tous les continents. Aujourd’hui constitué de ruines et de bâtiments restaurés, d’espaces verts et de machines entreposées ; le site de cette ancienne fonderie permet une lecture complète et précise de l’organisation d’une usine.
Au cours de la deuxième partie de la visite, on parcourt l’exposition Made in Brussels. Abritée dans une ancienne halle typique de l’architecture industrielle, cette exposition est à la fois insolite et passionnante. Elle raconte avec des machines, des outils et des objets à travers quatre sections – le bois, le métal, la confection textile et l’alimentation – la vie quotidienne au temps des grandes industries bruxelloises. Musée d’histoire et de société, la Fonderie propose un regard inédit sur l’évolution socio-économique de la ville autant que sur les inventions technologiques, les contextes et les gestes de la vie quotidienne, depuis la Révolution industrielle au 19e s jusqu’à aujourd’hui, après la désindustrialisation.
| RÉSERVER VOTRE VISITE GUIDÉE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis :
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
Pour les jeunes publics francophones – scolaires et extra scolaires – nous proposons une visite animée “Vapeur, machines et ouvriers” :
| COMMANDER VOTRE VISITE ANIMÉE |
Retour vers la page des visites individuelles

Plongé dans la verdure, ce petit chemin bordant la Woluwe est aujourd’hui un espace prisé par les joggeurs, cyclistes et promeneurs. Le jour comme la nuit, en semaine comme en week-end, en été comme en hiver, on y circule d’Auderghem à Woluwe et… de Woluwe à Auderghem, souvent sans remarquer les vestiges du passé industriel de Bruxelles.
Cette voie ferrée, avec ses gares et auberges, sa ligne parsemée de petites industries familiales et artisanales, son quartier de simples blanchisseuses aux mains déformées, a marqué l’évolution de trois communes de la seconde couronne, et son empreinte se dessine encore tout au long de la promenade verte.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis :
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
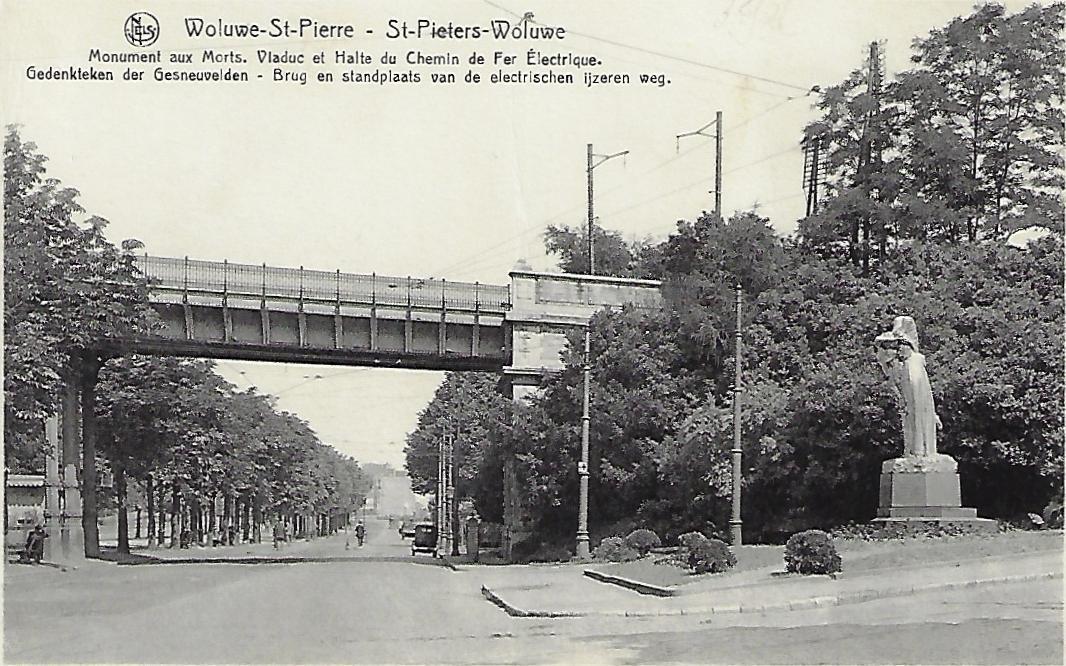
Boire et manger sont des activités usuelles normales et quotidiennes. Cependant les innovations techniques introduites par la révolution industrielle ont bouleversé les méthodes de production et de conservation, avec des conséquences considérables sur nos habitudes alimentaires et culinaires.
La Fonderie vous invite à la découverte des lieux de production alimentaire entre la place de la Duchesse (Molenbeek) et les abattoirs de Cureghem. Lors de votre balade, vous allez découvrir des raffineries de sucre, brasseries, entrepôts frigorifiques, fabriques de boîtes de conserves … et d’autres témoins de l’émergence d’une industrie agroalimentaire à Bruxelles.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis :
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
Retour vers la page des visites individuelles

Les canaux bruxellois sont une terre d’accueil historique des activités économiques utilisant la voie d’eau. On assiste aujourd’hui à un mouvement de transformation des terrains qui le bordent pour accueillir des activités culturelles et des logements haut de gamme.
La balade mettra en tension le versant anti-spéculatif du canal, celui des habitants et des travailleurs, comme lieu de vie et de ressources, avec un canal vu d’en haut, celui des promoteurs et des convoitises qui en font de plus en plus un lieu de rente, de spéculation ou de consommation.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
Retour vers la page des visites individuelles.

Evoquer la commune de Saint-Gilles, c’est bien souvent vanter son patrimoine Art Nouveau, son somptueux hôtel de ville, ses bistrots un peu bohêmes… Mais si l’on veut mieux connaître et comprendre cette commune bruxelloise, il faut également l’envisager sous un angle trop souvent délaissé : son passé industriel, social et politique.
Voici donc une visite guidée hors des sentiers battus, en quête de témoins d’une histoire vieille de près de deux siècles. Une histoire qui a vu la transformation d’un petit faubourg rural en une commune industrieuse parmi les plus densément peuplées du royaume.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

Vous connaissez sans doute les abords du cimetière d’Ixelles, peuplés de cafés, de brasseries et d’estaminets en tous genres fréquentés par les étudiants de l’ULB toute proche. Mais êtes-vous déjà rentré dans cette nécropole ?
Ce cimetière n’est pas qu’un lieu d’inhumation. Il fut inauguré en 1877 en remplacement de deux cimetières locaux désaffectés. Il est connu pour la qualité des monuments funéraires et le nombre de célébrités qui y sont enterrées, de Victor Horta à Eugène Ysaÿe en passant par Charles De Coster. Plusieurs extensions ont transformé douze hectares en un lieu paisible au cœur d’un des quartiers les plus animés de la région bruxelloise.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
Retour vers la page des visites individuelles.

Les communes de St-Gilles, Ixelles et Schaerbeek sont des écrins bien connus de l’Art Nouveau dans la région bruxelloise. Le centre-ville de la capitale possède lui aussi de nombreuses perles de ce courant artistique que La Fonderie vous invite à découvrir durant notre balade.
Lors de cette visite guidée, nous aussi aborderons des aspects plus “sociologiques” de l’Art Nouveau et décrypterons ses véritables enjeux sociaux: qui sont les commanditaires, leurs intentions et leurs rapports avec le mouvement laïque de l’époque.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

La gare Centrale est la deuxième gare du pays par sa fréquentation. Chaque jour, plus de 60.000 voyageurs y débarquent pour se fondre dans le centre de Bruxelles. Ils parcourent une immense salle d’attente en sous-sol, s’arrêtent peut-être dans une grandiose salle des guichets ou jettent un coup d’œil sur sa façade sobre et fonctionnelle.
Rares sont ceux qui savent que la construction de cette dernière œuvre de Victor Horta a pris plus de 40 ans. Sa réalisation a eu pour conséquence la destruction de quartiers entiers et le départ forcé de leur population.
Cette visite vous invite à regarder d’un autre œil ce monument ferroviaire et à découvrir l’histoire de son chantier dont les cicatrices sont toujours visibles.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

Pour certains d’entre nous, le “Quartier nord” évoque encore le souvenir datant des années 1960 et 1970 de la fameuse saga du Plan Manhattan. C’était l’époque des promoteurs et de la spéculation immobilière, d’autoroutes urbaines, d’habitants expulsés de leurs quartiers sinistrés au profit de projets démesurés qui ne verront jamais le jour, entre autres à cause de la crise pétrolière…
Le parcours vous propose de découvrir l’évolution et les réalités d’aujourd’hui dans ce quartier situé entre la Gare du Nord et le canal, où se côtoient fonctionnaires, migrants, habitants et commerçants.
| RÉSERVER VOTRE TICKET |

Les constructions du site de Tour et Taxis et du port extra-muros au début du 20e siècle ont bouleversé la géographie urbaine de Bruxelles. Elles ont donné naissance à un nouveau quartier, appelé encore aujourd’hui le quartier Maritime. Les entreprises nationales et internationales s’y sont rapidement et massivement installées. Elles y bénéficiaient entre autres d’un accès aisé au canal, au rail et à la route.
Cette visite guidée raconte l’essor et le déclin d’un quartier pas comme les autres et vous invite à découvrir quelques fleurons du patrimoine industriel bruxellois tels que les anciennes usines Nestor Martin, Gosset, Byrrh, et bien d’autres encore.
| RÉSERVER VOTRE PLACE |
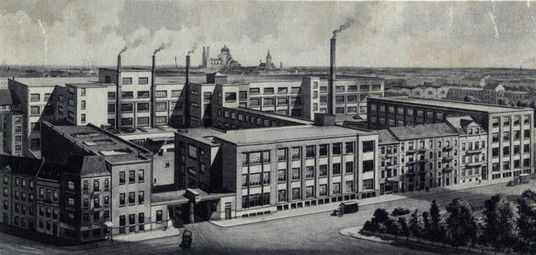
Le cimetière de Molenbeek-Saint-Jean est le premier cimetière laïque à être inauguré suite à la “guerre des cimetières” qui sévit au milieu du 19ème siècle entre catholiques et libéraux. C’est donc l’un des plus anciens de Bruxelles.
Il abrite quelques arbres remarquables et plusieurs monuments architecturaux impressionnants. Par exemple, ce monument aux bateliers qui rappelle la proximité du canal ou encore la galerie funéraire néoclassique, récemment restaurée.
Cette visite guidée vous fera voyager entre différentes époques et styles architecturaux : néoclassique, Art Nouveau et Art Déco.
| RÉSERVER VOTRE TICKET |

Cette visite guidée au sein du cimetière de Bruxelles vous amène à porter un regard original sur le travail des bronziers, dont ceux de la Compagnie des Bronzes. Les tombes et monuments funéraires y sont d’une grande qualité. Elles doivent beaucoup au savoir-faire des fonderies et artistes bruxellois.
Par la richesse de son patrimoine, ce cimetière permet d’embrasser l’évolution de la statuaire, selon les styles, les techniques et les choix des matériaux. Il constitue aussi une porte d’entrée originale pour découvrir l’histoire de Bruxelles par les personnalités qui y sont enterrées : Charles Buls, Jean Volders, César De Paepe, Charles Albert, Henri Beyaert, Théodore Verhaegen…
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

La révolution industrielle a bouleversé la vie pastorale de Bruxelles et des commune limitrophes. Tout à coup, l’agglomération bruxelloise devient le premier centre industriel du pays. Les entreprises les plus importantes s’implantent le long du “croissant industriel” qui traverse les communes d’Anderlecht, Molenbeek et Schaerbeek. Elles s’installent le long du canal et des lignes de chemin de fer, voies de transport indispensables au développement de leurs diverses activités.
La commune de Schaerbeek voit aussi se développer une zone d’activité prospère à proximité du talus ferroviaire. La Fonderie vous propose de parcourir le quartier qui relie la Gare du nord et la Gare de Schaerbeek à la recherche de ses anciennes fabriques et friches industrielles d’en apprendre plus sur leurs affectations actuelles.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
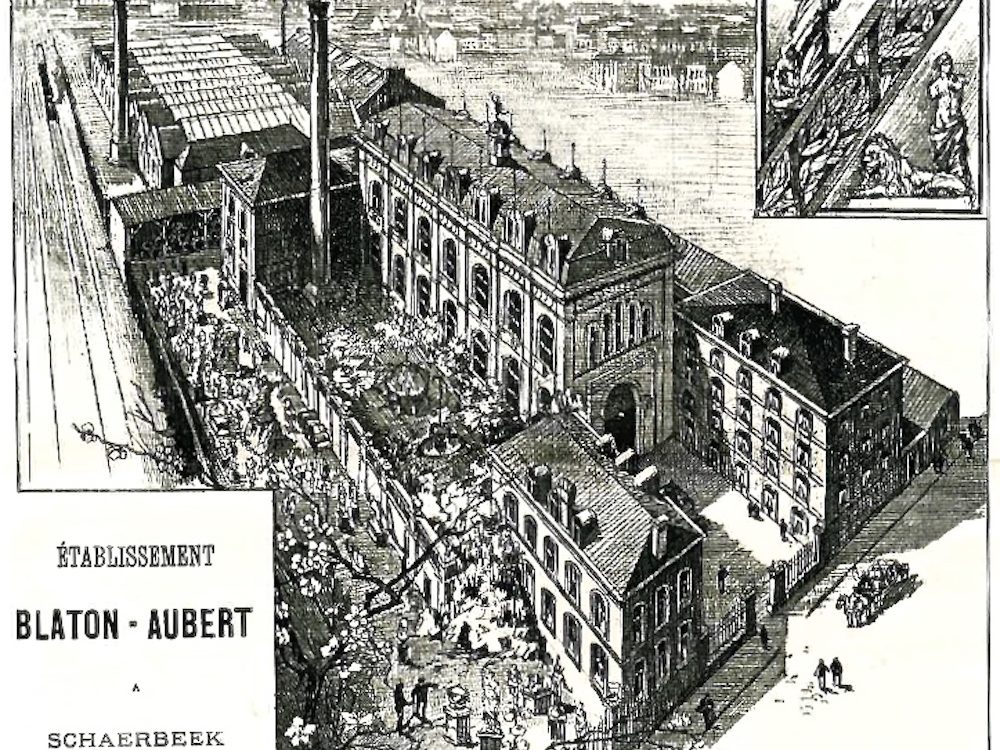
D’où vient notre eau potable et que deviennent nos eaux usées aujourd’hui ? Qui en a la gestion ? Quelles sont des perspectives et les solutions ? Plusieurs questions très pertinentes en lien avec le recyclage et l’épuration opérés par les nouvelles technologies. Remontons le temps… Pourquoi et comment la ville a intégré la distribution d’eau et le réseau d’égouts au fil des siècles ? Quels étaient les métiers impliqués dans ces activités ? Quelles traces urbanistiques, sociales et artistiques sont encore visibles ?
Ce parcours thématique atypique dans le centre de Bruxelles vous propose un autre regard sur nos deux besoins naturels plus ou moins pressants auxquels nous sommes tous régulièrement confrontés dans l’espace public.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

Le jardin botanique de Bruxelles a connu une histoire mouvementée. Il a été ouvert en 1829 comme lieu de conservation et de recherche en botanique et horticulture. Il a ensuite perdu cette fonction au profit du jardin botanique de Meise. Malgré les nombreux travaux qui l’ont amputé au cours du 20ème siècle, il reste l’un des plus anciens et des plus beaux parcs publics de la capitale.
Aujourd’hui, le parc du Botanique est un lieu de promenade apprécié. L’art et la culture y ont leur place : concerts en plein air, sculptures en bronze etc. Ces dernières forment un ensemble assez exceptionnel qui nous permettra d’aborder techniques de production, courants artistiques et significations symboliques…Cette visite guidée vous fera bondir dans le passé !
| RÉSERVER VOTRE PLACE |

Le square du Petit Sablon, créé au 19e siècle, constitue un hommage romantique rendu par la bourgeoisie bruxelloise à la Belgique idéalisée de la Renaissance. Le parc est chargé de symboles et de messages historiques ou idéologiques.
Les comtes d’Egmont et de Hornes, élevés au rang de martyrs, trônent au sommet de la fontaine. Ils sont entourés de 10 personnalités marquantes du 16e siècle. Parmi elles, des penseurs et des scientifiques mais également d’autres grandes figures de l’opposition à Philippe II. Tout autour se dressent les fameuses 48 statues figurant les métiers bruxellois et leurs corporations.
Cette visite guidée vous invite à explorer toutes les facettes de cet ensemble, réalisé par la Compagnie des Bronzes.
| RÉSERVER VOTRE PLACE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis:
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

Au lendemain de la Première Guerre Mondiale naissent les cités-jardins coopératives. Au fur et à mesure de leur construction, elles finissent par constituer ce que l’on appelait “la ceinture rouge de Bruxelles”.
Lors de cette visite, La Fonderie vous emmène à la découverte de la Cité de Moortebeek. Son histoire commence grâce à l’initiative de la société coopérative « les Foyers collectifs » qui s’est installée en 1921 dans les locaux de la Maison du Peuple de Bruxelles. Assez vite, 354 maisons avec jardins sont bâties sur un terrain situé aux confins de Molenbeek et d’Anderlecht. Les habitations sont conçues par sept architectes dont Joseph Diongre, Fernand Brunfaut et Jean-François Hoeben sont les plus connus.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis :
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
Retour vers la page des visites individuelles

Le 14e siècle verra le triomphe du drap de Bruxelles, qui dominera le marché international par sa qualité et par son prix. A la Cour de France, le roi n’utilise que du drap de Bruxelles pour ses six robes ou ensembles. On retrouve le fameux drap jusqu’à Constantinople.
Cette visite de La Fonderie se concentre sur la laine et ses productions dérivées qui firent la renommée de Bruxelles dès le Moyen-Âge. Vous allez parcourir les lieux clés de sa production et de sa commercialisation. La balade s’achèvera dans la salle des tapisseries de la Maison du Roi, où vous découvrirez la symbolique qui se cache dans quelques admirables tapisseries.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

Souvent, l’Art Nouveau n’est envisagé que sous des angles esthétique ou historique. Cette visite guidée vous emmène en amont de ces considérations. Elle vous fait également découvrir les savoir-faire et les techniques qui se cachent derrière ce courant qui a marqué Bruxelles de ses lettres de noblesse.
Au 19è siècle, les architectes utilisent de plus en plus les productions industrielles, tant les matériaux que les éléments produits en série. Ils continuent cependant à faire appel à des artisans et des artistes qui démontrent une exceptionnelle maîtrise de leurs métiers. La Fonderie vous invite à en découvrir quelques magnifiques exemples durant ce parcours à Saint-Gilles.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

En 1858, l’industriel français Jean-Baptiste Godin acquiert un vaste terrain sur la rive du canal afin d’y installer une succursale de sa fonderie de Guise (Aisne). Adepte des idées sociales, Godin est sensible aux conditions de travail et de vie de la classe ouvrière. Dans cette perspective, il conçoit un Familistère à Laeken destiné au logement communautaire des familles de ses travailleurs.
En 1970, les derniers habitants le quittent suite à la fermeture de l’usine. Pendant des décennies, le site resta à l’abandon jusqu’au moment où on installe sur ses vestiges un vaste site commercial.
Notre visite vous emmène à la découverte de traces de cette utopie sociale, très éloignée des vêtements bon marché qui y sont vendus aujourd’hui.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis :
(Un arrêt étant prévu dans le petit espace Godin nous limitons cette visite à un nombre restreint de 10 personnes.)
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
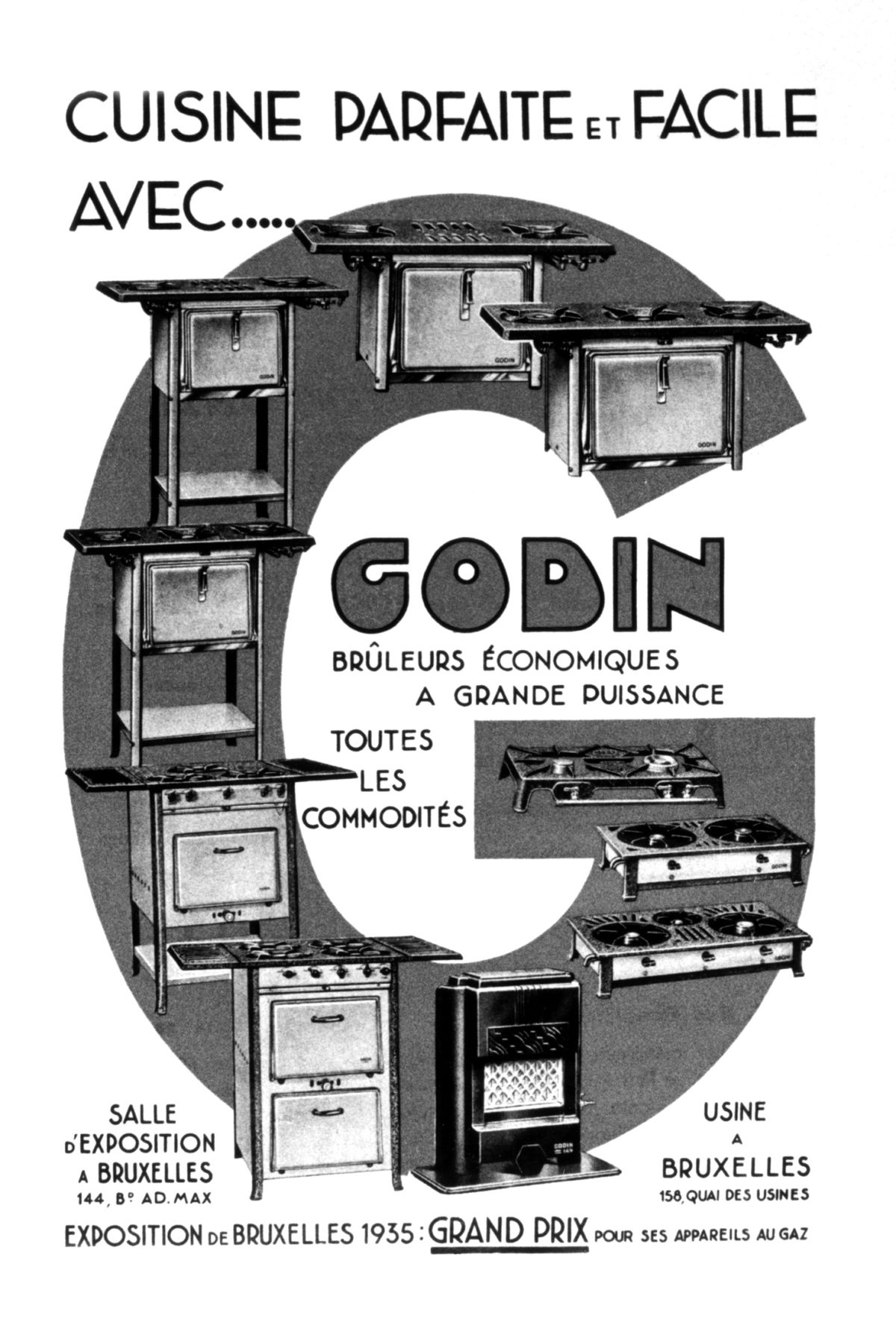
Durant des siècles, le quartier Sainte-Catherine était un des quartiers les plus animés de Bruxelles. Dès le 16e siècle, l’ancien port intérieur s’étendait de la Tour Noire à l’actuel square Sainctelette, attirant de nombreux commerçants, voyageurs, bourlingueurs et baladins.
La visite de La Fonderie vous invite à découvrir ce qui reste de ces anciens bassins. Durant notre parcours, vous apprendrez à percevoir des traces d’activités portuaires toujours visibles. Vous verrez les tracés de quais où étaient déchargées les marchandises et depuis lesquels les voyageurs embarquaient pour Anvers, de nombreux entrepôts, des ruelles et impasses. Dans l’une d’elles, la potale de Saint-Roch nous protège encore de la peste et d’autres maladies apportées par les bateaux.
| RÉSERVER VOTRE PLACE |

Le Vieux Molenbeek, quartier situé en bordure du canal, est communément appelé « le Petit Manchester ». En effet, il témoigne d’une époque où Bruxelles était la deuxième ville la plus industrialisée au monde, après Manchester en Angleterre. Ses usines, ateliers et fabriques ont profondément façonné l’univers urbain et social de ce territoire. Peu de quartiers ont connu une histoire sociale aussi intense, dont les effets se font encore sentir aujourd’hui.
Ce parcours guidé vous invite à explorer les places et les rues du Petit Manchester belge à travers son histoire, et à discuter des enjeux et opportunités contemporains qui y sont liés.
La visite s’achèvera au Musée bruxellois des industries et du travail, dont l’accès à l’exposition permanente vous sera offert.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
Retour vers la page des visites individuelles.
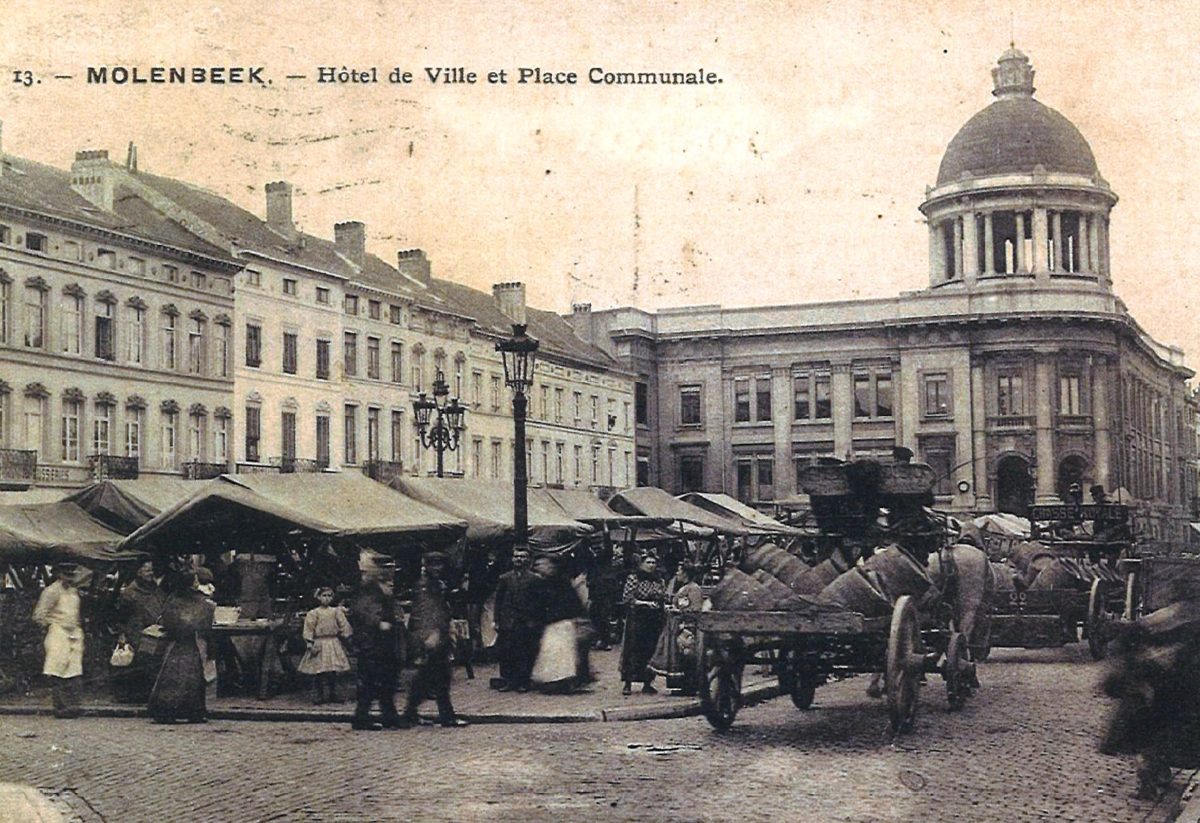
Cafés, buvettes, brasseries, estaminets ou caberdouches fleurissent à Bruxelles tout au long des 18e et 19e siècles. Ces lieux de socialisation et de consommation se comptent rapidement par milliers et sont alimentés par un nombre considérable de brasseries.
Ce parcours permet de découvrir l’évolution et la diversité des bières bruxelloises, de la Gueuze traditionnelle à la Pils industrielle. Il commence par une balade à travers le cœur historique de la ville et se termine par la visite d’une brasserie bruxelloise toujours en activité : la brasserie Cantillon. Une dégustation clôturera la balade.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
Retour vers la page des visites individuelles.




Véritable catalogue d’architecture et de génie civil, le site de Tour & Taxis est un chef-d’œuvre de l’âge d’or de l’industrialisation. Il illustre le savoir-faire des ouvriers et des ingénieurs belges de l’époque : maîtrise de l’acier, du fer, de la pierre, du verre et du béton.
Il fait aujourd’hui l’objet d’un des plus ambitieux aménagements bruxellois. Sa réaffectation est cruciale non seulement pour les quartiers voisins, qui furent en grande partie sinistrés depuis la fin de ses activités, mais également pour l’ensemble de la région bruxelloise.
Cette visite guidée de Tour & Taxis vous invite à en explorer l’histoire mouvementée, ainsi que les enjeux et opportunités actuels.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |
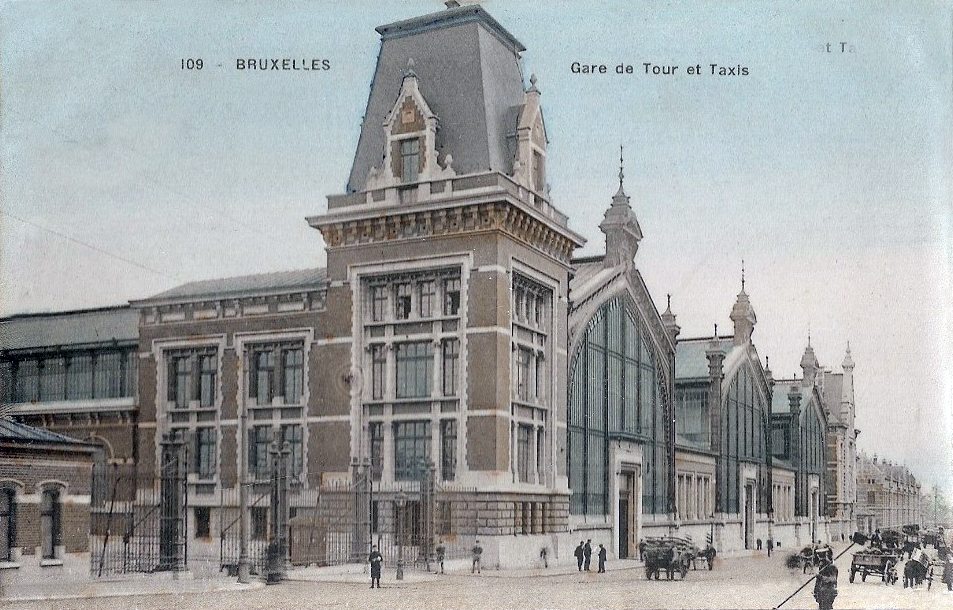
La controverse perdure à propos des pavés bruxellois. Ils sont perçus par certains comme un archaïsme néfaste dont il faut se débarrasser. D’autres les considèrent comme un trésor, fruit du labeur et de l‘habileté de nos grands-parents.
Cette visite vous permettra de découvrir ce joyau méconnu de notre patrimoine, humbles pierres sur lesquelles nous marchons sans y prêter attention. Vous apprendrez la grande diversité des pavés bruxellois, d’origine, de couleur, de texture, de relief, de format et de matériaux variés. A l’issue de cette visite vous pourrez les reconnaître au premier coup d’œil !
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

Si la Belgique est le premier pays du continent européen à s’être lancé, en 1835, dans l’aventure ferroviaire, il a fallu plus d’un siècle pour établir une liaison stable dans sa propre capitale. L’une des premières voies ferroviaires contournant la ville bien avant la Jonction Nord-Midi, était la ceinture ferroviaire Est de Bruxelles, soit la ligne 161. Elle est constituée à partir de la liaison entre le Quartier Léopold et le sud de la Belgique, ligne inaugurée en 1854 et son prolongement, un peu plus tard, avec la gare du Nord. Rapidement considérée comme une « barrière de croissance » dans le développement des communes, des tronçons de cette ceinture ont été déplacés quelque peu (jusqu’à plusieurs dizaines de mètres) vers l’Est.
Lors de cette visite guidée vous découvrirez cette ancienne voie qui se fait aujourd’hui très discrète. Ses traces s’avèrent pourtant bien visibles pour qui prend la peine de les découvrir.
| RÉSERVER VOTRE VISITE INDIVIDUELLE |
Comme toutes nos visites, ce tour peut également être organisé sur commande, pour passer un bon moment entre collègues ou amis.
| COMMANDER VOTRE VISITE SUR MESURE |

Imaginez un lundi matin de juillet 2022 : une dizaine de personnes se rencontrent dans le cimetière de Molenbeek et vont y passer la journée. Il fait chaud, l’ambiance est détendue et les participant.e.s à l’atelier « Le cimetière, la mort et nous » sont curieux.ses d’entamer cette drôle de semaine durant laquelle nous ne parlerons que de cimetière et de mort.
Activité de prise de parole pour mieux faire connaissance, visite guidée du cimetière et, l’après-midi, un atelier photo, sont au programme de cette journée mémorable passée dans un cimetière. Le reste de la semaine sera fortement marqué par cette première journée.
Le mardi matin, heureux.ses de nous retrouver, nous entamons la phase d’écriture à La Fonderie. Très vite, les participant.e.s s’ouvrent les un.e.s aux autres et la lecture à voix haute des textes produits provoque des émotions variées : certains textes émeuvent aux larmes, d’autres nous font pleurer de rire. Respect, ouverture, curiosité, tendresse, nostalgie… sont au rendez-vous.
Ajoutez à cela un atelier collage le jeudi et une introduction à l’art de l’origami le vendredi, et vous obtenez le livre-témoignage Le cimetière, la mort et nous. Vous pouvez acheter la publication à l’accueil du Musée bruxellois des industries et du travail (9€).
Le livre est accompagné d’une fiche pédagogique et de pistes d’exploitation pour groupes d’adultes. Vous pouvez recevoir la fiche sur simple demande à ep@lafonderie.be.
Deux autres ateliers d’écriture ont eu lieu, en 2023, autour de la même thématique. Des textes y ont été produits, que vous pouvez retrouver ici : https://sites.google.com/view/lecimetierelamortetnous/accueil
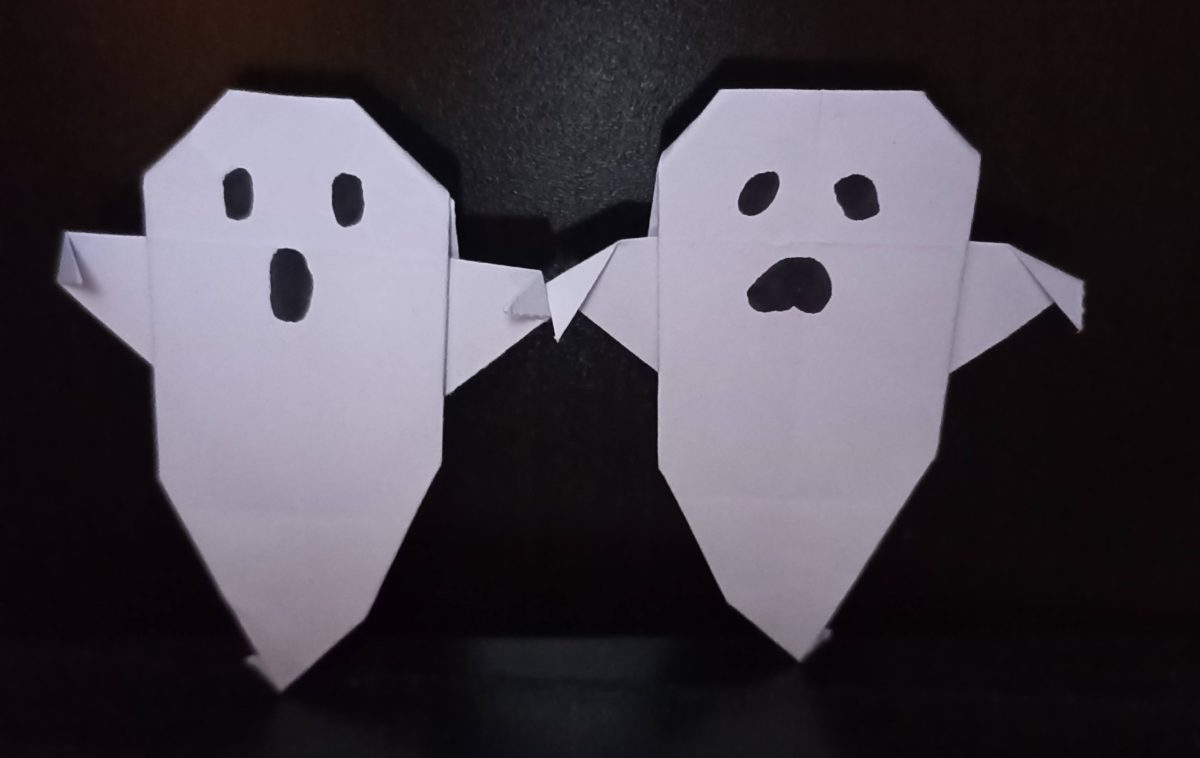
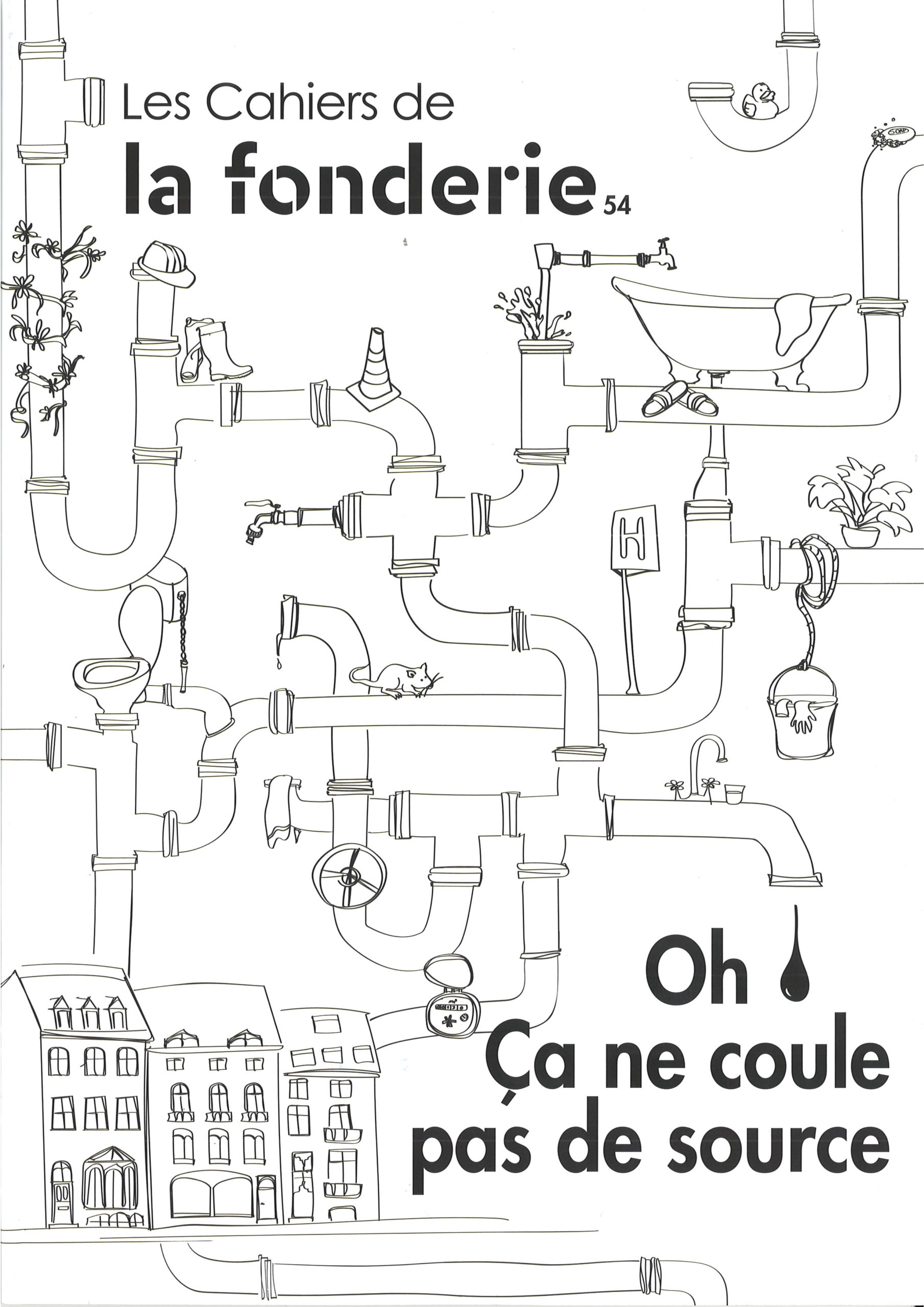
L’exposition « Oh! Ça ne coule pas de source » s’est tenue à La Fonderie d’octobre 2021 à juin 2022, à l’occasion des 130 ans de Vivaqua.
Conçue à partir de recherches historiques originales, cette exposition cherchait à rendre visible « tout » ce qui permet aux Bruxelloises et Bruxellois d’avoir accès à l’eau au quotidien. D’où vient l’eau que nous utilisons chaque jour ? Comment arrive-t-elle à Bruxelles ? Depuis quand y a-t-il de l’eau dans nos maisons ? A quoi sert-elle exactement ? Qu’arrive-t-il une fois qu’elle rejoint les égouts ? Où va-t-elle ? Comment fait-on pour se laver quand on n’a pas de chez soi ? Qui veille à ce que tout fonctionne ? Pourquoi doit-on payer l’eau ?
Toutes ces questions, et bien d’autres, étaient abordées au cours d’un parcours « de la source à l’égout », interactif et magnifiquement scénographié, y compris pour les plus petits. Vous l’avez manquée ? Quel dommage !
Heureusement, le présent Cahier, richement illustré, permet de retrouver l’essentiel des sujets traités dans l’exposition… et même davantage. On y découvrira différentes facettes de l’histoire de l’eau quotidienne à Bruxelles pour s’apercevoir qu’elle est loin de n’être qu’une « ressource naturelle » qui « coulerait » de source. En effet, elle est au cœur de questions sociales, politiques, culturelles, techniques et environnementales que chaque époque doit réactualiser. Riche d’une douzaine de contributions originales et agrémenté d’interviews de travailleurs et d’acteurs de l’eau, ce Cahier n°54 réactualise lui aussi les questions posées dans le n°16 paru en 1994.
Sommaire :
INFRASTRUCTURES ET MÉTIERS
DE L’EAU CHEZ SOI
DE L’EAU HORS DE CHEZ SOI
DE L’EAU A PAYER
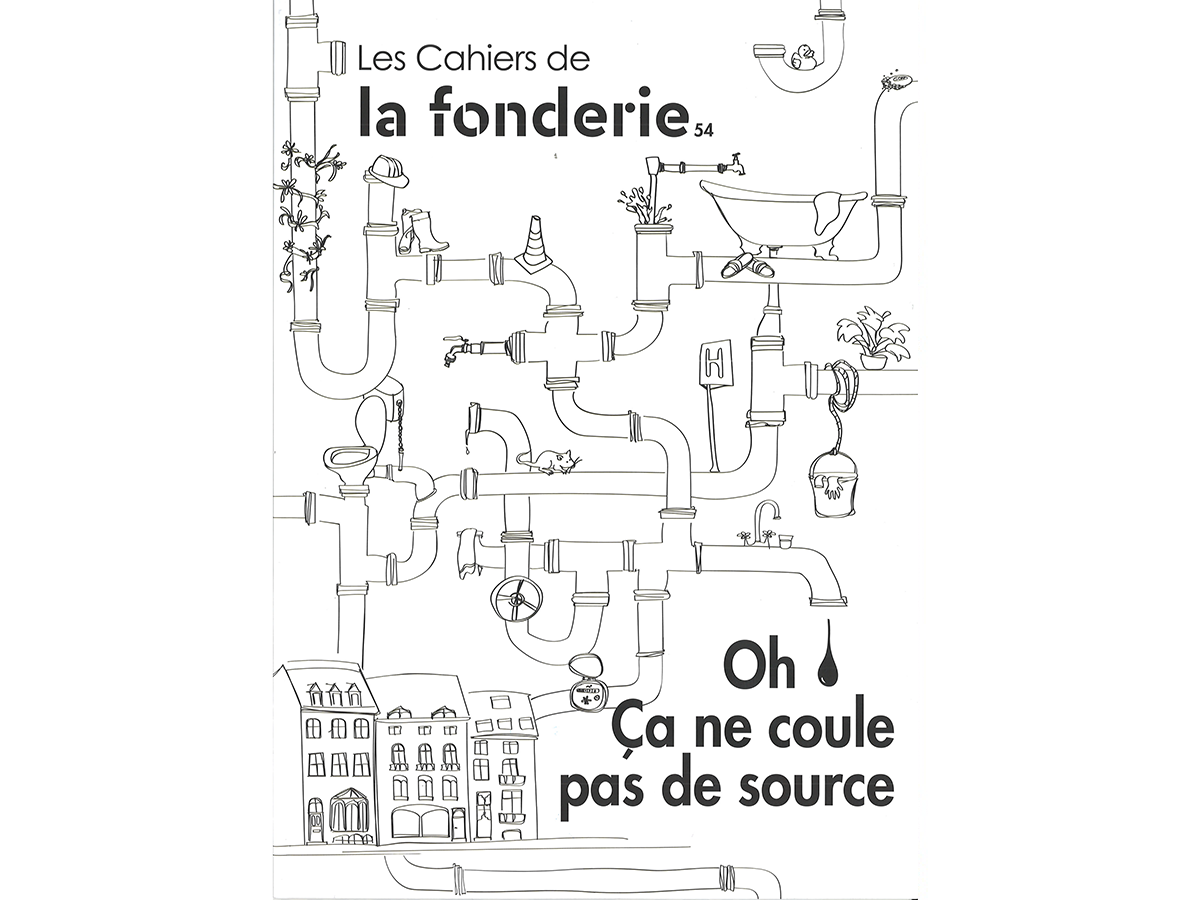
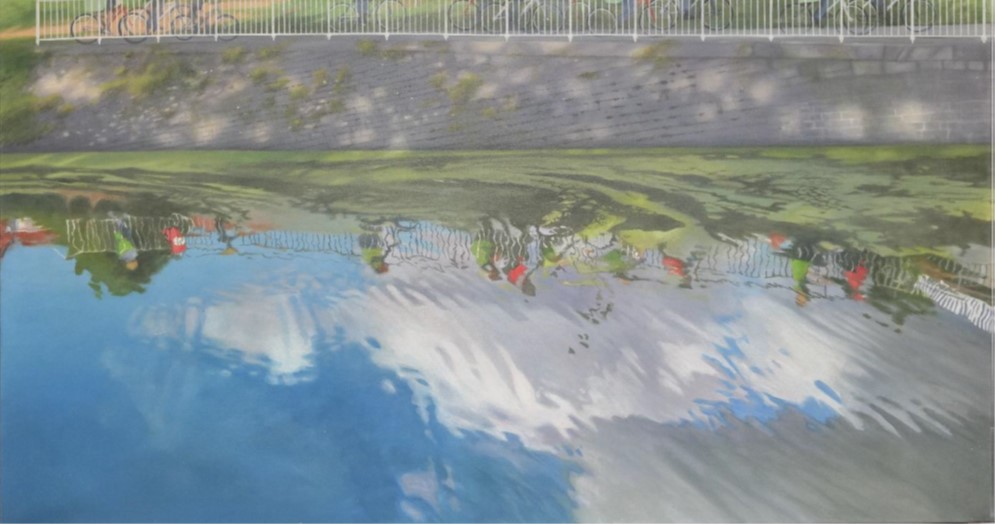
Année de création
2022
Description de l’outil/du service
Ce dossier invite les groupes à aborder une série de questions, débats et ateliers en utilisant leurs savoirs propres comme base de travail. Il peut être utilisé avant, pendant ou après la visite de l’exposition Le canal d’Obolensky et, pour une bonne partie des activités proposées, peut même être utilisé tout à fait indépendamment de la visite de l’exposition.
Objectif
Faire émerger des groupes d’utilisateurs un savoir qu’ils seront ensuite amenés à partager et structurer. Aborder une série de questions de société à partir de l’exposition, ou indépendamment de celle-ci.
Public
Ce dossier s’adresse aux formateurs, enseignants et groupes d’adultes dans un cadre d’éducation permanente, de formation, d’études…
Comment l’utiliser ?
Le dossier liste et explique une série d’activités à mettre en place avant, pendant ou après la visite de l’exposition. Le temps de réalisation de ces activités peut varier entre deux heures et une année.
Outil/Service en ligne
Téléchargez le document d’exploitation de l’expo Obolensky.
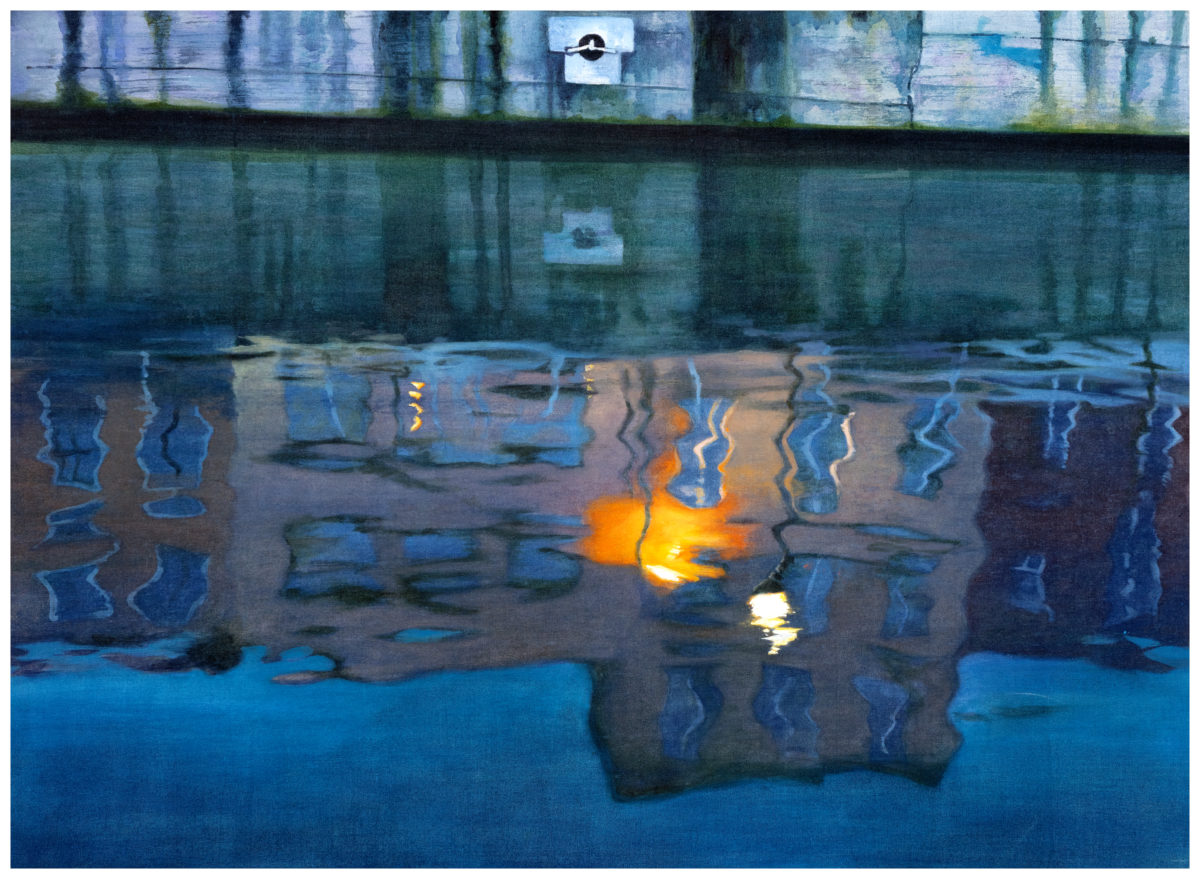
Avez-vous déjà visité votre musée de rêve ? Le musée idéal, celui auquel vous aspirez, l’exposition qui apporterait des réponses à toutes vos questions, le musée qui vous emporterait dans un monde fantasmé ?
Non, jamais ?
Alors venez le dessiner avec nous !
Des séances préparatoires (qu’est-ce qu’un musée ? Quels en sont les lieux-clés ? Qui y travaille et qu’y fait-on ? Comment ça fonctionne ?) et des ateliers de dessin vous sont proposés pour aboutir à une publication qui présentera aux lecteurs votre musée idéal.
Programme et calendrier
Mardi 10 janvier de 18h15 à 20h15 : brainstorming autour de « mon musée de rêve »…
Mardi 17 janvier de 18h15 à 21h15 : visite du musée et rencontre avec le personnel
Mardi 24 janvier de 18h15 à 20h45 : préparation de l’atelier dessin
Mardi 31 janvier de 18h15 à 20h45 : écriture du synopsis, exercices de dessin
Mardi 7 février de 18h15 à 20h45 : scénario et essais graphiques, rencontre avec des scénographes, recherches iconographiques
Mardi 7 mars de 18h15 à 20h45 : découpage technique, exercice d’autoportrait
Mardi 14 mars de 18h15 à 20h45 : différentes techniques de couleurs
Mardi 21 mars de 18h15 à 20h45 : mise au propre et encrage
Mardi 28 mars de 18h15 à 20h45 : finalisation des dessins
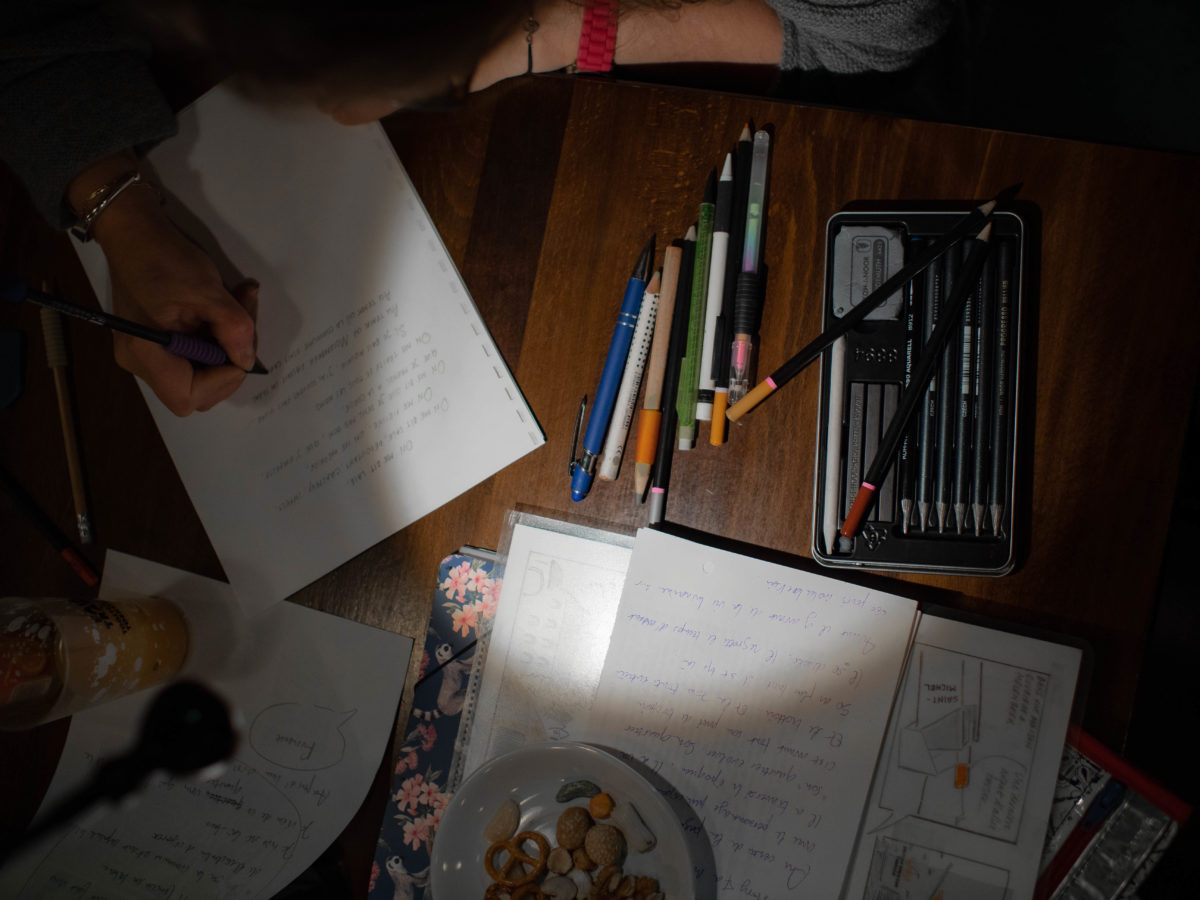
SOMMAIRE DU POSTE
L’employé(e) d’accueil travaille dans les domaines de l’accueil du musée, de la gestion des locaux et des services rendus aux visiteurs.
VOTRE PROFIL
Qualifications et expérience
Savoir être
NOUS VOUS OFFRONS
Candidatures à adresser pour le 10 novembre 2022 au plus tard à emploi@lafonderie.be
Informations auprès de Mathias Mellaerts, Directeur
mathias.mellaerts@lafonderie.be – 02/413 .11.73
Attention : Poste ACS uniquement
La Fonderie asbl est ouvert à la diversité des candidat.e.s, sans distinction de sexe, religion, couleur de peau, nationalité, orientation sexuelle ou handicap. Dans sa pratique, La Fonderie applique une politique offrant l’égalité des chances, qui consiste à offrir un traitement équitable dans tous les aspects de l’emploi en s’interdisant toute forme de discrimination.

SOMMAIRE DU POSTE
Le/la responsable des parcours et des publics :
Parcours
Publics
VOTRE PROFIL
Qualifications et expérience
Savoir être
NOUS VOUS OFFRONS
Candidatures (CV + Lettre de motivation) à adresser pour le 10 novembre 2022 au plus tard à emploi@lafonderie.be
Informations auprès de Mathias Mellaerts, Directeur
mathias.mellaerts@lafonderie.be – 02/413 .11.73
Attention : Poste ACS uniquement
La Fonderie asbl est ouvert à la diversité des candidat.e.s, sans distinction de sexe, religion, couleur de peau, nationalité, orientation sexuelle ou handicap. Dans sa pratique, La Fonderie applique une politique offrant l’égalité des chances, qui consiste à offrir un traitement équitable dans tous les aspects de l’emploi en s’interdisant toute forme de discrimination.

La Fonderie ASBL incarne un lieu emblématique, témoin du passé industriel de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. L’association créée en 1983 travaille à la mise en lumière du patrimoine lié directement à ce passé et la multitude de thématiques et problématiques qu’il soulève via différentes activités :

SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité du directeur et la supervision du conservateur, la personne titulaire du poste oeuvre à divers projets éducatifs, principalement la conception, le développement et l’organisation d’activités éducatives intégrées au programme de médiation de La Fonderie. Il.Elle fera progresser les missions de La Fonderie en matière d’éducation auprès des publics multiples de l’asbl.
Création
• Vous assurez la mise en place d’un programme d’activités éducatives à La Fonderie : animations scolaires, activités extra scolaires, animations pour adultes, visites guidées, stages… ;
• Vous contribuez à développer des dispositifs de médiation dans les expositions ;
• Vous créez des outils d’animation, en améliorez d’autres;
• Vous créez des dossiers interdisciplinaires et mallettes pédagogiques, des éditions papier et numériques… ;
• Vous participez à toute autre tâche connexe de l’asbl pour contribuer à la bonne médiation de ses activités.
Animation
• Vous animez ou guidez des groupes d’âge et de provenance diverses ;
• Vous maitrisez les techniques d’animation de groupes ;
• Vous connaissez les différents programmes scolaires et pouvez y rattacher vos animations.
Gestion et promotion
• Vous assurez la promotion des ressources et des activités pédagogiques par une information et une sensibilisation des enseignants ;
• Vous soutenez le recrutement, la formation et la supervision des prestataires extérieurs ;
• Vous intégrez La Fonderie à des réseaux utiles au soutien du développement de la médiation
culturelle du musée ;
• Vous appuyez la gestion logistique des différentes activités (réservations, listes de contacts, évaluations…).
VOTRE PROFIL
Qualifications et expérience
• Diplômé.e en Histoire, Histoire de l’art, Médiation culturelle ou discipline connexe … (baccalauréat ou master), avec une expérience en éducation (enseignement, médiation,…)
• Maîtrise de la communication orale, écrite et non verbale ;
• Maîtrise des méthodes de médiation muséale ;
• Expérience dans l’apprentissage numérique ;
• Une expérience dans le service éducatif d’un musée est un atout important ;
• Poste ACS uniquement
Savoir être
• Vous êtes à l’aise avec différents publics et pouvez adapter votre discours ;
• Vous maitrisez le français, avec une connaissance du néerlandais ;
• Vous êtes bien organisé.e et avez de bonnes compétences en matière de gestion du temps ;
• Vous avez le sens du contact et du service, et des responsabilités;
• Vous êtes capable de trouver rapidement des solutions pratiques ;
• Vous avez l’esprit d’équipe et êtes prêt.e à travailler sur des projets collectifs ;
• Vous êtes intéressé.e par l’histoire industrielle et divers domaines liés à la compréhension de ville.
• Vous avez un intérêt pour l’histoire de Bruxelles
NOUS VOUS OFFRONS
• Un CDI temps plein (barème du non marchand) ;
• Un horaire fixe (du lundi au vendredi, de 9h à 17h), mais prestations occasionnelles en soirée/week-end ;
• Le défi d’une stratégie éducative à concevoir et réaliser ;
• Une collaboration à une association alliant diversité, dynamisme et rigueur scientifique.
Candidatures à adresser pour le 15 septembre 2022 au plus tard à emploi@lafonderie.be
Informations auprès de Pascal Majérus, Conservateur (pmajerus@lafonderie.be)- 02/413.11.87
Attention : Poste ACS uniquement
La Fonderie asbl est ouvert à la diversité des candidat.e.s, sans distinction de sexe, religion, couleur de peau, nationalité, orientation sexuelle ou handicap. Dans sa pratique, La Fonderie applique une politique offrant l’égalité des chances, qui consiste à offrir un traitement équitable dans tous les aspects de l’emploi en s’interdisant toute forme de discrimination.

Élaborée à l’occasion des 130 ans de Vivaqua, elle visait à rendre visible ce qui a permis et ce que nécessitent des gestes simples et quotidiens comme remplir un verre d’eau, prendre une douche ou tirer la chasse, des pratiques devenues tellement ordinaires qu’elles ne sont plus remises en question. Ce projet a été, pour ses commissaires Chloé Deligne, Ananda Kohlbrenner et Sophie Richelle, toutes trois historiennes, l’occasion de présenter sous une forme nouvelle et à destination d’un large public les recherches qu’elles mènent à l’Université Libre de Bruxelles.
« Cette exposition a été pour nous une merveilleuse opportunité d’explorer de nouveaux moyens de diffuser et d’échanger sur nos travaux, notamment avec le jeune public en imaginant une série de dispositifs interactifs et didactiques pour lui permettre d’apprendre en s’amusant (observation au microscope, expérience des vases communicants, traversée d’un tronçon d’égout avec un déguisement d’égoutier…). Avec cette exposition, nous souhaitions rendre accessibles au plus grand nombre des contenus scientifiques complexes sans pour autant les simplifier. Ce que nous voulions c’était inviter le public à adopter un regard réflexif sur nos usages quotidiens de l’eau, les infrastructures et les pratiques dont nous sommes aujourd’hui les héritiers, mais aussi sur les problématiques sociétales contemporaines liées à l’accès à l’eau et à la pollution de celle-ci. Par exemple : comment expliquer qu’on utilise de l’eau potable pour évacuer nos déjections ? Pourquoi les bains publics ont presque tous disparu alors qu’aujourd’hui à Bruxelles, on compte un nombre toujours plus important d’habitants n’ayant pas accès à des sanitaires ? »
Pour réaliser ce projet, nous avons eu la chance de bénéficier des compétences, du savoir-faire et de l’enthousiasme de l’équipe de La Fonderie : Pascal Majérus (conservateur), Françoise Marneffe (chargée des expositions et coordinatrice du projet) et Luiza Mitrache (responsable du service éducatif) qui nous ont chaleureusement fait bénéficier de leur expérience muséographique et qui nous ont tant appris et apportés.
Nous avons aussi eu le plaisir de collaborer avec les deux scénographes d’Ad Hoc Studio, Noémie Giovanetti et Jérémy Husquin, qui ont relevé, dans la joie, tous les défis soulevés par cet ambitieux projet et qui ont si bien su lui donner forme. »
L’exposition est aujourd’hui finie, mais elle a donné lieu à un numéro des Cahier de La Fonderie (à paraître prochainement) qui permettra encore de prolonger cette belle aventure.

Lors du dernier quadrimestre de l’année dernière, une douzaine d’étudiants en option “podcast” du Master en journalisme de l’ULB a investi, les jeudis après-midi, les salles des dessinateurs et des électriciens de La Fonderie. Et c’est alors que ce “R” plein de fougue et d’histoires s’est glissé entre la première et la deuxième lettre de La Fonderie.
Les traces de son histoire parfois chaotique et de ses révoltes pour la préservation de la mémoire ouvrière et la défense du droit à la ville pour tous et toutes, ses ruines romanesques et si calmes dans un quartier si dense, tout cela et d’autres choses encore ont été le terreau d’une création radiophonique inventive, documentée et questionnante. À travers des reportages, des chroniques, des interviews et même quelques paroles, paroles, paroles, hymne des Marolles, on y croise l’esprit de fronde entre autres de Guido, de Baltasar et de Laetitia.
Le 19 décembre dernier, lors d’une diffusion en direct depuis La Fonderie, on a été à la fois touchés et impressionnés de découvrir, à travers cette création radiophonique, des points de vue, des regards, des sonorités et des façons différentes d’habiter la ville.
Aujourd’hui en ligne, on a juste envie de vous la faire entendre : écoutez-la ici.

Le développement urbain, le besoin du jeune État belge de renforcer son identité nationale, la maîtrise technique et le contexte artistique de l’époque expliquent ce phénomène. La Compagnie des Bronzes, dont l’ancienne usine est aujourd’hui occupée par La Fonderie, a tiré parti de cet engouement pour réaliser nombre de statues monumentales. Le site BE-Monumen, qui recense les œuvres en bronze et en fonte produites par des fonderies belges, témoigne de l’ampleur de cette production. https://be-monumen.be/
Aujourd’hui, l’installation de sculptures monumentales en bronze est beaucoup plus rare à Bruxelles. L’apparition du Nauti-Poulpe d’entre les pavés de la place Poelaert suscite donc étonnement et enthousiasme. Créée par l’illustrateur François Schuiten et par le sculpteur Pierre Matter, cette sculpture en bronze de 12 tonnes rend hommage à Jules Verne et à son roman Vingt mille lieues sous les mers. Inspirée par celui-ci, elle représente une créature hybride, entre animal et engin sous-marin, émergeant des profondeurs de la ville.
Réaliser le Nauti-Poulpe a été un défi de taille pour les Fonderies de Saint-Sauveur. Composée de plus de 120 pièces, dont 300 ventouses sculptées à la main, l’œuvre mesure 6 mètres de haut et 9,5 mètres de long. Sa fabrication a duré près de sept ans, mobilisant une dizaine de salariés.
Le Nauti-Poulpe ne restera que trois mois à Bruxelles avant son inauguration officielle à Amiens le 24 mars 2025.
Que pensez-vous de la présence de sculptures monumentales dans nos villes ? Est-ce un moyen de célébrer notre patrimoine ou une source de débat pour les habitants ?



Chers publics,
Dans le cadre d’un dispositif d’enquête auprès des publics proposé par Musée 22, La Fonderie à besoin de votre avis !
La Fonderie attache une grande importance à votre avis ! Nous voulons savoir où nous réussissons bien, où nous pouvons nous améliorer et comment nous pouvons rendre votre expérience muséale aussi agréable que possible. Nous aimerions donc vous demander de remplir notre enquête et de nous aider.
Voici le lien cliquable vers l’enquête
https://www.cult22.eu/be/3971?lang=fr
L’enquête est totalement anonyme et prendra environ 10 minutes de votre temps.
Pour vous remercier, World Land Trust sauve 1 m² de forêt tropicale en voie de disparition pour chaque enquête réalisée. Vous avez également une chance de gagner l’un des bons d’achat Bongo d’une valeur de 250 €.
Vous pouvez répondre au sondage jusqu’au 30 septembre 2022.
Toute l’équipe de La Fonderie vous remercie.
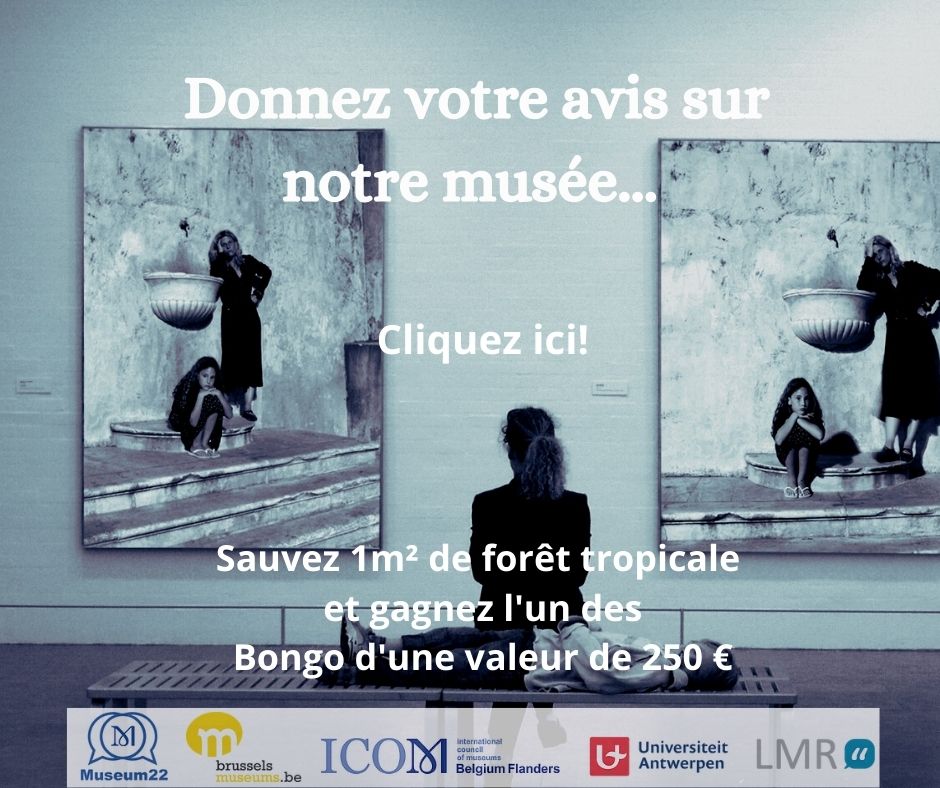
Jadis, le jardin botanique de Bruxelles a connu une fonction scientifique de conservation et de recherche en botanique et horticulture. Elle l’a ensuite perdue au profit du Jardin botanique de Meise. Malgré les nombreux travaux qui l’ont amputé au cours du 20ème siècle, il reste l’un des plus anciens et des plus beaux parcs publics de la capitale. Dès sa création en 1829, et jusqu’à nos jours, l’endroit est un lieu de promenade apprécié. L’art et la culture y ont leur place : concerts en plein air, sculptures en bronze etc. Ces dernières forment un ensemble assez exceptionnel qui nous permettra d’aborder technique de production, courants artistiques et significations symboliques… Cette visite guidée vous fera bondir dans le passé !

Il s’agit de La Fonderie et son musée, installés sur le site d’une prestigieuse fonderie d’art, la Compagnie des Bronzes. Cette entreprise était une fonderie à la réputation internationale. Les commandes prestigieuses y furent nombreuses : des grilles du zoo de New York aux statues de la Reine Victoria, en passant par le Brabo à Anvers ou le t’Serclaes de la Grand Place. Durant 125 ans, cette société a contribué à introduire l’art dans l’espace public grâce à la statuaire monumentale ou dans les foyers par l’importante production en série d’œuvres d’art ou d’objets décoratifs.
Lancée en 1854, la Compagnie a connu une croissance rapide. Elle a acheté en 1860 un terrain à Molenbeek pour construire une usine et étendre ses activités. Ce faubourg de Bruxelles offrait de grandes superficies à prix abordable. Il offrait aussi la possibilité d’installer une machine à vapeur et des logements pour les ouvriers. La proximité du canal de Charleroi et des chemins de fer rendait le lieu idéal pour y implanter ses activités productives.
Laissé à l’abandon après la faillite de l’entreprise à la fin des années 70, l’ancienne usine a été rachetée par la Communauté française en 1981 à l’initiative du Collectif du Vieux Molenbeek. Le site est inscrit sur la liste de sauvegarde du patrimoine immobilier de la Région bruxelloise.
Venez découvrir cette histoire…


— Visite annulée ! —
Si les statues et les sculptures ponctuent l’espace urbain. Elles sont particulièrement présentes dans le haut de la ville. Du palais de Justice au Parc Royal, elles témoignent de choix politiques posés depuis l’indépendance de la Belgique et sont autant d’expressions des pouvoirs en place. Héros, allégories ou personnages marquants, ces statues de pierre ou de bronze célèbrent de multiples valeurs.
Les innombrables controverses suscitées aujourd’hui par certaines d’entre elles indiquent bien que leur place dans l’espace public ne va plus de soi. Ce parcours se propose de mieux les connaitre pour bien en mesurer les enjeux.

Cette visite guidée aborde des aspects de la longue l’histoire qui relie le Congo et Bruxelles. Officieusement ou officiellement, la ville a longtemps tenu lieu de capitale imposée à ce pays immense et lointain. Cette relation inéquitable a laissé des traces encore présentes dans la ville d’aujourd’hui. Certaines sont discrètes, d’autres sont évidentes : monuments, immeubles prestigieux ou grandes réalisations urbanistiques. Chacune offre l’occasion d’évoquer ce pan de notre histoire controversé et parfois occulté.
De la Porte de Namur jusqu’au Cinquantenaire, ce parcours nous amène à nous interroger sur ce passé colonial qui se rappelle régulièrement à nous.
Sous Léopold II, bien avant l’exploitation du caoutchouc et la découverte des richesses en minerais que renferme le sous-sol du Congo, l’une des principales sources de revenus de la colonie est l’ivoire. Pour en stimuler le commerce, l’Etat Indépendant du Congo fait appel aux sculpteurs belges les plus renommés. Il leur offre des défenses pour qu’ils réalisent des œuvres à exposer dans le cadre des expositions coloniales de 1894 et 1897. Une vingtaine de ces sculptures « chryséléphantines » au style Art Nouveau, dont celles de Philippe Wolfers, Julien Dillens ou Charles Van der Stappen, sont toujours visibles au Musée d’Art et Histoire du Cinquantenaire. De 1889 à 1908 près de 5000 tonnes d’ivoire, provenant de près de 100 000 éléphants transiteront par le port d’Anvers.

Visite guidée du 29/08 malheureusement annulée pour raisons de santé.
Cette visite guidée vous amène sur les traces d’une rivière oubliée : Le Maelbeek. Ce cours d’eau a pourtant été déterminant pour l’émergence des villages d’Ixelles, Etterbeek, Saint-Josse et Schaerbeek. Comme la Senne, elle fut voûtée dans la seconde moitié du 19e siècle. Si elle semble avoir disparu du paysage, il en reste néanmoins des traces bien plus nombreuses que vous ne pourriez le penser.
Cette balade vous mènera à la découverte de ce mystérieux Maelbeek. De La Cambre au Parc Léopold en passant par les étangs d’Ixelles et Flagey, le Parc Léopold, … Ces hauts-lieux bruxellois vous sont certainement connus. Cependant, nous allons vous les faire re-découvrir sous un jour différent.
Parmi les affluents du Maelbeek, le Broebelaer – qui prend sa source à Etterbeek- eut un destin « princier» au 17ème siècle. En effet, ses eaux furent déviées pour installer des jeux d’eau dans les jardins du Coudenberg, résidence des Archiducs Albert et Isabelle. La rue Hydraulique est un rappel du trajet des conduites d’eau jusqu’à une tour de la seconde enceinte.
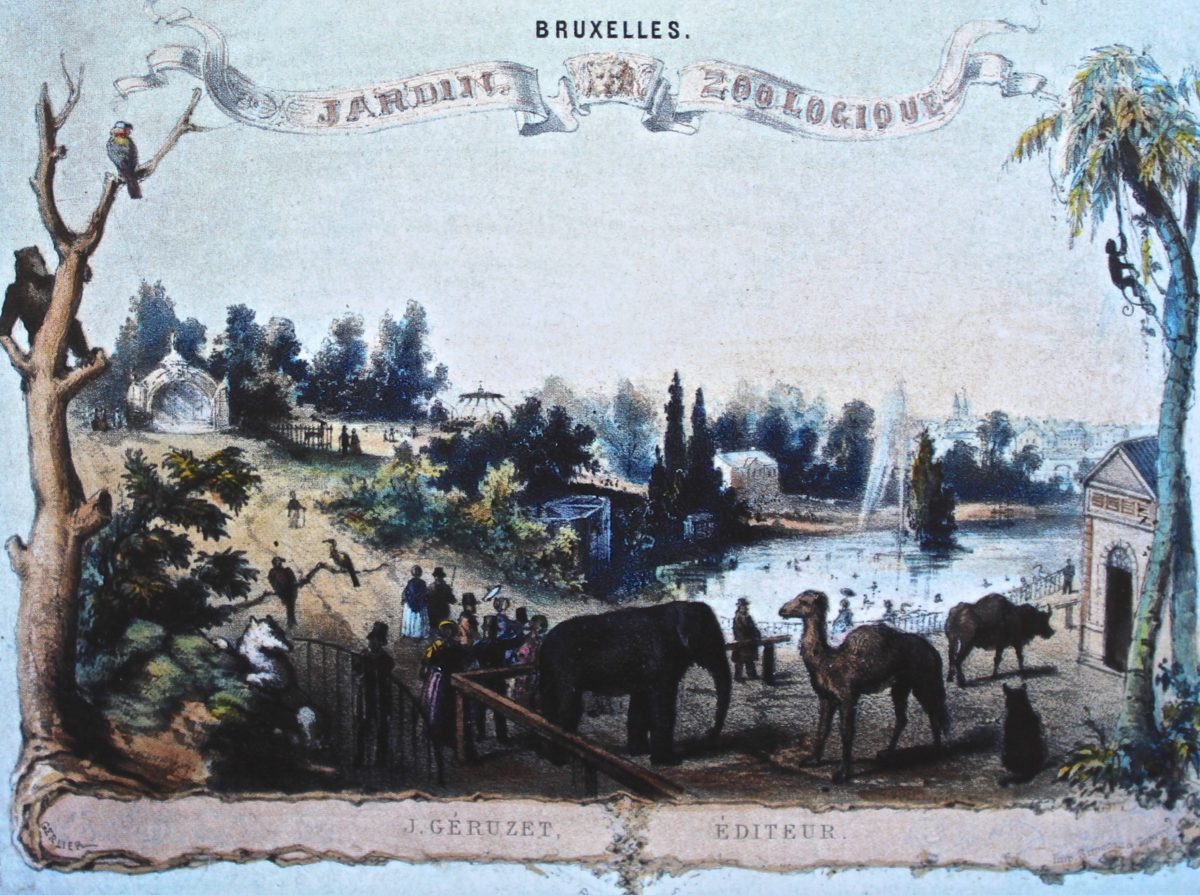
La controverse perdure à propos des pavés bruxellois. Ils sont perçus par certains comme un archaïsme néfaste dont il faut se débarrasser. D’autres les considèrent comme un trésor, fruit du labeur et de l‘habileté de nos grands-parents. Cette visite vous fera découvrir ce joyau méconnu de notre patrimoine, humbles pierres sur lesquels nous marchons sans faire attention. Vous apprendrez la grande diversité des pavés bruxellois, d’origine, de couleur, de texture, de relief, de format et de matériaux variés. A l’issue de cette visite vous pourrez les reconnaître au premier coup d’œil !

C’est autour des méandres de la Senne, au creux de la vallée, que notre ville s’est développée au cours des siècles. Cette balade à pied du centre-ville à l’écluse de Molenbeek retrace cette histoire et met en lumière les liens si étroits qui unissaient autrefois Bruxelles et sa rivière. Peut-on encore imaginer aujourd’hui la vie sans l’indispensable eau courante ?

Les mesures sanitaires actuelles ne nous permettent pas de vous proposer certaines parties de ce parcours dans les conditions adéquates. Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler la date du 29 novembre 2020. Nous vous re-proposerons cette visite guidée en 2021.
Cette visite guidée nous emmène des prestigieuses Galeries St-Hubert jusque chez Choco-Story, le musée du cacao et du chocolat. Elle explore et décortique notre passion pour cette denrée appréciée de tous. On y découvre l’histoire des grands noms qui ont fait la réputation de Bruxelles et de la Belgique dans le monde du chocolat. Et on termine par une démonstration de sa fabrication.
Les étapes de ce parcours comprennent entre autres les Galeries Royales St-Hubert, les maisons Neuhaus, Pierre Marcolini, Leonidas, Godiva et Choco-Story.

Des échoppes et du marché moyenâgeux au grand magasin du début du 20ème siècle, Bruxelles a connu une grande diversité de lieux mercantiles. Lors de cette visite guidée, nous vous invitons à découvrir l’histoire du commerce.
Nous revivrons en particulier les évolutions du 19ème siècle : la naissance des marchés couverts et galeries, le soin de plus en plus grand apporté aux devantures pour attirer le chaland et l’apparition des boutiques de nouveautés et grands magasins. Nous nous intéresserons également aux demoiselles de magasin, thème du roman de Zola “Au bonheur des dames”. Nous aborderons aussi l’histoire d‘enseignes emblématiques. Et enfin celle de la rue Neuve et des boulevards centraux qui jouent aujourd’hui encore un rôle commercial majeur.
“Lors de l’apparition des grands magasins, tout est mis en œuvre pour tenter le client – en particulier la femme ! L’architecture joue elle aussi son rôle. Ainsi, Victor Horta, architecte de l’Innovation, disait qu’il fallait « accrocher le passant en dehors pour en faire un acheteur et celui-ci une fois dans la ‘cage’, l’obliger de passer et de s’arrêter devant la moindre marchandise exposée .»

Au milieu du 19e siècle, La Belgique est le pays le plus progressiste et « libre » d’Europe continentale. A l’instar de Londres, elle accueille un grand nombre de réfugiés politiques. Plusieurs ont joué un rôle important dans l’histoire du socialisme comme Marx, Proudhon ou encore Blanqui. Leurs trajectoires se sont croisées à Bruxelles qui a s’est trouvée profondément marquée par leur passage. Cette visite guidée nous fera marcher dans leurs pas, racontant leur histoire, celle des grands socialistes belges et des mouvements ouvriers…

La Grand Place n’a pas toujours revêtu les atours qu’on lui connait aujourd’hui. En effet, elle a subi des modifications nombreuses et parfois importantes au fil des siècles… Lieu du pouvoir de la ville, elle était au centre d’enjeux politiques, corporatistes, religieux, sociaux ou encore architecturaux. Cette visite guidée vous propose un regard approfondi sur l’histoire de cette place que beaucoup considèrent comme la plus belle du monde !
La Maison du Roi d’Espagne est typique du style architectural adopté pour reconstruire la Grand-Place après le bombardement de Bruxelles en 1965 par le Duc de Villeroy, grand maréchal de Louis XIV. Le style baroque prévaut en cette fin de 17ème Siècle et on n’est pas avare de décorations extravagantes et de fioritures. Celles-ci se réfèrent notamment aux grands personnages soit contemporains soit de l’Antiquité. Cette maison appartenait à la corporation des boulangers. D‘ailleurs, la porte d’entrée est surmontée de la statue de saint Aubert, patron des boulangers. Ensuite, on retrouve quatre médaillons représentant des empereurs romains : Marc Aurèle, Dèce, Trajan et Nerva. En son centre, une sculpture figure Charles II d’Espagne, souverain des Pays-Bas espagnols, triomphant de ses ennemis. Il est ainsi flanqué d’un côté par un Mapuche du Chili et l’autre côté par un Turc ottoman. Enfin, la balustrade dans la partie supérieure de la maison est ornée de sculptures figurant des divinités romaines en rapport avec la boulangerie. Hercule symbolise la force nécessaire pour pétrir la pâte. Cérès déesse de l’agriculture représente le blé. Boréas, dieu du vent, dissémine les céréales. Vesta, déesse du feu, pour cuire le pain. Neptune, dieu de l’eau. Et Minerve déesse de la prévoyance, qualité indispensable dans le commerce.

Avec cette visite guidée, nous vous invitons à explorer l’univers très mouvementé de l’enseignement à Bruxelles. Au 19ème siècle, les élites bruxelloises étaient soucieuses de soutenir l’émancipation des masses grâce à l’école. Des réseaux scolaires remarquablement diversifiés se sont dès lors développés. C’est l’histoire de la confrontation idéologique entre catholiques et tenants de laïcité. Nous vous raconterons cette rivalité qui a amené les uns et les autres à adopter des orientations architecturales très typées. Et nous décortiquerons l’architecture de ces écoles, projets ambitieux qui ont permis aux architectes les plus réputés de l’époque, dont Horta, d’exprimer tout leur talent.
“Si l’enseignement coûte trop cher, essayez l’ignorance !” Abraham Licoln.
Impossible d’évoquer l’essor de l’enseignement bruxellois au 19ème siècle sans penser au bourgmestre Charles Buls. Partout dans la ville, Buls a essaimé les traces monumentales de son combat contre les diktats budgétaires. Enjeu qui demeure, aujourd’hui encore, brûlant d’actualité…”
| ACHETER VOTRE TICKET |

La Révolution industrielle a profondément modifié l’économie, la politique et les rapports sociaux de notre pays jusqu’à aujourd’hui. L’exposition Made in Brussels vous montre comment Bruxelles s’est développée autour de ses industries. Ensuite, l‘exposition vous présente quatre secteurs industriels essentiels de la ville et de son histoire. Le secteur du métal, dont le site de l’ancienne Compagnie des Bronzes est un témoin privilégié. Celui du bois, élément essentiel à la construction et l’aménagement d’une ville. La confection textile, historiquement un des secteurs les plus importants à Bruxelles. Et enfin la production alimentaire qui a nourri des habitants toujours plus nombreux.

Chaque module est articulé autour de deux machines « vedettes » permettant de développer une série de thèmes : les techniques, l’histoire d’une entreprise, la condition ouvrière, le travail à domicile ou en usine, le commerce, etc. La diversité de chacun de ces secteurs est illustrée au travers de produits manufacturés.
Retrouvez toutes les informations pratiques de notre musée – adresse, horaires, contact – en cliquant ici.
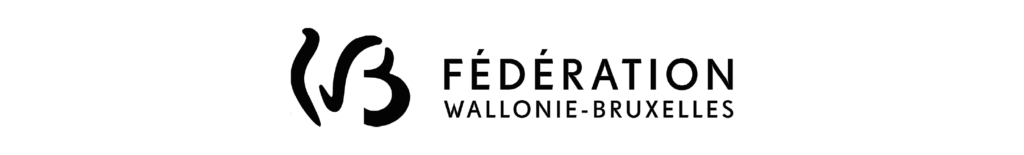

Afin de recycler ses eaux usées, Singapour a construit une usine de grande ampleur, mobilisant des technologies à la pointe de l’innovation telles que la microfiltration, la filtration membranaire et la nanofiltration. Les eaux retraitées couvrent déjà 40 % des besoins de Singapour qui était jusque-là entièrement dépendante des ressources en eau de la Malaisie. Une telle prouesse offre-t-elle des pistes propices à une utilisation plus durable et circulaire des eaux? La mise en place d’un tel système à Bruxelles est-il désirable ?

Un traitement complexe
La station d’épuration des eaux usées (STEP) de Bruxelles Sud, qui vient d’être rénovée, dispose déjà, comme celle de Singapour, d’un système de traitement membranaire qui lui permet d’extraire des eaux usées la plupart des bactéries et des particules microscopiques (tels que les micro plastiques). Par ailleurs, actuellement une partie des eaux usées traitées par cette station sont déjà réutilisées, mais à usage industriel seulement. Comme le souligne un des gestionnaires de cette usine, proposer un traitement des eaux usées encore plus performant supposerait un saut conséquent dans les technologies déployées comme dans les investissements requis. En effet, pour être considérées comme « potables », les eaux doivent répondre à des critères beaucoup plus exigeants que ceux requis à la sortie des stations d’épuration des eaux usées et donc être soumises à un traitement beaucoup plus sophistiqué.
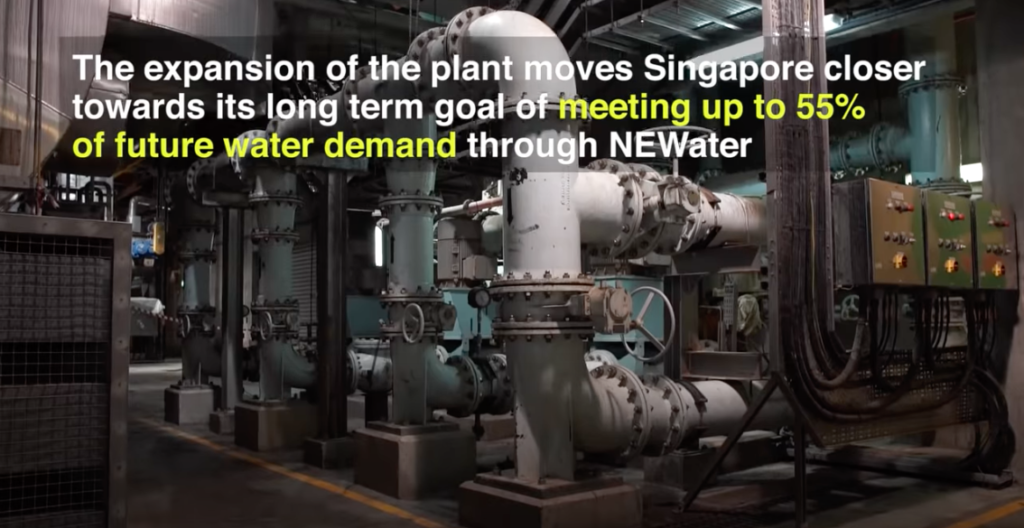
Un coût important
La réutilisation des eaux usées a un coût (Singapour a investi plus de 6,3 milliards d’euros dans ses infrastructures de traitement), mais ce coût n’est pas seulement financier. Si en tendant à recycler à l’infini chaque goutte d’eau, le système mis en œuvre à Singapour pourrait, à première vue, apparaître comme la solution écologique au problème de la pollution et des ressources limitées en eaux, il ne faut pas oublier que pour pouvoir potabiliser les eaux usées, une telle usine consomme de très importantes ressources en énergie.
À titre d’exemple, selon un directeur de l’innovation du groupe Véolia, une station d’épuration traitant quotidiennement les eaux usées de 100 000 habitants a, en moyenne, une consommation énergétique équivalente à celle de 400 habitants, tout usage compris, ce qui est loin d’être négligeable1. Si certaines stations d’épuration sont aussi pourvoyeuses en énergie, en produisant par exemple du biogaz à partir de la digestion des boues d’épuration (comme c’est le cas dans la station d’épuration de Bruxelles Nord, qui a produit 13,5 GWh d’électricité en 2019) cette production ne compense généralement pas l’important besoin énergétique de ces infrastructures (elle ne couvre que 30 % des besoins dans le cas de la Station d’épuration Bruxelles Nord)2.

De plus, les technologies de pointe comme celles employées dans la STEP de la cité-État insulaire reposent sur l’utilisation d’importantes quantités de métaux rares, des matières premières disponibles en quantité limitée sur terre, dont l’extraction devient toujours plus invasive, complexe, énergivores, dévastatrice et dont le recyclage reste peu probable, car trop difficile à mettre en œuvre3.
Prévenir ou guérir ?
En définitive, le recours à des technologies plus performantes va généralement de pair avec une augmentation des coûts économiques et des ravages environnementaux et sociaux qu’elles impliquent. Comme souvent lorsqu’il est question de traitement de pollutions, la question n’est peut-être pas tant : comment traiter ces pollutions de manière plus performante que : comment réduire et limiter, à la source, la production de telles pollutions?
Cet article vous est proposé par Ananda Kohlbrenner. Elle est historienne et urbaniste. Ses recherches, réalisées à l’ULB, ont porté sur l’histoire du traitement des eaux pluviales et usées en Région de Bruxelles-Capitale. Elle est également une des commissaires de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source.
1 Voir : LAPERCHE Dorothee, “Vers des stations d’épuration à énergie positive”, Actu environnement, 15 décembre 2015. [en ligne]
2 Voir : LAPERCHE Dorothee, “Vers des stations d’épuration à énergie positive”, Actu environnement, 15 décembre 2015. [en ligne]
3 Voir à ce propos : BIHOUIX Philippe, L’âge des low tech, Editions du Seuil, 2014.

Aujourd’hui, l’immense majorité des mètres cubes d’eau que consomment les Bruxellois et Bruxelloises provient de Wallonie (66 des 68 millions de mètres cubes acheminés annuellement, soit 97%). C’est Vivaqua, autrefois appelée Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux (CIBE), qui assure son captage, son transport et sa distribution.
Les captages et prélèvements qui assurent cet approvisionnement se situent aussi bien en Brabant wallon (région de Braine l’Alleud), qu’en Hainaut (région de Mons ou d’Ecaussinnes), en province de Namur (région de Spontin, Yvoir) ou de Liège (région de Huy/Modave). Ainsi, quand on ouvre le robinet à Bruxelles, c’est l’interdépendance entre les régions du pays, entre la ville et des territoires plus ruraux, qu’on expérimente très concrètement. L’eau de tous les jours est ainsi un trait d’union entre Bruxelles et la Wallonie.
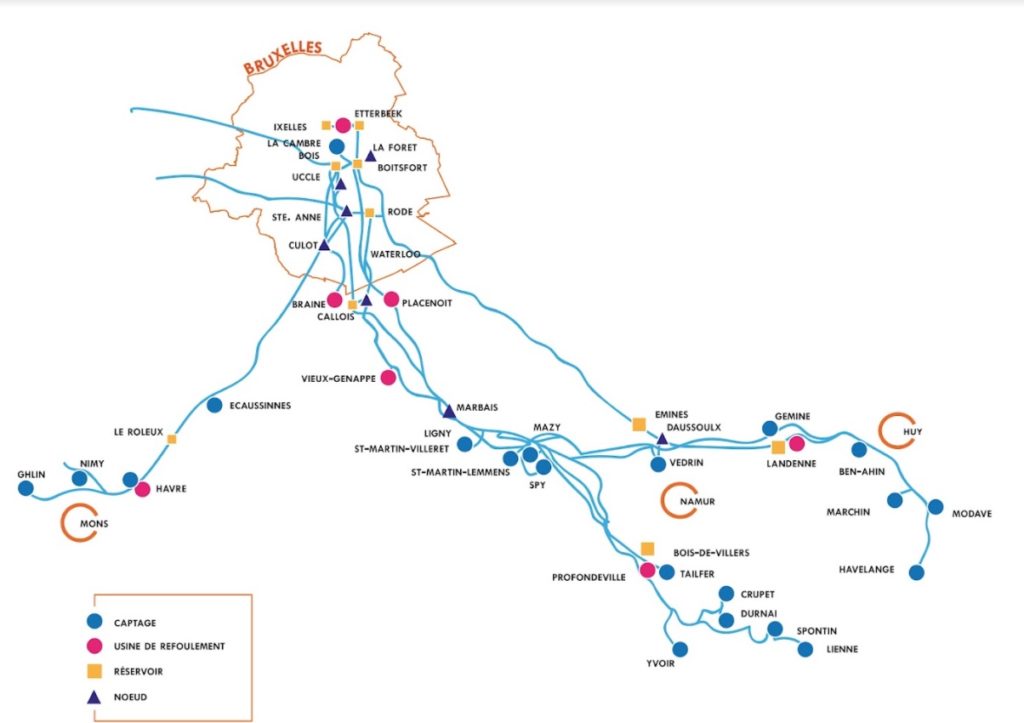
Cette dépendance de Bruxelles vis-à-vis de territoires extérieurs n’est pas vraiment neuve. Au début du 17e siècle, quand Bruxelles était encore enserrée dans ses remparts, des eaux venues du Broebelaer (un petit affluent du Maelbeek à Etterbeek) avaient été amenées grâce à une savante machine, « la machine hydraulique de Saint-Josse-ten-Noode », vers un réservoir situé sur les hauteurs de la ville. De là, des canalisations repartaient vers les jardins du palais du Coudenberg et le quartier huppé avoisinant. Un peu plus tard, au milieu du même siècle, ce sont les eaux de Saint-Gilles, captées du côté de l’actuelle place Morichar, qui furent acheminées par des conduites souterraines vers des points d’eau bruxellois.
Ces captages dans la banlieue proche de la ville n’avaient cependant pas pour raison première la volonté d’alimenter le commun des mortels mais plutôt les jardins des princes ou des institutions (les couvents, les hôtels aristocratiques) même si, secondairement, ils ont pu alimenter quelques fontaines dans l’espace public. Mais pour la majorité des Bruxellois, l’eau quotidienne provenait des puits parfois situés dans l’espace public, ou plus souvent accessibles à l’arrière des maisons ou dans les intérieurs d’îlots. En 1850, à côté de 76 puits publics et d’une trentaine de fontaines, on recensait ainsi encore plus de 8000 puits privés ! Autrement dit, si l’on voulait de l’eau, il fallait aller la puiser ou la chercher. Cette tâche était le plus souvent l’affaire des femmes et des enfants.

Ce paysage et ces pratiques de l’eau quotidienne ont radicalement changé au cours du 19e siècle. En 1852 en effet, tant pour des raisons hygiéniques que de confort et de prestige, les autorités de la Ville de Bruxelles se résolurent à réaliser des travaux qui permettraient d’alimenter les habitants à l’intérieur de leurs maisons. Pour être sûres de bénéficier de volumes suffisants et d’eaux propres, elles entreprirent d’aller les capter à Braine l’Alleud, aux sources du Hain (affluent de la Senne), soit à une trentaine de kilomètres de la ville. L’approvisionnement en eau entra alors dans une nouvelle phase historique, celle d’un « service », qu’il faudrait désormais payer.
Vite dépassées par leur projet, les autorités de la Ville de Bruxelles ne purent cependant satisfaire toutes les demandes de raccordement des habitants. Dans un climat de tension politique, ce furent alors les communes des faubourgs (principalement Saint-Josse, Schaerbeek, Ixelles, Saint-Gilles) qui prirent les devants. Se regroupant en 1891 sous forme d’intercommunale —la première dans l’histoire de Belgique—, elles réalisèrent un projet plus ambitieux encore en allant chercher des eaux aux sources du Bocq, un affluent de la Meuse dans la région de Spontin, à près de 80 km de la capitale. C’est l’anniversaire des 130 ans de cette intercommunale que Vivaqua a fêté cette année.
Cette réalisation qui nécessita d’importants moyens financiers, de très nombreuses expropriations, une main d’œuvre abondante et plusieurs années de travaux, ne manqua pas de faire la fierté des faubourgs face à la Ville de Bruxelles, une fierté subtilement revendiquée dans l’espace public.
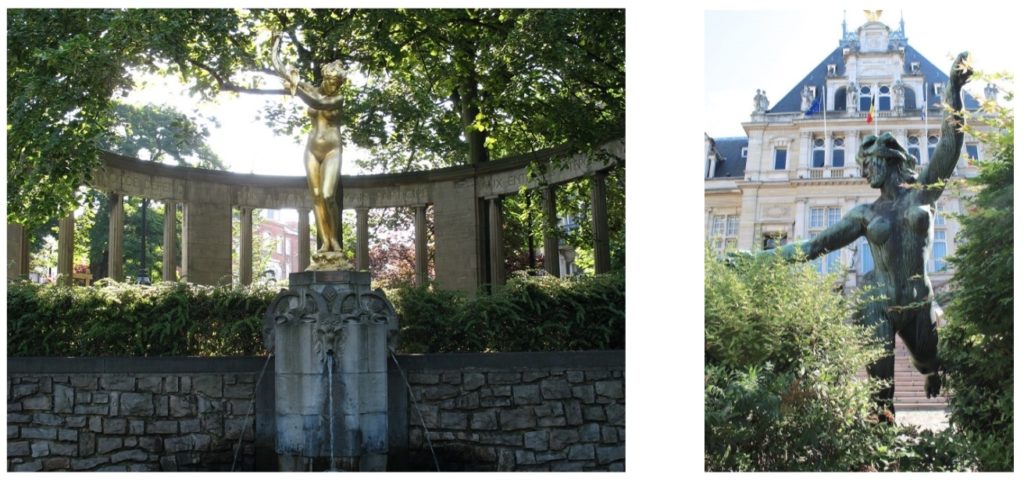
Ces deux premières « lignes d’eau » tirées depuis le Brabant wallon (1855) et la région de Dinant (1899) constituent aujourd’hui encore des axes importants de l’approvisionnement bruxellois. D’autres s’y ajoutèrent progressivement jusqu’aux années 1970, moment de la réalisation d’un premier captage d’eau de surface. En effet, entre 1969-1976, pour faire face à la demande croissante en eau quotidienne, une usine de potabilisation des eaux de la Meuse fut établie à Lustin (usine de Tailfer). Depuis lors, celle-ci assure selon les jours et les années entre 40 et 60% de l’approvisionnement bruxellois.
Depuis la réalisation de l’usine de Tailfer, le réseau de la CIBE (devenue Vivaqua en 2006) n’a pas fondamentalement changé. La stabilisation puis la diminution de la consommation d’eau depuis les années 1980 ainsi que la volonté d’indépendance des communes flamandes vis-à-vis de Vivaqua expliquent en grande partie la non-extension de ce réseau.
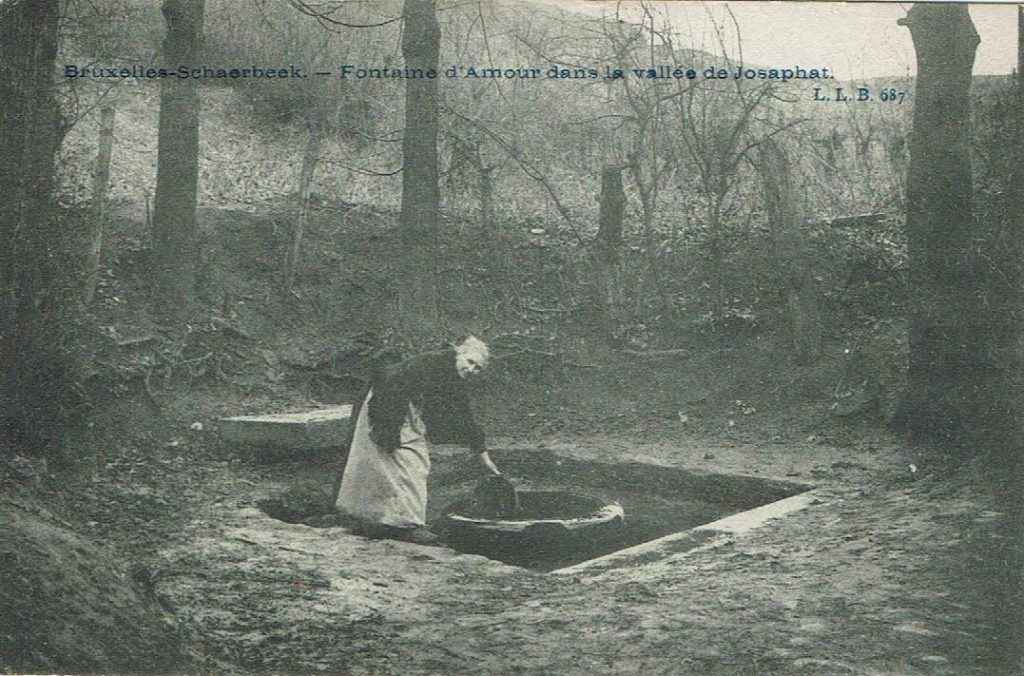
Cette histoire de 130 ans (et plus) a doté Bruxelles d’un réseau d’approvisionnement aussi solide que vital. Mais, dans le même temps, elle a effacé les nombreux liens qui reliaient les Bruxellois à leurs ressources d’eaux locales, principalement la pluie, les sources et les eaux souterraines. Les changements à l’œuvre aujourd’hui (dérèglement climatique, dualisation sociale et appauvrissement d’une grande partie de la population pour qui l’accès et le paiement de l’eau sont de plus en plus difficiles) amèneront-ils à reconsidérer ces relations ?
Cet article vous est proposé par Chloé Deligne, historienne, formée en géographie et en sciences de l’environnement. Elle est également enseignante à l’ULB et chercheuse au FNRS. Elle est une des trois commissaires de l’exposition Oh ! Ca ne coule pas de source.
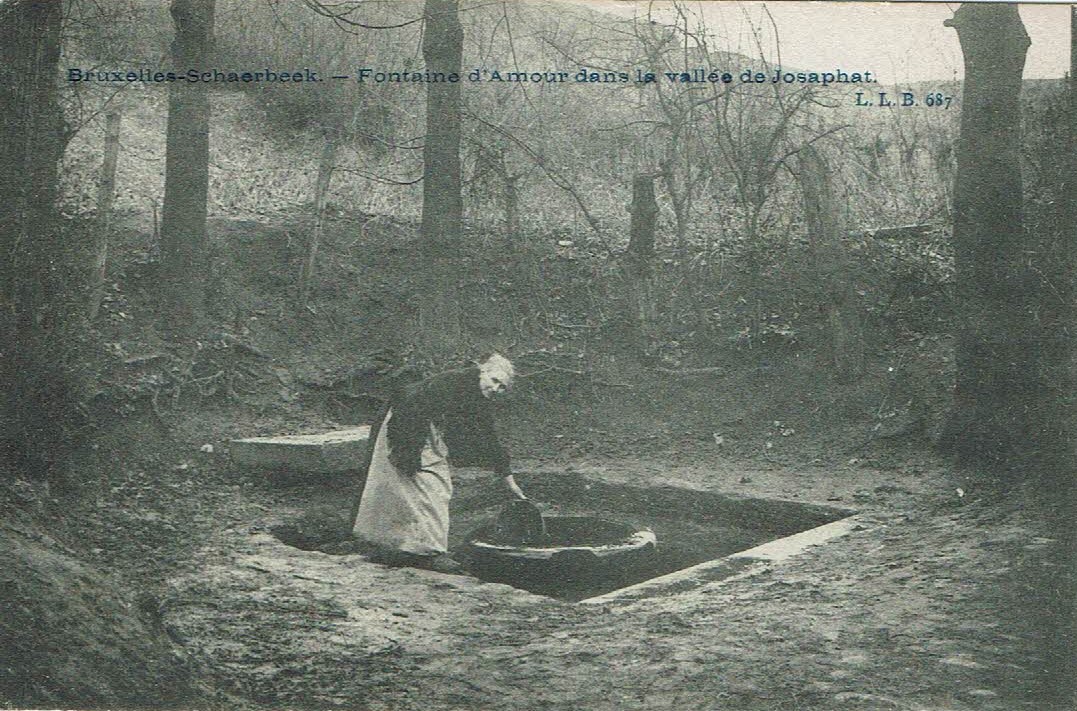
C’est à partir de 1901 que les communes belges reçoivent des subsides de l’État pour construire ce genre d’établissement. C’est donc à partir de ce moment-là qu’il est véritablement question d’un service public. Cela dit, certains établissements sont construits dès le milieu du 19e siècle pour répondre au besoin de se laver de la classe ouvrière. Ils sont souvent le fruit d’un partenariat entre actionnariat privé et communes.

La piscine, la baignoire et la douche sont les trois dispositifs privilégiés pour répondre à ce besoin d’hygiène populaire. La douche n’est inventée qu’en 1872 et prendra une bonne décennie supplémentaire pour sortir du contexte carcéral dans lequel elle est créée. Elle devient ensuite, grâce à son fonctionnement – économe en temps, en eau et en espace – le dispositif d’hygiène populaire par excellence. Il apparait dès lors intéressant de se poser la question : quelle hygiène est accordée à quels corps en fonction des dispositifs accessibles ?
Dans les premiers établissements de bains publics, lorsque la douche n’existe pas encore, il existe souvent entre 2 et 3 classes de baignoires. Elles donnent, en fonction d’un prix d’entrée plus ou moins élevé, accès à des services différents et dont l’écart, en termes de confort, est énorme. Aux premières classes : chauffage, mobilier plus luxueux et gestion individuelle de l’eau. Aux deuxièmes classes : baignoire préparée à l’avance, impossibilité de régler la quantité et la température de l’eau, absence de chauffage et mobilier sommaire. Avec l’arrivée du bain-douche, la différence de tarif se reporte sur la différence entre les deux dispositifs. Sous les douches, le temps devient plus court, la position des corps est verticale et les possibilités de relaxation et de détente se rétrécissent.
Ces différences entre classes de baignoires, mais surtout entre baignoires et douches révèlent alors ce qui est accordé aux individus et à leur corps selon leur classe sociale et leur moyen financier. Aux plus riches, le confort d’une salle de bain dans leur logement, espace de luxe, de volupté et de liberté. Aux moins riches, la jouissance d’une baignoire publique. Aux plus pauvres, une douche au temps, à la température et à l’espace plus réglementés. Ce faisant, ce qui est refusé à ces derniers, c’est la possibilité d’associer à l’hygiène une forme de bien-être et de relaxation.
Loin d’être anecdotique, la différence entre baignoire et douche dans l’organisation des bains publics rappelle donc les inégalités qui traversent l’architecture et l’expérience du confort de la « masse des sans salle de bain », largement majoritaire en Belgique jusque dans les années 1970.
Article de Sophie Richelle, historienne et chercheuse post-doctorante à l’ULB ; et commissaire de l’exposition Oh ! Ca ne coule pas de source. Cliquez sur ce lien pour revoir sa passionnante conférence sur les bains publics.

Lieux méconnus, effacés des mémoires par la généralisation des salles de bains individuelles à partir des années 1950, les bains publics nous racontent pourtant la ville et la vie des classes populaires. Présents dans la plupart des villes belges jusqu’à aujourd’hui, ils sont les témoins d’un histoire des gestes de l’intime qui n’échappe pas aux inégalités ordinaires de classes et de genre.
Sophie Richelle
Sophie Richelle est historienne, chercheuse post-doctorante à l’ULB. En plaçant au centre de son attention l’expérience sensible, matérielle et humaine d’espaces resserrés et particuliers, elle tente de raconter l’histoire de celles et de ceux qui ont laissé peu de traces. De l’asile de folles aux hospices de vieux, elle poursuit aujourd’hui ses questionnements avec les bains publics.
Cette conférence a eu lieu le 26 février 2022. Elle était proposée dans le cadre de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source.

Dans la seconde moitié du 19e siècle, l’eau courante est installée dans les habitations. Elle entraine toute une série d’évolutions dans l’architecture de la maison, mais aussi au niveau des comportements et de l’organisation de la vie quotidienne.
Vincent Heymans
Vincent Heymans est docteur en Philosophie et Lettres. Il dirige la Cellule Patrimoine historique de la Ville de Bruxelles, chargée de la gestion et de la valorisation du patrimoine architectural. Il est administrateur du site archéologique du Coudenberg.
Il enseigne l’histoire de l’architecture à l’Université Libre de Bruxelles, à l’ESA Arts2 et à l’ENSAV La Cambre. Il a de nombreuses publications à son actif, principalement dans le domaine de l’histoire de l’architecture et de la conservation du patrimoine.
Cette conférence a eu lieu le 26 janvier 2022, dans le cadre de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source.
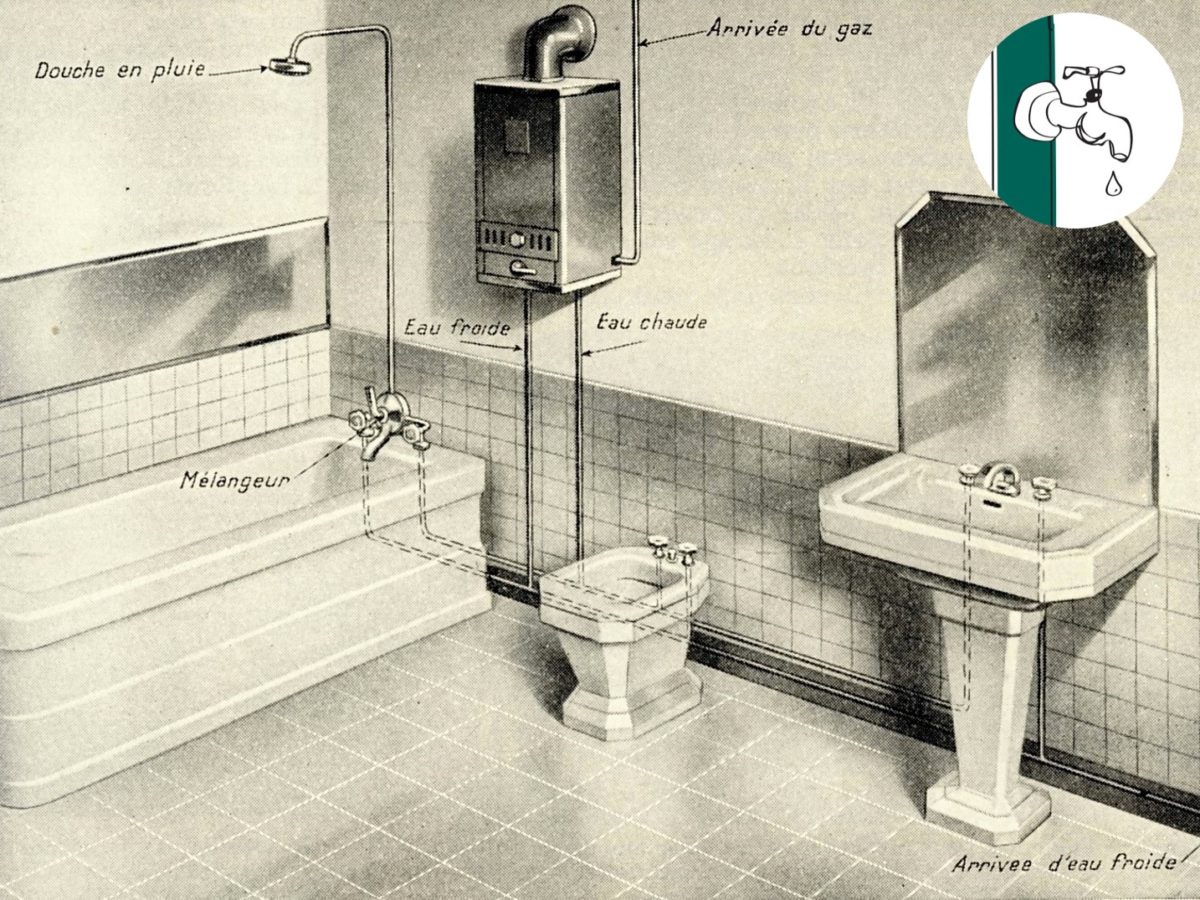
Le tout-à-l’égout fait partie de l’arsenal des mesures déployées au milieu du 19e siècle par les tenants du mouvement hygiéniste pour assainir la ville. Pourtant, loin de faire consensus, les perspectives ouvertes par ce nouveau dispositif se heurtent d’emblée à d’importantes critiques. D’une part, celles-ci portent sur le gaspillage de nutriments qu’implique l’évacuation des latrines à l’égout à une époque où les sources en matières fertilisantes sont limitées. D’autre part, elles dénoncent l’effet délétère de ce dispositif sur les cours d’eau dans lesquels les égouts se déversent faute de systèmes performants d’épuration des eaux usées.
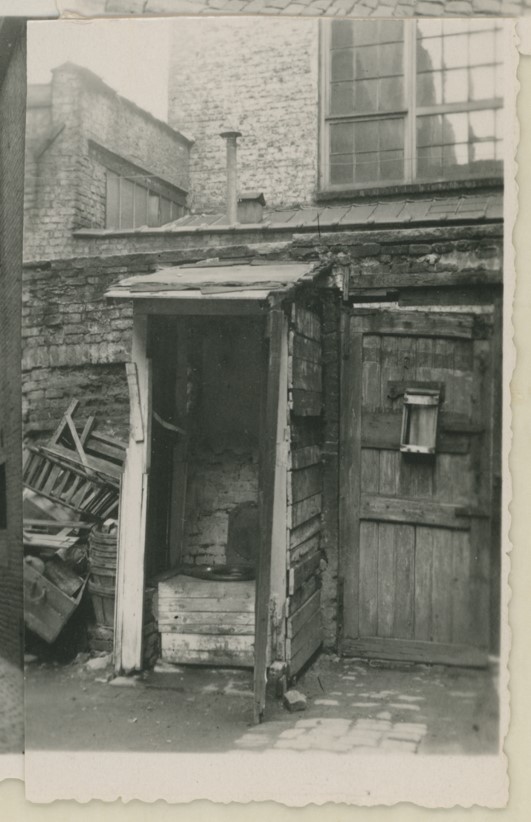
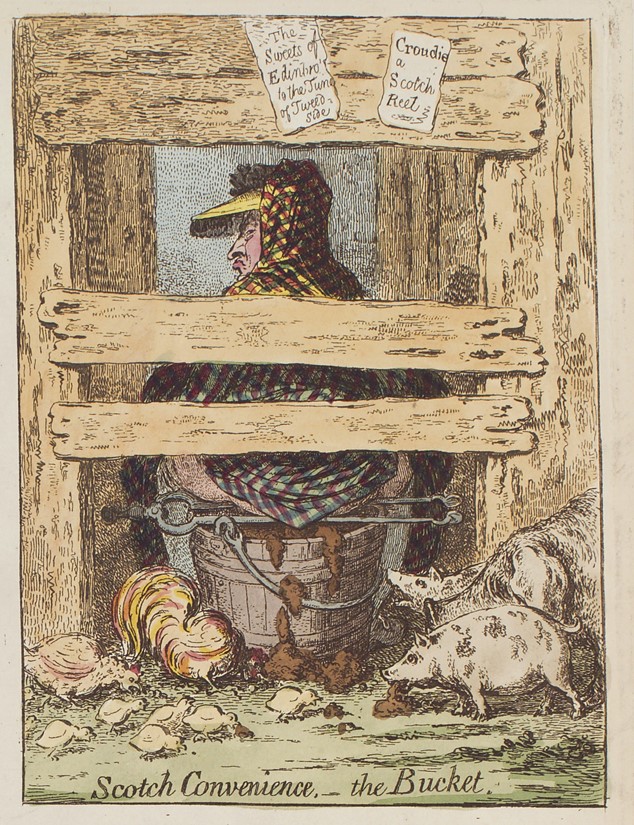
Le premier congrès d’hygiène, qui se tient à Bruxelles en 1852, va jouer un rôle déterminant dans l’atténuation de ces voix contestataires en présentant le tout-à-l’égout sous une forme nouvelle.
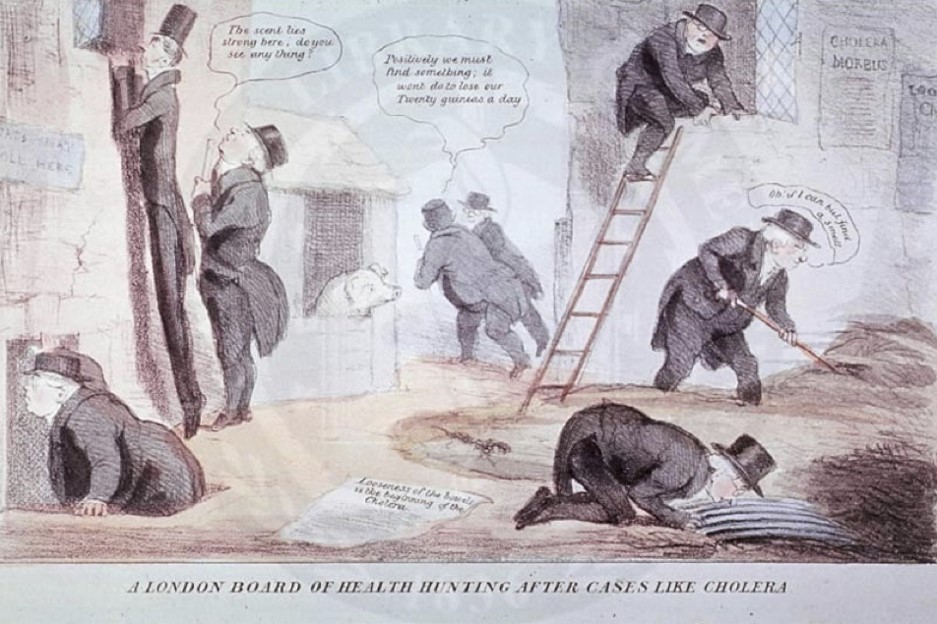
L’égout au coeur des cycles naturels
Lors de cette rencontre, Frederick Oldfield Ward, ambassadeur du célèbre réformateur anglais Edwin Chadwick, présente une allocution intitulée Circulation ou stagnation : les systèmes artériel et veineux pour l’assainissement des villes. Conformément aux grandes théories hygiénistes, il dénonce l’insalubrité liée à l’accumulation, au sein de l’espace urbain, des matières organiques en décomposition tels que les excréments. Pour y remédier, il propose de substituer aux fosses d’aisances un système d’écoulement et d’évacuation continue des matières excrémentielles.
Grâce à un vaste réseau tubulaire élaboré sur le modèle de la circulation sanguine, sa proposition vise à fluidifier les échanges entre ville et campagne : « après avoir servi aux besoins de la population, [l’eau] s’en va, enrichie de résidus fertilisants, qu’elle entraine avant qu’ils n’aient eu le temps d’entrer en fermentation. Ces engrais, elle les charrie le long des tuyaux d’irrigation, pour les déposer dans le sol ; qu’elle traverse ensuite pour entrer dans les tuyaux de drainage ; d’où elle passe enfin aux rivières. Les rivières la conduisent à l’Océan, d’où elle s’élève en vapeur sous la chaleur du soleil, pour redescendre en pluie sur la colline, pour pénétrer encore une fois dans les tuyaux de collection, et pour recommencer ainsi son vaste et utile cercle.1»
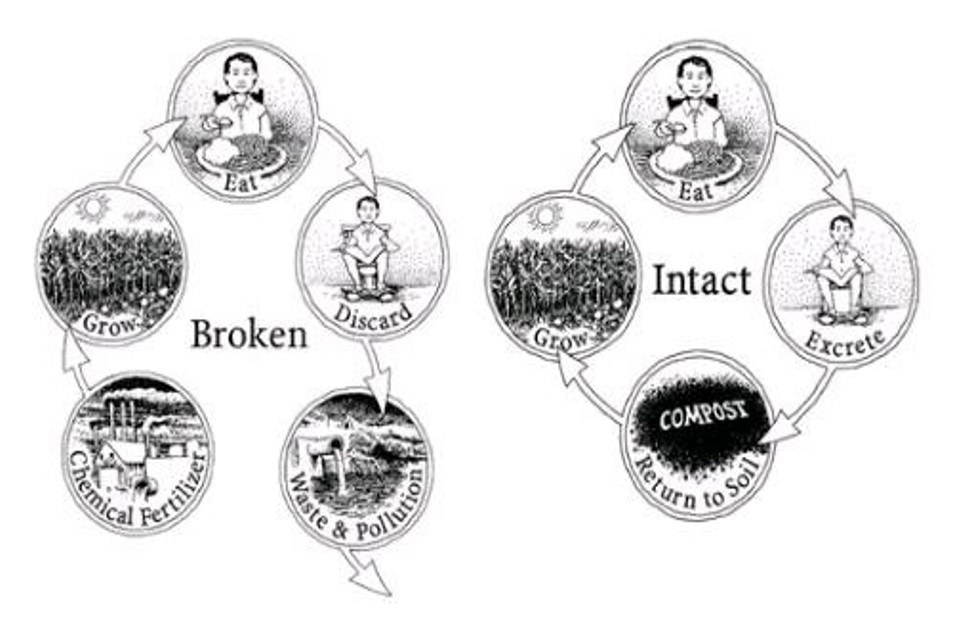
Loin de rompre les liens métaboliques entre la ville et les champs, le tout-à-l’égout assurerait leur perpétuation sous une forme plus aboutie. Dans ce modèle, l’infrastructure technique n’est pas l’antithèse de la nature, mais un moyen de de son accomplissement. Le tuyau prolonge le réseau hydrographique. Comparé aux artères assurant la circulation du sang dans le corps humain, il apparaît aussi essentiel et naturel que la pluie ou les cours d’eau. L’infrastructure d’assainissement devient, dans le modèle défendu par Ward, un maillon du cycle naturel de l’eau et des nutriments. Couplé à un système d’épandage des eaux usées, le tout-à-l’égout assurerait à la fois le retour à la terre des nutriments utiles à leur fertilisation et l’assainissement des eaux usées par filtration dans les sols avant leur rejet à la rivière. Avec ce modèle, Ward entend réconcilier préoccupations sanitaire et agricoles. Ce faisant, il rend caduques les différentes objections énoncées à l’encontre du “tout-à-l’égout”.
Ce modèle va marquer les esprits. Accueilli avec sympathie mais retenu par les rapporteurs du congrès (qui estiment qu’il est trop nouveau pour qu’ils puissent se prononcer à son sujet), il va s’imposer à Bruxelles quelques années plus tard.
Vive le tout-à-l’égout, mort à la rivière
A partir de 1857, le tout-à-l’égout est progressivement admis dans la Capitale belge. En 1866, le conseil communal adopte le projet de voûtement de la Senne proposé par l’architecte Léon Suys. Celui-ci prévoit que les pertuis de la Senne soient bordés, de part et d’autres, par deux collecteurs destinés à servir d’épine dorsale au réseau d’égout. Mais aussi, contraint par la Province de Brabant à épurer les eaux drainées par ces égouts avant qu’ils ne rejoignent la Senne à l’aval de Bruxelles, le Conseil communal va adopter un projet d’épandage d’eaux usées sur les plateaux de Haren. Des expériences d’épuration par infiltration dans les champs, menées dans des fermes anglaises avaient alors montré qu’un tel dispositif permet d’obtenir à la sortie une eau « qui n’a ni odeur ni saveur rappelant son origine 2».
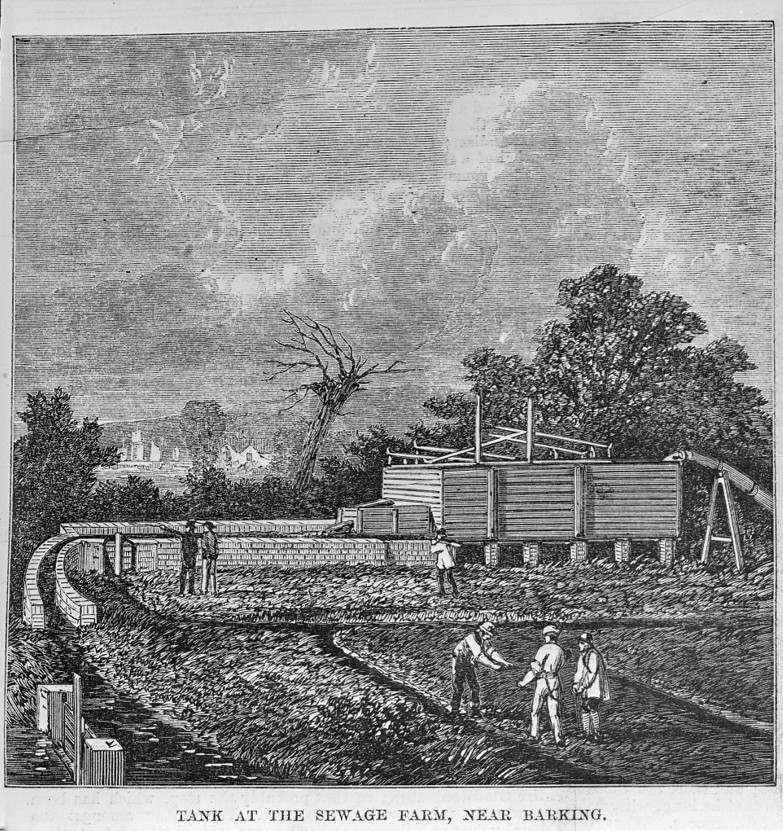
En 1871, les travaux d’assainissement prévus dans Bruxelles sont achevés et inaugurés en grande pompe. Cependant, à l’aval de l’agglomération, le projet destiné à épurer les eaux usées est reporté, puis réduit à une petite expérimentation avant d’être abandonné. De fait, les eaux usées drainées par les quelque 17 775 mètres de collecteurs d’égouts, construits entre Bruxelles et Haren, et dont le débit est alors évalué à plus de 85 000m3 d’eaux usées par jour, seront évacuées sans traitement dans la Senne.
Lorsque l’infrastructure disparaît dans la nature
En incorporant le réseau d’assainissement aux cycles naturels, le modèle présenté par Ward a joué un rôle non négligeable dans l’acceptation du tout-à-l’égout.
L’application de ce modèle à Bruxelles, amputé de sa dimension “assainissement des eaux usées”, n’a pas permis de maintenir un lien métabolique entre ville et campagne. Au contraire, il a entraîné la pollution durable de la Senne par les matières excrémentielles. Suite à l’abandon du projet d’épandage bruxellois aux cours des années 1870, il faudra en effet attendre les années 2000 pour que les eaux usées de Bruxelles soient épurées par des stations d’épuration avant d’être rejetées à la Senne. Si ces infrastructures répondent (en grande partie ) aux préoccupations écologiques liées à la pollution des cours d’eau par les eaux usées, elles ne solutionnent pas la question du retour à la terre des nutriments (azote, phosphore).
Loin d’être propre à Ward ou au 19e siècle, l’incorporation des infrastructures techniques au sein des cycles biogéochimiques se retrouve aussi dans les projets d’écologie industrielle qui ont pris leur essor au cours des années 1970.
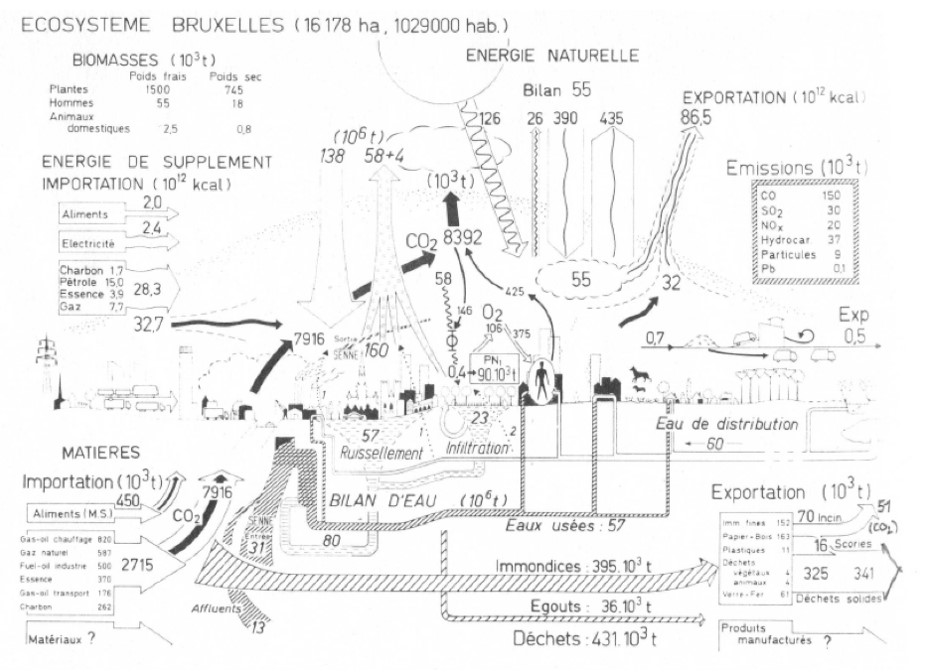
Aujourd’hui, alors qu’avec l’engouement pour l’économie circulaire ce type de représentation bénéficie d’un regain d’intérêt, il ne doit pas faire oublier que les larges systèmes d’infrastructures techniques, loin de se fondre dans la nature, ont un impact déterminant sur le milieu dans lequel ils sont implantés et que celui-ci échappe souvent aux prévisions de leurs promoteurs. La tendance à les représenter sous forme organique ne doit pas non plus masquer qu’une fois construites, ces infrastructures rigides, lourdes et dispendieuses peuvent difficilement être démantelées ou adaptées à des systèmes alternatifs et décentralisés plus souhaitables.
Le cas du tout-à-l’égout bruxellois nous invite à nous interroger : tout compte fait, est-ce une bonne idée de rejeter nos déjections dans les infrastructures souterraines ? Les égouts peuvent-il encore être perçus comme un élément sophistiqué du cycle de l’eau ?
Pour en savoir plus, venez découvrir l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source, actuellement à la Fonderie.
1 Ward M. F. O., 1852. « Circulation ou stagnation ? », Congrès général d’hygiène, à Bruxelles, première séance, 20 septembre 1852, discours de M. F. O. Ward (Angleterre). Bruxelles : Librairie universelle de Rozez, p. 6.
2 Ville de Bruxelles, 1866. Deuxième rapport de la commission chargée de constater les résultats des opérations de sewage en Angleterre. In : B.C.B. Séance du 17 mars, tome 1, p. 253.

Le premier réseau de distribution à domicile est inauguré en 1855 à Bruxelles-Ville. L’extension rapide de ce réseau vers les communes limitrophes et la création d’un second réseau en 1891 par les communes des faubourgs ne signifie pas que l’entrée de l’eau dans les logements bruxellois s’est produite de façon “naturelle” et sans heurt. Au contraire, la mise en place de la distribution d’eau à domicile a ouvert de nouvelles lignes de tensions, voire de conflits, qu’elles soient scientifiques, politiques ou sociales. La conférence évoquera ces lignes de tensions à travers l’histoire de l’eau quotidienne aux 19e et 20e siècles et montrera que certaines sont toujours actives tandis que d’autres sont réactualisées par les changements profonds de ce début de 21e siècle (paupérisation de la population bruxelloise ou dérèglement climatique).
Chloé Deligne
Chloé Deligne est historienne, formée en géographie et en sciences de l’environnement. Elle est également enseignante à l’ULB et chercheuse au FNRS. Elle est passionnée par les histoires d’eau et, plus généralement, par les questions sociales et écologiques qui touchent les habitants des villes.
Conférence donnée le 15 décembre 2022 dans le cadre de l’exposition Oh ! Ca ne coule pas de source.

À première vue, il ne manque pas d’eau à Bruxelles.
Crachins, averses et grosses draches nous font régulièrement nous hâter dans les rues de Bruxelles. Sur le petit territoire de la région, il pleut d’ailleurs plus au sud-est, près de la forêt et davantage en « altitude » qu’au nord. L’eau est aussi visible dans le canal, les tronçons de cours d’eau à ciel ouvert ou les plans d’eau des espaces verts. Elle émerge également de sources souvent discrètes et méconnues.
Beaucoup d’eau se cache également à Bruxelles. Une grande partie des cours d’eau a été voûtée, totalement ou partiellement, et passe aujourd’hui dans les égouts. L’eau s’accumule aussi dans des nappes phréatiques plus ou moins profondément sous nos pieds. Enfin, n’oublions pas l’eau « atmosphérique » qui s’évapore sous le soleil ou par transpiration des végétaux.
Bruxelles n’est donc pas pauvre en eau. Et pourtant… seuls 3% de l’eau potable consommée dans la capitale y sont produits : cette eau est captée, depuis 1875, dans des nappes situées en Forêt de Soignes et au Bois de la Cambre.
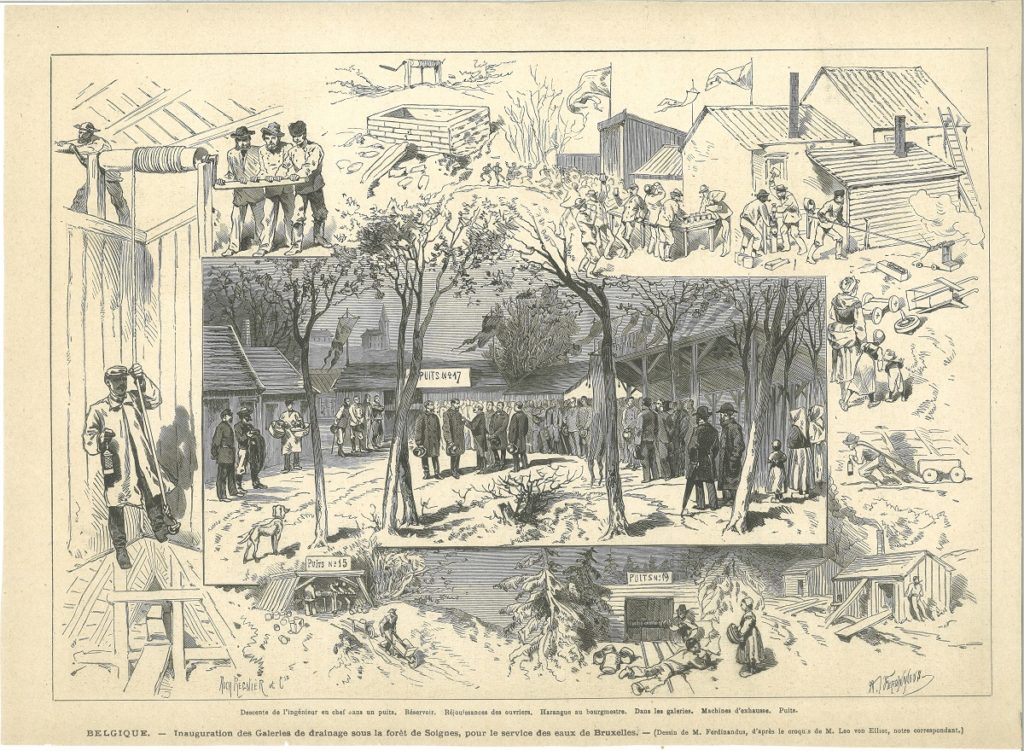
Mais alors, d’où viennent les autres 97 % d’eau potable consommée à Bruxelles ?
Jusqu’au 19e siècle, l’eau des Bruxellois était « locale » (puits, fontaines, sources, premiers réseaux d’approvisionnement réservés aux élites…) et la plupart des Bruxellois vivaient sans eau à domicile. Au milieu du 19e siècle, pour faire face à la croissance démographique et aux préoccupations hygiénistes grandissantes, la Ville décide de chercher de nouvelles ressources en eau. C’est le début de travaux colossaux pour la mise en œuvre d’infrastructures d’approvisionnement qui puissent assurer aux habitants la fourniture d’une eau en quantité et en qualité suffisantes.
C’est naturellement vers la Wallonie que les autorités se tournent. Enjeux politiques, prouesses techniques et découvertes scientifiques émaillent la mise en place progressive de ce réseau d’approvisionnement qui démarre, en 1855, avec le captage des sources du Hain à Braine-l’Alleud. Un aqueduc (toujours existant et en fonction jusque 1972) amène l’eau par gravité jusqu’à un réservoir à Ixelles, d’où repartent des canalisations qui quadrillent les rues.
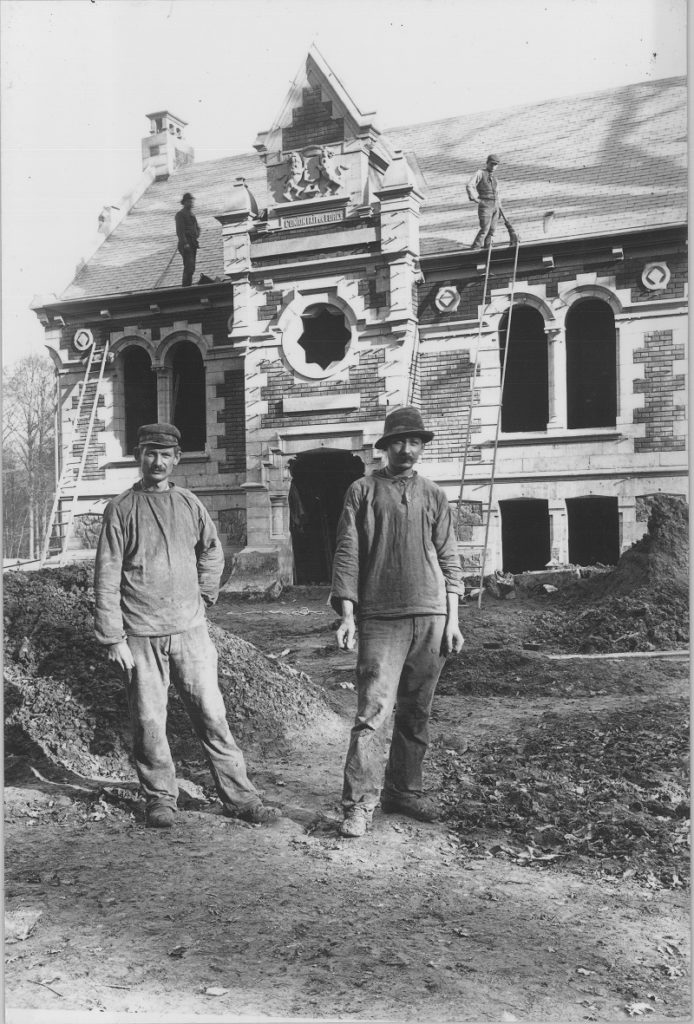
En 1891, la première compagnie intercommunale de Belgique, la CIE (aujourd’hui VIVAQUA), est créée. Elle ira chercher l’eau potable à 80 km de Bruxelles dans les vallées du Bocq près de Dinant et du Hoyoux près de Huy. Au 20e siècle, elle développe son réseau pour trouver toujours plus d’eau, dans des lieux de plus en plus nombreux, pour des usages et des habitants de plus en plus « aquavores » : eaux puisées dans les mines désaffectées de Vedrin (Namur), captages dans la région de Mons (Nimy, Havré), eaux des carrières désaffectées des régions de Fleurus et d’Écaussinnes…, mais également eaux de surface, essentiellement pompées dans la Meuse et potabilisées à l’usine de Tailfer entre Namur et Dinant.
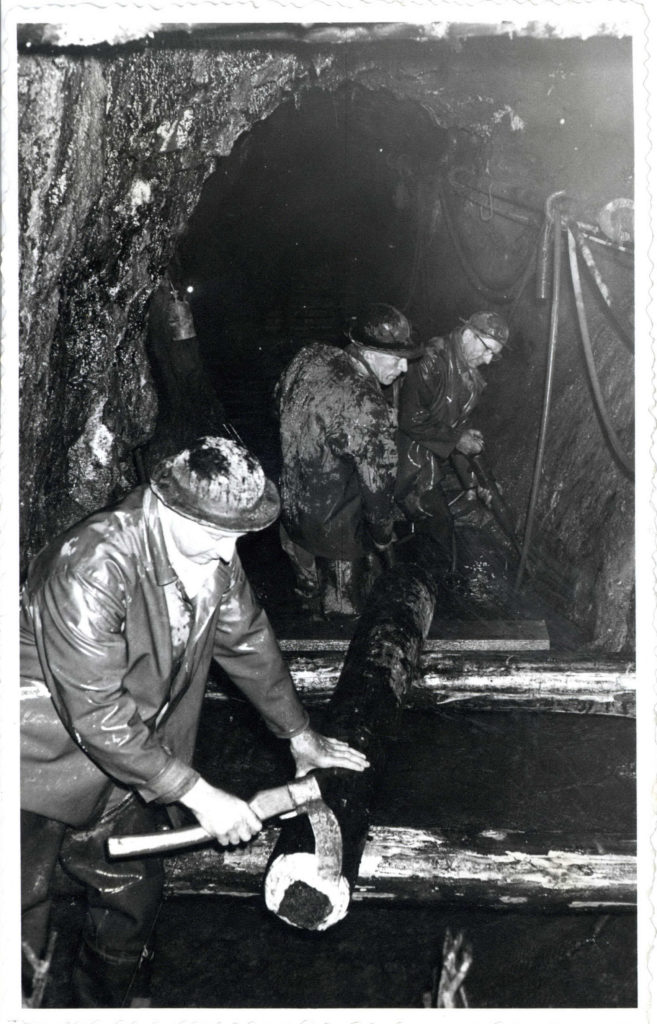
Ce sont donc des eaux lointaines et d’origines diverses qui abreuvent Bruxelles. Une fois captées, elles sont acheminées vers la ville via des canalisations (500 kilomètres d’installation pour l’adduction vers Bruxelles). Elles sont ensuite stockées et mélangées dans des réservoirs (Rhode-Saint-Genèse, Boitsfort, Uccle…) avant d’être envoyées dans les conduites du réseau de distribution (2000 kilomètres de canalisations sous les rues)… et d’entrer dans nos maisons.
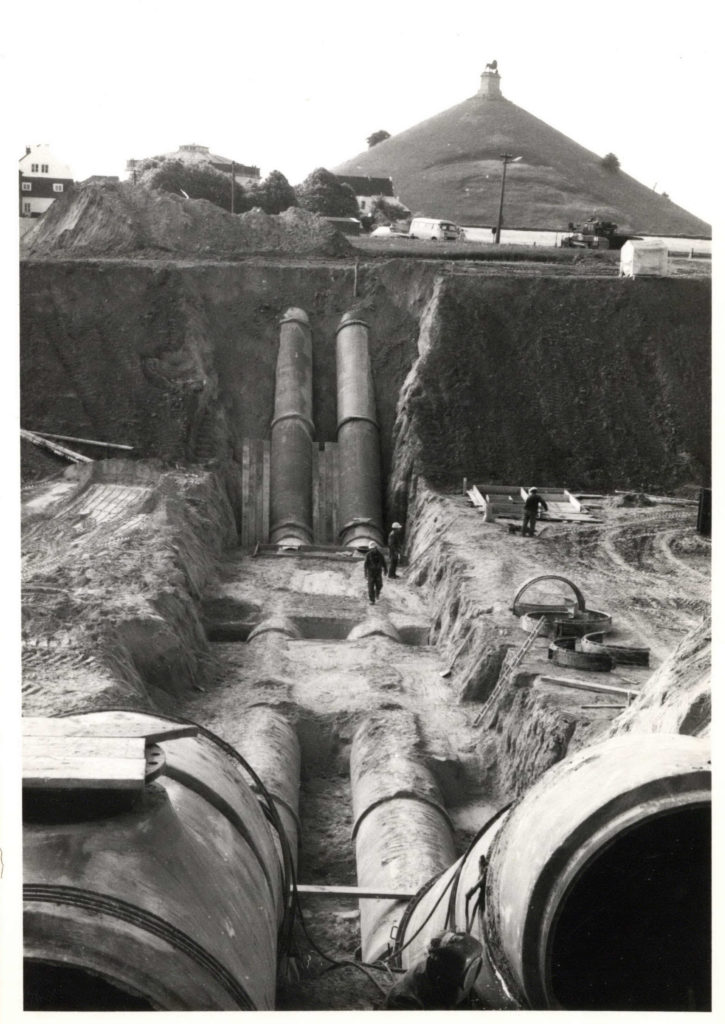
Pour en savoir plus, venez voir l’exposition Oh ! Ca ne coule pas de source à La Fonderie jusqu’en juin 2026…
Cette exposition est le fruit d’un partenariat entre La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail –, le Laboratoire interdisciplinaire en Études urbaines de l’Université Libre de Bruxelles et VIVAQUA qui y participe dans le cadre de ses 130 ans.
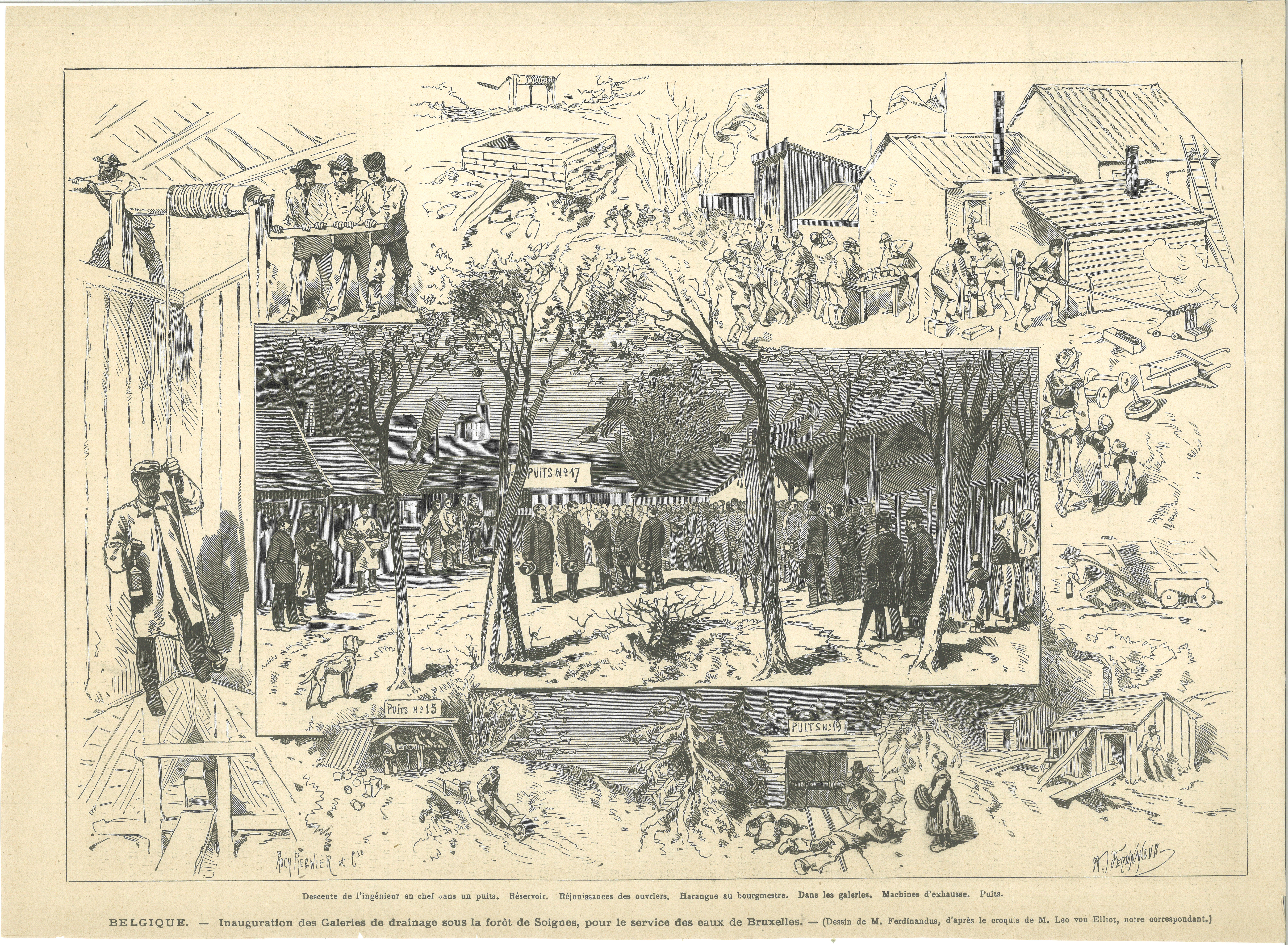
Nous n’étions pas très nombreux mais le moment fut chaleureux. L’équipe au grand complet, des bénévoles et des bénéficiaires de la Samaritaine étaient là et ont découvert – visiblement avec plaisir – ce que notre groupe avait trouvé et produit durant cette aventure dont l’objectif était, rappelons-le, de réaliser une boite de documentation multimedia sur le passé et le présent de l’association et du quartier dans lequel elle œuvre.
Pour les travailleurs de La Fonderie qui ont mené le projet, ce fut une merveilleuse aventure et nous garderons d’excellents souvenirs des moments passés avec et à la Samaritaine. Nous sommes prêts à entamer le travail dans un autre quartier, sur d’autres sujets, avec un nouveau groupe. Avis aux amateurs !
La boite s’expose au Musée bruxellois des industries et du travail jusqu’au dimanche 19 décembre 2021. L’exposition est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 17h, les weekends et jours fériés de 14 à 17h. Entrée gratuite.

Sauvetage de Tour et Taxis, de la brasserie Wielemans Ceuppens ou encore du Familistère Godin. Création d’asbl à vocation sociale et solidaire ou encore d’institutions culturelles de premier plan… Bruxelles doit beaucoup à Guido Vanderhulst (1940 – 2019). Ce lundi 15 novembre, cela fait tout juste deux ans qu’il nous a quittés. A cette occasion un collectif d’associations et de personnalités lance une pétition afin de faire reconnaitre l’étendue de son travail et son impact dans le domaine du patrimoine industriel et social bruxellois. L’objectif : faire inscrire le nom de Guido Vanderhulst dans l’espace public. Le lieu pressenti : la passerelle au-dessus du canal reliant Anderlecht à Molenbeek au niveau de la rue de Gosselies.
Guido Vanderhulst
Sociologue de formation, Guido a consacré sa vie à la défense du Vieux Molenbeek et de ses habitants. En 1978, il a créé l’asbl La Rue, association d’éducation populaire qui entre autres actions a œuvré pour la création d’espaces verts dans les quartiers densément bâtis : le parc de La Fonderie, l’espace Pierron, l’îlot Het Pleintje. Avec La Rue il a aussi persuadé les autorités d’acquérir l’ancien dépôt des bières “Belle-Vue”, qui deviendra l’Auberge de Jeunesse Génération Europe.
Guido Vanderhulst a été l’initiateur de l’asbl La Fonderie, Musée bruxellois de l’industrie et du travail, établi sur le site de l’ancienne Compagnie des Bronzes. Il a été à la base du sauvetage du site emblématique de Tour & Taxis, du Familistère de Godin à Laeken, des bâtiments de la brasserie Wielemans-Ceuppens à Forest.
Il a également collaboré à nombre d’ouvrages scientifiques sur l’histoire sociale et industrielle de Bruxelles.
Il est devenu membre de la Commission Royale des Monuments et des Sites en 1989 et en aura été le président de 2008 à 2011. Il est également membre fondateur du Conseil bruxellois des Musées, aujourd’hui Brussels Museums, et en a assuré la présidence pendant près de 18 ans. Enfin, il a aussi été vice-président de Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles, et le président-fondateur de l’asbl BruxellesFabriques / Brusselfabriek vzw.
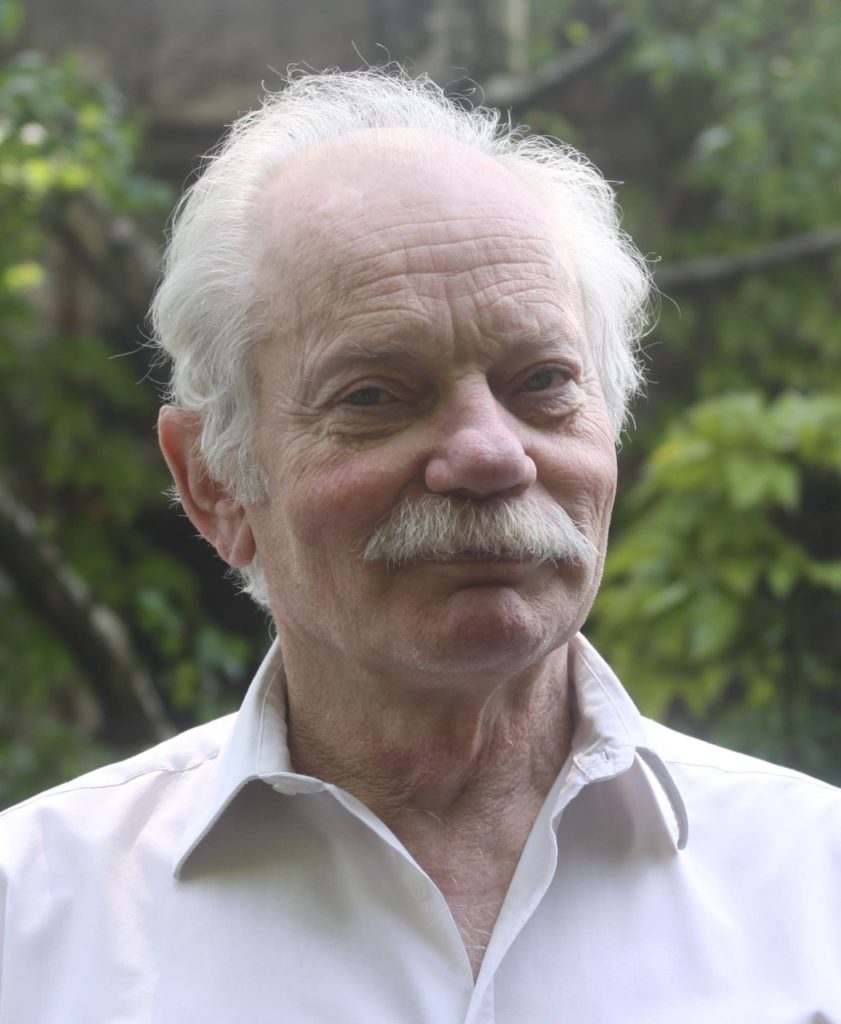
La passerelle à baptiser
En raison de l’importance du personnage pour la défense des habitants des quartiers populaires ainsi que du patrimoine social et industriel à Bruxelles et ailleurs, les associations et personnalités signataires de ce projet proposent de baptiser “Passerelle Guido Vanderhulst” le nouveau pont mobile piétons/cyclistes enjambant le canal à hauteur de la rue de Gosselies, à Molenbeek. Il est situé devant la Grande Halle dont la rénovation est en cours quai de l’Industrie : c’est l’endroit idéal à consacrer à cet infatigable militant du patrimoine social et industriel de Molenbeek et de Bruxelles en général. Le canal et ses rives ont toujours été son centre d’intérêt principal. Il fut un précurseur dans la défense de cette zone. La première exposition organisée par La Fonderie, en 1986 avait d’ailleurs comme titre “Un canal, des usines et des hommes”. Le pont, avec toute sa symbolique, est bien représentatif de ce qu’était Guido : un rassembleur.
Signez la pétition en cliquant ici !
Les porteurs du projet
Ce projet est porté par les soussigné.e.s, qui se sont illustré.e.s dans la défense du patrimoine industriel. Ensemble, nous lançons une pétition auprès du public plus large, solidaire des initiatives et réalisations de Guido Vanderhulst. Cette pétition sera remise à Mme Elke Van den Brandt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité.
asbl La Fonderie; Musée bruxellois de l’industrie et du travail; asbl La Rue; asbl Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles (PIWB); asbl Brussels Museums; asbl Inter-Environnement Bruxelles (IEB); asbl BruxellesFabriques / vzw Brusselfabriek; vzw Foyer; vzw Bonnevie; Jean-Louis Delaet, président de The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage (TICCIH-Belgium); Adriaan Linters, vzw Vlaamse vereeniging voor industriële archeologie (VVIA); Patrick Viaene, Expertisecel voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed (ETWIE); Anne Van Loo, ancienne secrétaire permanente de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale; Jacques Debatty, ancien Secrétaire fédéral adjoint de la Fédération bruxelloise des Syndicats chrétiens (CSC-ACV); Myriam Gerard, ancienne Secrétaire régionale CSC Bruxelles; François Schreuer, UrbAgora et revue Dérivations; Marc FRÈRE, président asbl ARAU; René Schoonbrodt, fondateur de l’asbl ARAU et de l’asbl IEB; Gabrielle Clotuche; Ria Kaatee; Marie-Claire Migerode; Johan Proot; Nora De Kempeneer, ex responsable du Gemeenschapscentrum De Markten; Lieve Grauls; Olivier Bastin, past BouwMeester/Maître Architecte de la Région de Bruxelles-Capitale; Anne-Sophie Van Neste; Jean-Marie Desmet, président de la maison de quartier Bonnevie; Marcel Rijdams.

Aftermovie du concert de The Miracle à La Fonderie, le 1er mai 2021.
Nous sommes des cinémas, théâtres, centres culturels, lieux pluridisciplinaires, festivals, salles de concert, centres d’expression et de créativité, maisons de jeunes, cafés associatifs… Nous représentons une partie de la diversité des pratiques culturelles en Wallonie et à Bruxelles.
De manière concertée, dans le cadre de la cinquième action de Still Standing for Culture, nous avons décidé de vous accueillir à nouveau après 6 mois de fermeture. D’autres rejoindront probablement ce mouvement. D’autres encore ont déjà annoncé des actions similaires de leur côté.
Entre le 30 avril et le 8 mai, il y aura chaque jour en Belgique des activités culturelles : projections, spectacles, concerts, débats, performances, répétitions publiques… Le samedi 1er mai sera particulièrement foisonnant, parce que la Journée Internationale des Travailleur.se.s symbolise notre volonté de renouer avec nos métiers et avec leur dimension publique.
Pendant ces 9 jours, certains opérateurs vous accueilleront dans leurs salles, d’autres en extérieur. Tous le feront dans le respect des protocoles sanitaires décidés par les pouvoirs publics et appliqués entre juillet et octobre 2020 (port du masque, gel hydroalcoolique, distances et sièges vides entre chaque bulle…).
Nous avons choisi de rendre notre action publique à la veille d’une réunion du Comité de concertation qui doit enfin, après des mois de silence et de désintérêt, se pencher sur la reprise des activités culturelles, associatives, sportives…
Si, à l’issue de cette réunion, les activités culturelles sont autorisées à reprendre immédiatement, comme nous le souhaitons, nous pourrons donc vous accueillir dans un cadre légal.
Si, au contraire, la reprise culturelle reste conditionnée à un calendrier arbitraire, à de énièmes expériences tests ou à des paramètres épidémiologiques auxquels d’autres secteurs ne sont pas soumis, nous maintiendrons notre programmation.
• Nous le ferons parce que nous voulons sortir de cette logique destructrice qui sacrifie les activités porteuses de sens, de débat et de lien social, et les relègue au rang de variables d’ajustement. Parce que les cartes blanches, les interpellations politiques et les précédentes actions n’ont pas fait bouger les lignes. Parce que nous répétons depuis des mois, sans être entendus, qu’il faut arrêter d’opposer les secteurs et que toutes les activités humaines doivent pouvoir reprendre de manière proportionnelle face à la situation sanitaire.
• Nous le ferons parce que la précarité et le désespoir gagnent, et que la solidarité se désagrège. Parce que nous assumons des missions de service public. Parce que rouvrir est une première étape pour sortir d’une situation qui va nous impacter pour longtemps encore. Parce que l’indifférence et le mépris ne sont pas une réponse aux enjeux de notre époque. Parce que faire société, ce n’est pas uniquement rester chez soi, travailler et consommer.
• Nous le ferons sans sous-estimer la dangerosité du virus, mais nous rappelons que les expériences et les études montrent que l’ouverture des lieux de culture n’a qu’un impact minimal sur les courbes de contamination face aux effets attribués aux activités des entreprises, des commerces et des services. Nous le ferons pour refuser que certains secteurs d’activités et certaines catégories de la population soient les seuls à porter le poids des mesures sur leurs épaules. Et pour défendre la diversité des lieux et des pratiques.
Il est possible que le Comité de concertation du 23 avril décide de prolonger la fermeture des lieux culturels. Nous espérons toutefois que bourgmestres et procureurs n’interdiront pas cette action politique commune, juste, responsable et nécessaire face à une situation arbitraire qui ne peut plus durer. Quoi qu’il en soit, nous avons des arguments juridiques de poids et nous contesterons les éventuelles amendes, solidairement, qu’elles soient adressées aux organisateurs·rices, aux spectateurs·rices ou aux artistes.
Nous espérons surtout vous retrouver nombreuses et nombreux pour recommencer à faire culture et à faire société ensemble.
Pour en savoir plus sur le mouvement et sa programmation culturelle du 30 avril au 1er mai, rendez vous sur le site internet de Still Standing for Culture en cliquant ici. Dans ce cadre, La Fonderie accueillera The Miracle en concert le 1er mai.
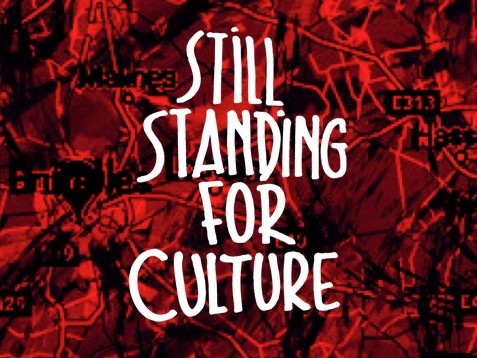
Dans les maisons, le printemps rime avec grand nettoyage et purification des intérieurs domestiques. Cette tradition printanière a longtemps également concerné le linge du foyer. En effet, jusqu’au 19e siècle, et parfois encore au 20e siècle, une « grande lessive » ou « grande buée » se fait systématiquement au printemps. Une autre est organisée en automne, à l’approche de la Toussaint.
Seulement deux grandes lessives par an…, c’est que les dépenses en énergie et en temps sont considérables. Faite entièrement à la main par les femmes, la « buée » exige de nombreuses opérations éreintantes qui s’enchaînent sur plusieurs jours, sans compter le racommodage et le repassage. Avant l’eau courante, il faut aussi compter le temps et les efforts nécessaires pour aller à la rivière, au puits ou à la fontaine. Sans distribution généralisée du gaz et de l’électricité, il faut aussi mobiliser beaucoup de force physique pour brasser, frotter, rincer, tordre… le linge.

Le premier jour de la buée, le linge sale accumulé est descendu du grenier, trié et mis à tremper dans un baquet d’eau froide. Le lendemain, il est placé dans un cuvier. L’eau est chauffée dans un chaudron en vue du « coulage » du linge. Sur le cuvier est étendue une toile où est déposée de la cendre de bois tamisée. Durant toute la journée, de l’eau de plus en plus chaude est versée sur l’ensemble. La cendre contient de la potasse qui dissout les matières grasses pouvant ainsi être entraînées par l’eau. Celle-ci emporte la saleté et s’écoule par un orifice situé dans la partie inférieure du cuvier. On récupère l’eau dans une bassine au sol et on la reverse dans le chaudron, avant de la transvaser à nouveau dans le cuvier. L’opération est longue et complexe, dans l’humidité et avec des risques de brûlures.
Le linge est ensuite frotté et étalé sur l’herbe pour le blanchir. Le jour suivant, il est amené au lavoir ou à la rivière à l’aide de paniers ou de brouettes. Il est frotté à la main ou à la brosse sur une planche, avec du savon. Il est battu pour en expulser la saleté. Il est ensuite rincé plusieurs fois puis tordu à la main. Alourdi d’eau, il est ramené à la maison pour être mis à sécher.

Le coulage n’est pas pratiqué partout. Un autre procédé consiste à laisser tremper le linge toute une nuit dans une eau savonneuse. On chauffe l’eau le lendemain et on agite la lessive à l’aide d’un bâton.
La buée, est réservée au « linge blanc » qui seul résiste au lavage à haute température et prédomine donc dans le trousseau familial. Fabriqué en lin, en chanvre et, à partir du 18e siècle, en coton, il comprend le linge de maison (draps, essuies, nappes…), ainsi que les chemises de nuit et les sous-vêtements. Étalé sur l’herbe pour être blanchi, il donne l’occasion aux foyers aisés d’exposer la richesse du trousseau familial et donc leur rang social.

Il ne faut cependant pas croire qu’on ne lavait le linge que deux fois par an. Une « petite lessive » demandant moins de manipulations est faite à la main pour les pièces délicates ou de couleur, au fur et à mesure des besoins. Cette nécessité varie suivant les classes sociales. Les plus démunis lavent leurs vêtements chaque semaine, ce qui n’est pas nécessaire dans les foyers aisés où ils sont stockés en abondance.
Pour le lavage du linge, les femmes ne disposeront pendant des siècles que d’une planche en bois nervurée, d’un battoir à linge, d’une brosse et d’une bassine. Elles s’aident parfois d’agitateurs munis de longs manches qui permettent de brasser plusieurs pièces à la fois, sans courber le dos et sans plonger les mains dans l’eau chaude. Les plus anciens sont entièrement en bois et dotés à leur extrémité inférieure de bâtons qui font office de pales. Plus tard, des agitateurs à ressort seront équipés d’une ventouse en métal.

La « grande lessive » a marqué la mémoire collective des femmes. Cette activité communautaire rassemblait les femmes du hameau ou du village. Unies dans la besogne de purification, elles vivaient un moment de labeur, mais aussi de sororité et d’entraide.
Françoise Marneffe, historienne et responsable des expositions à La Fonderie.

L’une de ces questions – et probablement une des plus interpellantes – concerne le lien automatique qui s’opère inconsciemment entre les tâches ménagères et la femme. Mais ne serait-ce pas qu’une simple perception ou cela correspond-il à la réalité ? Quelle distinction peut-on faire entre travail et labeur ? Comment la répartition des tâches domestiques entre les hommes et les femmes a-t-elle évolué au fil du temps ? Et enfin, quelle est la situation aujourd’hui ?
Afin de répondre à ces questions, nous avons invité deux chercheurs de la VUB (Vrije Universiteit Brussel) qui étudient ce sujet depuis plusieurs années.
Ignace Glorieux est professeur de sociologie. Il mène des recherches sur l’utilisation du temps quotidien et est président de l’IATUR (International Association for Time Use Research).
Son collègue Theun Pieter van Tienoven est également sociologue et chercheur postdoctoral. Ses recherches portent sur la vie quotidienne, la répartition du travail entre hommes et femmes et les inégalités de genre.
Cette conférence vous est proposée en néerlandais. Son titre original est De standvastige verdeling van de onbetaalde arbeid tussen vrouwen en mannen (1966 – 2013).
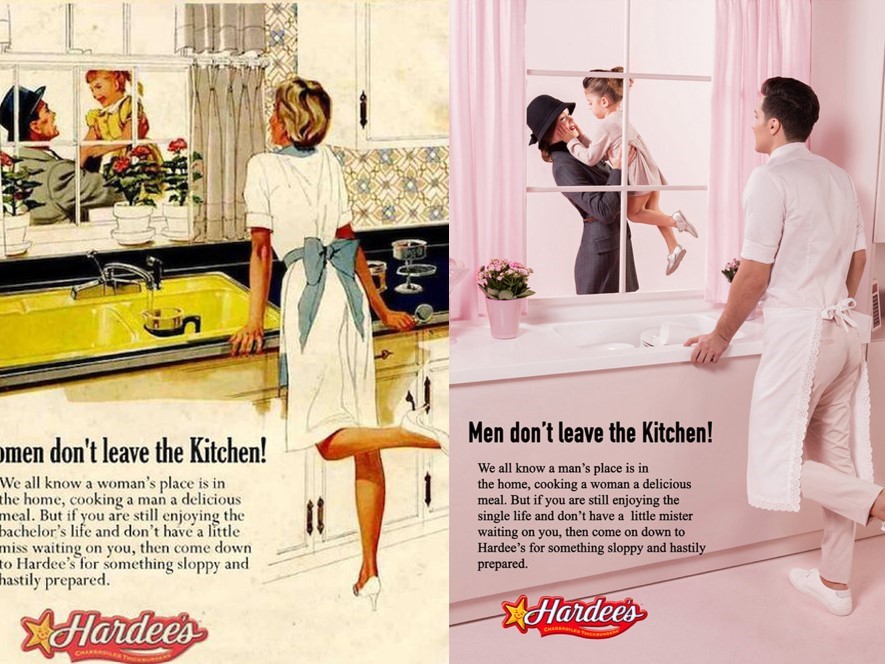
Les fabricants sont à l’origine des menuisiers, des tonneliers ou encore des chaudronniers qui adaptent leurs produits à de nouvelles fonctions. Ces artisans témoignent de beaucoup d’inventivité en produisant des mécanismes parfois très élaborés et en les adaptant aux ancêtres de nos machines à laver. Des firmes spécialisées dans la mise au point, la production et la diffusion d’appareils ménagers se multiplient dans la capitale à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Pour outiller les ménagères ou les nombreuses blanchisseries, ils conçoivent des machines à laver, des tordeuses et des essoreuses. Ces petites sociétés assurent également un service après-vente de proximité, ajoutant par exemple un moteur électrique aux machines anciennes.
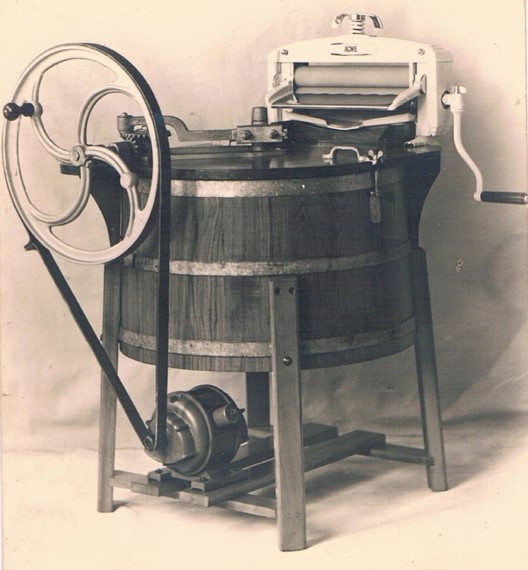
De la vingtaine de firmes présentes à Bruxelles et sa périphérie, nous voudrions pointer l’une d’entre elle : Olympia. Cette société a en effet été fondée par le grand père d’une des guides de la Fonderie, Sylvie De Bruyne. Son évolution est à l’image de beaucoup d’autres entreprises du même type et résume à elle seule une histoire mainte fois répétée.
Cyriel De Bruyne est né à Machelen aan de Leie, près de Deinze, en 1913. Il est tonnelier de profession. Son entreprise familiale est florissante dans une région où la production de tonneaux est au diapason de demandes toujours plus importantes de brasseurs et autres marchands de liqueurs. Cyriel s’intéresse plus particulièrement à la mécanique et s’essaye tout naturellement à la construction de tonneaux de lessive. Le succès est au rendez-vous, à peine interrompu par la Seconde Guerre mondiale. En 1948, il crée avec son jeune frère Robert une société qu’ils baptisent du nom d’« Olympia », en hommage aux Jeux Olympiques qui se déroulent alors à Londres. Le grand-père de Sylvie s’occupe du travail manuel et de la confection des tonneaux, tandis que son frère est responsable de l’administration de l’usine de Machelen et des ventes .
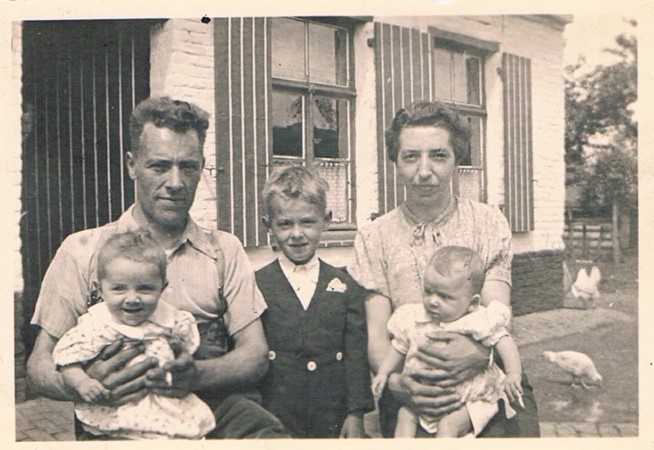
Suite à une divergence d’opinions, les deux frères se séparent. Robert conservera la société et la développera. Cyriel retournera à la fabrication de tonneaux avant d’ouvrir un grand magasin d’électroménagers et de matériel de jardin à Olsene (Deinze). Il meurt à Waregem en 1992.
La marque Olympia va connaitre un grand succès, surtout local. Les machines, très simples au niveau du design, sont réputées pour la qualité du lessivage. On les surnommait les « boerenwasmachines », les machines paysannes, pour souligner leur solidité : ce type de machines est acheté pour 20 ans et constitue un investissement sur le long terme, garanti par un service après-vente sans défaut.
En 1967, une cinquantaine de fabricants de machines sont toujours signalés en Belgique. Leurs ateliers vont bientôt devoir s’effacer face à la concurrence de grandes multinationales qui inondent le marché de produits moins encombrants et à bas prix. L’arrivée de la machine automatique porte un coup fatal à ces petites entreprises locales, qui disparaissent au profit de sociétés étrangères. Mais Olympia se maintient malgré tout et produira des machines à laver automatiques et plus tard électroniques. La firme de Machelen conservera toujours une taille modeste, n’employant jamais plus de six personnes, et vendant surtout des machines en Flandre et à Bruxelles.
Fons et Jan, les deux petits-fils du fondateur, décident finalement de cesser leurs activités en 2008. Il s’agissait de la dernière entreprise belge fabriquant des machine à laver. Pourtant, Olympia continue toujours de garantir un service de réparation. Leur site internet annonce d’ailleurs « Le 1er mars 2008, la production des machines à laver Olympia a été arrêtée. Cependant, vous pouvez encore profiter de notre service rapide et fiable pendant de nombreuses années. » Un rapide coup d’œil sur des sites de vente de seconde main montrent que ces machines inusables tiennent toujours la cote !

Aujourd’hui, dans des complexes ultra modernes, il est à peine plus rapide de faire une lessive que de fabriquer un lave-linge. Les plus grands fabricants actuels de machines à laver sont entre autres américains (General electric, Kenmore, Whirlpool), coréens (Samsung, LG), suédois (Electrolux) ou chinois (Haier). Mais l’ambiance de ces usines y est certainement beaucoup moins familiale que celle des ateliers des frères De Bruyne.
Auteur : Pascal Majerus, conservateur de La Fonderie, Musée bruxellois des industries et du travail.
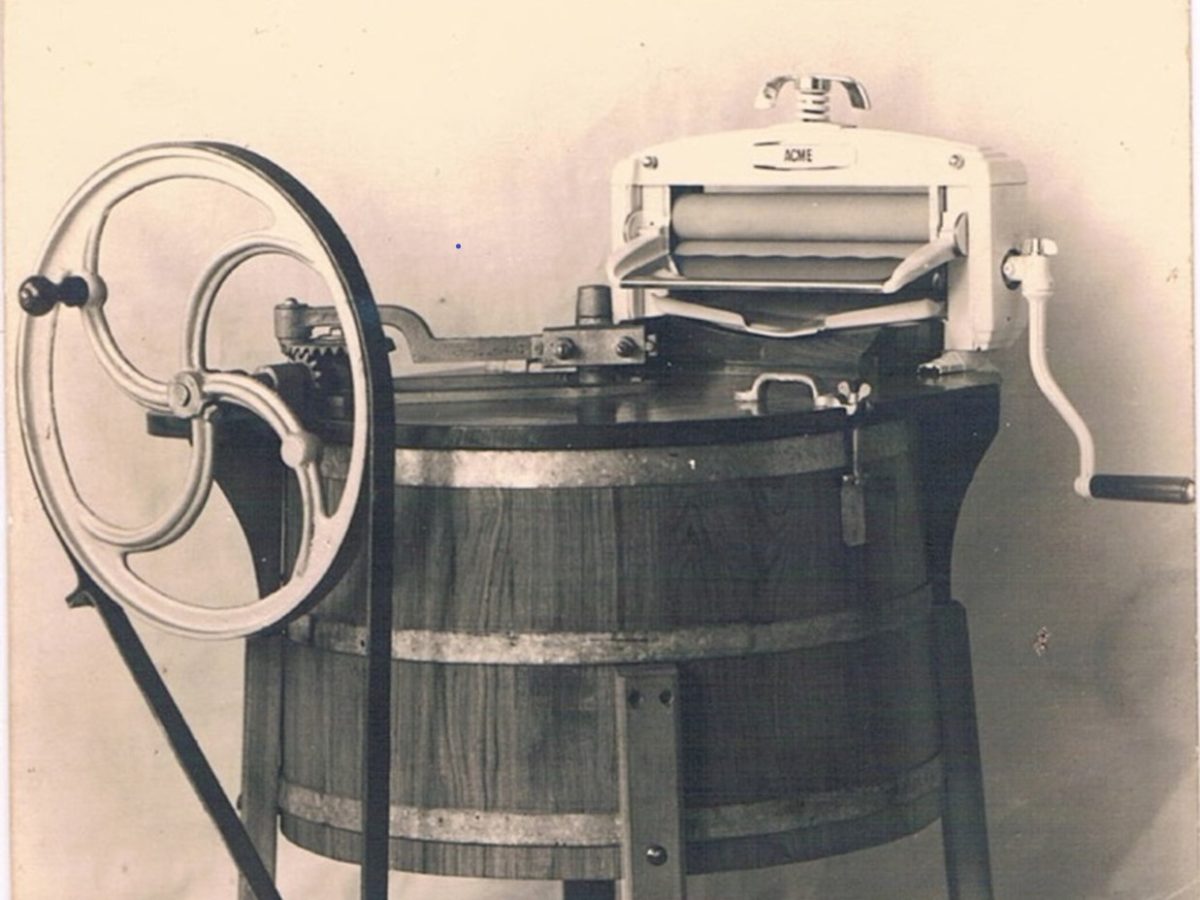
Culturellement le blanc représente la pureté. La robe de mariée en constitue un parfait exemple. A la fin du 18e siècle, la couleur blanche s’impose aux jeunes filles. Elle est censée figurer leur virginité. Mais le blanc est également la couleur de l’hygiène par excellence. Du coup, la saleté renvoie à la faute. Entretenir son linge avec soin devient donc une obligation morale.
À la Renaissance, l’eau est considérée comme dangereuse pour la santé. On pratique la « toilette sèche ». En même temps, la chemise blanche devient essentielle. Porter une chemise sale est indécent et suspect. L’habit révèle une image de l’âme de celui qui la porte. Le blanc que l’on affiche témoigne donc de la pureté de celle-ci.
Cette prédilection pour le blanc s’explique aussi par des raisons pratiques. Les tissus qui touchaient le corps (les draps, le linge de toilette, les sous-vêtements) devaient être blancs car c’était la seule couleur pouvant être lavée à haute température tout en restant stable. L’hygiénisme du 19e siècle a d’ailleurs fait du linge bouilli un de ses crédos pour venir à bout des épidémies.
Assignée à l’entretien du linge, la femme est responsable de sa propreté et de sa blancheur. Elle en a la charge morale et culturelle, pour le bien familial et collectif. Les publicitaires contribueront à ancrer cette norme morale et hygiénique du blanc. Le graal du blanc parfait est une constante dans les campagnes promotionnelles des produits lessiviels. Leurs slogans quelque peu absurdes s’adressent à la femme représentée dans son rôle de mère et de ménagère : « lave plus blanc que blanc », « toujours plus blanc », « si blanc, on ne peut plus blanc »…
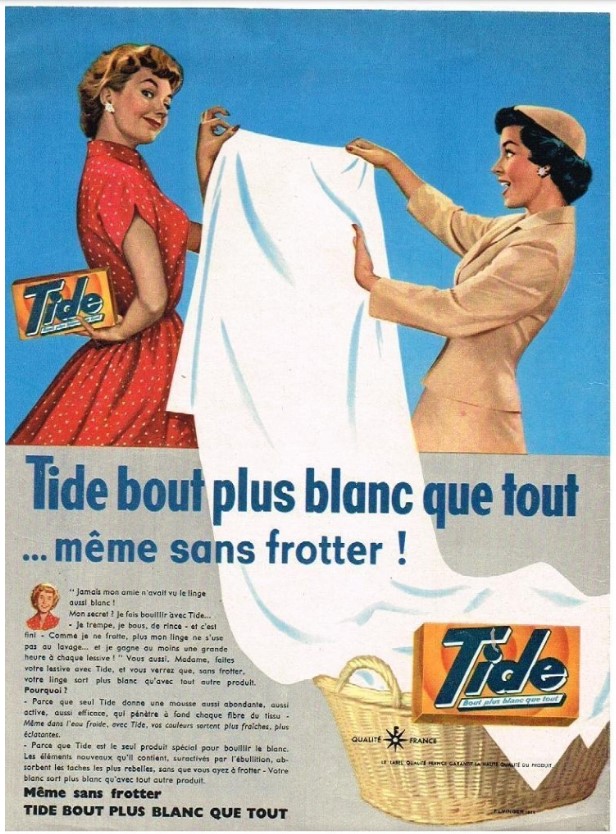
Les publicités d’époque véhiculent des messages propres à deux types de stéréotypes. D’une part,celui de la femme en charge des devoirs et tâches domestiques. D’autre part, des stéréotypes « raciaux » surfant toujours sur cette valeur du blanc. En témoignent des publicités pour des produits de lessive ou de l’eau de javel capables de « blanchir un nègre ».

Un slogan impensable de nos jours… Et pourtant, en 2016, un spot publicitaire chinois semble tout droit s’en inspirer. Dans une salle de bain, un jeune homme noir taché au visage par de la peinture blanche est attiré par une jeune Chinoise. Elle lui met une dosette de lessive Qiaobi dans la bouche et le pousse dans une machine à laver. Un jeune Chinois « idéal » en ressort. Il a le teint clair et est tout propre dans son t-shirt blanc immaculé…
Ce clip a été visionné des millions de fois sur les réseaux sociaux et a suscité un tollé international. Cependant, il existe des contre-exemples. Comme cette publicité italienne des années 2000 qui déjoue ces stéréotypes en vantant un produit de lessive destiné aux vêtements de couleur… Cette fois, c’est un homme blanc gringalet et sans allure qui se transforme en un homme noir musclé et attirant. « C’est mieux en couleur », affirme le slogan final.

La Fonderie est heureuse de vous accueillir au musée bruxellois des industries et du travail. Pour vous garantir une visite agréable et sûre, nous vous demandons juste de respecter quelques règles de sécurité.
Port du masque
Le port du masque est nécessaire sur l’ensemble du site de La Fonderie : le site extérieur, le musée et le bâtiment administratif comprenant le centre de documentation. Nous vous demandons de le porter pendant l’ensemble des activités : visites d’exposition, visites guidée, stages ou consultations du centre de documentation.
Conformément aux dispositions relatives à l’horeca, vous en êtes dispensés lorsque vous consommez nourriture ou boissons à la cafétéria ou en terrasse.
Gestes barrière
Une distance physique d’1m50 est requise entre personnes ne partageant pas la même bulle. Une solution hydro-alcoolique est à votre disposition au musée. Il vous est demandé de vous désinfecter les mains à votre entrée et à votre sortie.
Nombre de visiteurs du Musée
Le musée bruxellois des industries et du travail limite le nombre de visiteurs à maximum 10 personnes par tranche horaire.
Réservation et paiement
Il est fortement conseillé de réserver votre visite au musée à l’avance. Veuillez nous contacter du lundi au vendredi (10h – 17h) et le weekend (14h – 17h) par téléphone ou par e-mail : reservation@lafonderie.be – 02 410 99 50. Le paiement se fait au musée. Nous vous demandons de privilégier les paiements par carte bancaire.
Paiement pour les visites guidées
Dans le cas des visites guidées en ville, nous recommandons vivement le paiement anticipatif par virement bancaire. Si vous préférez payer le jour même, nous vous prions de remettre la somme exacte au guide.
Cafétéria fermée
Conformément aux dispositions relatives à l’horeca, la cafétéria du musée est temporairement fermée.
Centre de documentation
Le centre de documentation est actuellement fermé aux visiteurs jusqu’au 19 novembre inclus. Cependant, l’équipe se pliera en quatre pour répondre à vos questions et vos besoins. Vous pouvez nous contacter : centredoc@lafonderie.be - 02 413 11 80 ou 76 .
Personne de contact
Si vous avez des questions ou des remarques par rapport aux mesures sanitaires de La Fonderie, vous pouvez contacter notre Covid manager Anne-Sophie Walazyc à l’adresse info@lafonderie.be ou au 02 410 10 80 .

Dans un post sur notre compte Facebook, nous vous avions promis de faire fleurir nos rosiers jusqu’à votre retour à la fin de ce 2ème confinement. La mission est accomplie.

Afin de rendre votre visite la plus agréable et la plus sûre possible, nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires. Nous vous invitons à les parcourir sur cette page info. Nous vous rappelons par ailleurs qu’il est préférable de réserver votre visite par e-mail à l’adresse reservation@lafonderie.be ou par téléphone au 02 410 99 50.

Faire ses devoirs, ramasser les pommes tombées de l’arbre pour en faire de la compote, effectuer un stage, passer ses examens, préparer un entretien d’embauche, faire sa vaisselle, exercer un métier, faire son repassage, éduquer les enfants, donner de son temps libre à une association, présider un comité de parents à l’école, réparer sa toiture, former son remplaçant, écrire ses mémoires… Le travail, c’est la vie.
On le fait par choix ou par obligation, avec les pieds de plombs ou par plaisir, bénévolement ou contre rémunération. On l’effectue au bureau ou à l’usine, dans le jardin ou à l’école, de jour comme de nuit, pour le bien commun ou pour sa propre santé mentale. C’est un hobby ou un métier.
Nous y passons tou–te-s. Avec plus ou moins de bonheur. Il nous apporte compétences, savoir-faire et savoir-être. Il nous fait grandir, nous honore ou nous ennuie. Il occupe la majeure partie de notre temps. Et nous avons toutes et tous quelque chose à dire à son propos.
A La Fonderie, le travail nous intéresse, voie même nous obsède. Nous le décortiquons, l’étudions, l’exposons, et transmettons ce qu’il nous apprend. Et pour cela, on a aussi besoin de vous…
Voici 4 projets d’éducation permanente. 4 façons bien distinctes qui vous permettent de témoigner de votre travail…
Une table, quelques verres, deux, trois ou quatre personnes assises… Ils et elles discutent de leur travail. « Que fais-tu ? » ; « ça se passe comment ? » ; « tu trouves ton travail utile ? » ; « qu’est-ce qui t’a donné envie de faire ça ? » ; « comment crois-tu que ton travail va évoluer ? »…
La conversation est enregistrée. Cet enregistrement sera versé dans la base de données de mémoire orale du centre de documentation de La Fonderie. Une capsule audio sera montée et diffusée sur notre site internet. Et la matière ainsi recueillie servira à la rédaction d’un Dictionnaire subjectif du travail. Autant de façons de faire profiter le plus grand nombre d’entre vous de l’intéressant échange qui aura eu lieu.
Pour en savoir plus sur le projet, cliquez ici…
Ces métiers qui sont les nôtres
Un groupe de personnes qui au départ, ne se connaissent pas. Des rencontres, des visites, des animations, des jeux, des débats, des ateliers… Pendant un an, nos métiers seront le fil conducteur de nos activités et à travers eux, nous apprendrons à mieux nous connaître.
Durant la deuxième année, nous dissèquerons ce que nous avons dit et fait l’année précédente. Avec l’aide d’un comédien et metteur en scène, nous en ferons du théâtre amateur.
Pour en savoir plus sur le projet, cliquez ici…
Atelier d’écriture “Une vie de labeur”
Quand j’étais petit-e, je travaillais… ; Faites le portrait d’un travailleur dans un siècle ; Écrivez l’épitaphe de votre travail.
Voici quelques exemples de consignes données aux participant-e-s à cet atelier d’écriture qui se veut à la fois créatif et documentaire. Ici, l’animatrice ne corrige pas votre style et ne vous donne aucun truc d’écrivain, sauf à la demande mais ce n’est pas le but. Elle met en place par contre un contexte et utilise une méthode de travail pour vous inspirer un maximum de textes sur les mille et une formes que prend votre travail, au quotidien ou plus particulier. Elle fait émerger des récits parfois documentaires, parfois plus fantaisistes, qui contribueront à documenter l’histoire du travail à Bruxelles, hier, aujourd’hui et demain.
Pour en savoir plus sur ce projet, cliquez ici…
Bilan : groupe de paroles pour jeunes retraités
Après avoir effectué un, deux, ou une multitude de métiers, il est temps de faire « place aux jeunes » comme on dit, et de prendre « un repos bien mérité ». Mais à quoi aspirez-vous réellement ?
Vous êtes jeune retraitée ou retraitée ou en passe de le devenir. Vous avez derrière vous une carrière riche en enseignements et devant vous… l’inconnu. Vous avez envie de retracer l’histoire de votre carrière, d’en faire le témoignage et, ce faisant, de réfléchir avec d’autres à la suite. Nous vous proposons de rejoindre notre groupe de parole qui débutera en février (à condition que la situation sanitaire le permette et si ce n’est pas le cas, nous trouverons une façon de le faire… autrement).
Pour en savoir plus sur ce projet, cliquez ici…

Les collections du musée comportent une grande diversité d’objets : œuvres d’art – notamment des plâtres ou dessins de la Compagnie des Bronzes -, machines, outils, matériel technique, objets du quotidien, témoignages oraux, fonds photographiques, archives d’entreprises… Ce sont autant de témoins de l’histoire industrielle bruxelloise.
Une série de défis se présentent au conservateur/à la conservatrice adjoint.e. Il/elle aura un rôle essentiel notamment dans le cadre du déménagement des collections et la réorganisation des réserves du musée.
Tenté par ce challenge ? Téléchargez ici l’offre emploi conservateur-trice adjoint-e.
Postulez au plus tard pour le 31 janvier 2021 à l’adresse emploi@lafonderie.be. Bonne chance !

Ce qu’on y découvre…
Dans une démarche qui est avant tout celle de l’histoire sociale, nous nous interrogeons d’abord sur cette question cruciale : qui fait la lessive ? Et la réponse est d’emblée : les femmes. De tout temps, laver le linge fut d’abord une tâche féminine.
Une analyse spatiale apporte également de précieux enseignements. C’est le cas des espaces domestiques de la maison. Mais c’est encore plus marquant pour les espaces de la ville où la présence de l’eau, naturelle (cours d’eau) puis artificielle (via la distribution), joue un rôle fondamental dans l’organisation des activités liées au lavage du linge.
Faire la lessive aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec la “grande buée” ou la grande lessive d’avant la généralisation des machines. Plusieurs auteurs témoignent de la lourdeur et de la pénibilité d’un travail que la mécanisation n’a pourtant pas entièrement supprimées.
Mais au-delà des gens, des lieux, et des techniques de la lessive, ce sont sans doute les valeurs qui s’y attachent qui nous en apprennent le plus sur les évolutions sociales. Mouvements hygiénistes, exaltation du blanc, schémas traditionnels et conservateurs passent la revue.
Et qu’en est-il de l’avènement d’une lessive verte et durable qui abandonne ces produits qui, s’ils ont fait la gloire de l’industrie chimique du 19ème siècle, n’en sont pas moins extrêmement toxiques ?
Pour le tenir entre vos mains…
Ces problématiques et bien d’autres sont à découvrir dans ce Cahier. Vous pouvez vous le procurer à l’accueil de La Fonderie au prix de 12 euros. Il est également disponible par correspondance (+ frais postaux). Adressez votre demande à info@lafonderie.be

On se souviendra sans doute du début de l’été 2020 comme de la saison du déconfinement et du déboulonnage de statues commémoratives.
En réponse au meurtre de George Floyd, des statues évoquant l’oppression raciale ou les exactions coloniales sont prises à partie, abattues ou vandalisées. Celle d’Edward Colston, négociant anglais d’esclaves du 17e siècle, a été arrachée de son socle à Bristol et jetée dans la rivière Avon. Des gestes similaires se répètent dans le monde entier, et en Belgique, ce sont surtout les représentations de Léopold II qui sont visées. Si elles sont prisent pour cibles, c’est dans l’idée que l’esclavage et la colonisation en ancrant durablement dans l’inconscient l’image du noir inférieur, sauvage et dominé, serait à l’origine du racisme encore présent aujourd’hui. Ces statues ne seraient donc pas uniquement un rappel de crimes d’une autre époque, mais pour ceux qui réclament leur retrait, symboliseraient le racisme actuel et contribueraient à le perpétuer. La question embrase les médias et les réseaux sociaux, les passions se déchainent. A l’heure du virtuel, la puissance symbolique de ces vieilles figures de bronze pâtinées étonne.
Mais de tels gestes ne sont pas neufs : les statues subissent depuis des siècles la vindicte populaire. Lors des révolutions, le peuple s’attaque aux représentations de ses rois déchus ou de ses dictateurs exécutés en renversant leur représentation et en les humiliant. L’histoire de l’Afrique du Sud, avec sa douloureuse expérience de l’apartheid, a vu de nombreuses statues retirées de l’espace public pour pouvoir représenter les aspirations de la nouvelle administration démocratique. Les statues de généraux confédérés aux États Unis ou de colons au Canada font débat depuis plusieurs décennies. Le poids émotionnel de ces figures est lourd : les monuments sont censés unifier la nation, mais lorsqu’au contraire ils stigmatisent division et oppression, une réaction s’organise.
En Belgique, l’attention s’est portée principalement sur les statues de Léopold II, sans doute parce qu’elles sont les plus nombreuses et les plus visibles, mais aussi et surtout pour la responsabilité du roi dans l’organisation coloniale et les crimes qui en ont découlés.
Les statues, c’est un peu notre spécialité à La Fonderie : notre asbl est située à Molenbeek, dans une ancienne fonderie d’art, celle de la célèbre Compagnie des Bronzes. Elle abrite aujourd’hui le Musée bruxellois des industries et du travail. Parmi nos missions, il y a celle de faire connaitre la production bronzière de cette entreprise, omniprésente en Belgique. Ces statues témoignent aussi de la compétence industrielle de notre pays avec des productions d’exception. L’une de ces statues est particulièrement visée par les mouvements anti-racistes, celle de la Place du trône. La statue équestre de notre deuxième roi, créée par le sculpteur Thomas Vinçotte en 1914, n’y sera placée qu’en 1926. Elle suscite aujourd’hui la polémique quant à sa présence dans le centre de Bruxelles et une pétition ayant réuni des dizaines de milliers de signatures réclament son déplacement. « This man killed 15M people » («cet homme a tué 15 millions de personnes» en anglais) y a été tagué.
Le rôle qu’a joué ce roi dans l’histoire coloniale n’est plus à prouver et encore moins à défendre. S’il n’est pas le seul responsable, il symbolise l’expansion de nations européennes outre mers, l’arrogance du blanc, la supposée hiérarchie des races, la force brutale et l’exploitation des ressources locales et des populations pour le bénéfice de la métropole. La statue de la place du trône l’éclaire admirablement. « Le plus impitoyable regard de mépris qui ait jamais plané au-dessus de la racaille » a écrit Michel De Ghelderode quand il évoquait ce bronze.
Décoloniser l’espace urbain risque d’être long. Il y a bien sûr les statues, dont certaines n’ont pas encore été pointées du doigt par les manifestants mais qui sont ô combien problématiques : la statue de Godefroy de Bouillon, trônant place royale, célèbre un homme responsable de massacres épouvantables. Celle de Winston Churchill, que les anglais appellent au démantèlement à cause du racisme bien connu de l’homme d’état, devrait elle aussi partir. Mais il faut également parler des rues parfois baptisées du nom d’assassins, comme le Commandant Lothaire, à Etterbeek, responsable d’atrocités dans l’état indépendant du Congo. Il faudrait aussi questionner les façades d’anciens bâtiments coloniaux boulevard d’Ypres ou rue Dansaert.
Décoloniser, c’est aussi contextualiser des œuvres d’art admirées dans nos musées : par exemple, le Sphinx, œuvre la plus connue du sculpteur Charles Van der Stappen, considéré comme une pièce phare de la sculpture symboliste, a été réalisé en 1897 pour l’exposition coloniale avec l’ivoire congolais et est exposé aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire sans référence particulière. Ces maisons Art Nouveau qui font la renommée de Bruxelles ou le mobilier art déco de nos hôtels de maitre regorgent de produits coloniaux. Sans parler du bronze des bâtiments civils et religieux, comme les portes du palais de Justice, réalisés avec le cuivre congolais… Le travail est immense.
Aborder la question des statues controversées n’est donc qu’une partie du travail de décolonisation. Une des solutions proposée et déjà partiellement mise en place serait de les déménager de l’espace public vers des musées. Des jardins de statues ont déjà été créés dans les anciens pays communistes libérés de la dictature, où se côtoient Lénine, Marx et d’autres penseurs communistes. Le cas de la RDC est intéressant : durant la période coloniale, des statues fondues à la Compagnie des Bronze l’étaient en double et envoyées vers la colonie : Léopold II, Albert Ier, Stanley et d’autres représentants du pouvoir blanc ornaient les artères des grandes villes congolaises, à l’image de la métropole. Déboulonnées après l’indépendance, elles ont longtemps été remisées dans des hangars mais viennent de trouver une destination dans le nouveau musée national qui s’est ouvert à Kinshasa : ainsi la statue équestre de Léopold II, jumelle de celle de la Place du Trône, surmonte maintenant le fleuve Congo depuis les collines du mont Ngaliema.
Mais entre remiser les statues polémiques dans les musée, considérés comme des lieux de dépôt d’objets qu’on ne veut plus voir, et l’hommage inconditionnel que certains leur vouent encore, il y a une marge nécessaire qui peut refléter nos sensibilités contemporaines. A mon sens, les statues doivent être maintenues en place et interprétées in situ, et cela pour plusieurs raisons…
D’abord, elle témoignent d’époques spécifiques et de leur valeurs. A partir des années 1850, les villes belges se peuplent d’une foule de monuments à l’effigie des grands hommes de la nation : des héros comme Evrard t’Serclaes, des peintres comme Rubens, des industriels comme John Cockerill,…. Et bien sûr de nos rois. Ces effigies étaient sensées illustrer les qualités d’un pays neuf, libéral et démocratique, où le sentiment national devait être valorisé. Le bronze ancre un message dans l’éternité et donne des exemples de valeurs aux générations futures.

Mais ces valeurs sont-elles intemporelles ? Bien sûr que non, puisqu’elles correspondent à des moments précis de l’histoire. Mais si ces statues érigées peuvent être perçues en terme d’hommage, elles peuvent aussi être comprises comme le témoignage de propagande de ces valeurs patriotiques, bourgeoises, racistes et patriarcales. Les statues et monuments coloniaux de la période léopoldienne remontent toutes à la reprise de l’État Indépendant du Congo par la Belgique. Elles ont été placées dans l’espace public avec un but de propagande, et non pas pour glorifier des personnes. L’intention de l’Etat belge était de réhabiliter l’idée coloniale mise à mal par les révélations du début du 19e siècle sur les abus de l’administration léopoldienne ; l’opinion publique était alors indifférente, voire hostile à cette expansion. Les retirer amputerait aujourd’hui la ville de témoins importants pour lire l’histoire. Par exemple, l’absence de femmes statufiées, mis à part des Gabrielle Petit ou autre Marguerite d’Autriche, démontre le masculinisme du pouvoir, mais signale aussi combien les questions liées au genre sont encore bien réelles. Une ville est tout sauf un lieu aseptisé et neutre.
Car, deuxième raison, ces statues restent de fantastiques moyens pédagogiques et sont porteuses de débat. D’ailleurs, celui qui nous anime aujourd’hui n’est-il pas possible parce qu’il a été provoqué par ces statues ? A La Fonderie, nos visites guidées pour Belges ou publics étrangers, publics scolaires ou en formation continue, utilisent abondamment ce mobilier urbain pour expliquer la ville. Ces monuments décriés sont de magnifiques accroches à l’échange d’idées, à la confrontation, à l’échange. La controverse est nécessaire pour construire la démocratie. Ces statues nous permettent d’expliquer le contexte historique de leur implantation, d’informer le visiteur en se raccrochant à un visuel tangible et authentique. Car le manque d’informations historiques est criant à l’heure des fake news et des politiques hyper partisanes. Nous avons un besoin urgent de nuances, de sens critique, de données historiques. Les monuments ont la fâcheuse habitude de normaliser le passé, pour le meilleur ou pour le pire. Ils rendent les injustices plus faciles à défendre et, insidieusement, plus difficiles à voir. A nous d’être vigilants. Dans nos pratiques d’éducation permanente, ces statues permettent d’éveiller le sens critique, de comprendre les intentions passées par une remise en contexte et par là de pouvoir passer à l’action dans les problèmes actuels. Elles peuvent ainsi parler d’exclusions sociales, de discriminations à combattre, d’inégalités. Faire disparaitre ces statues n’annulera ni le racisme ni l’injustice. Mais en nous en débarrassant, nous empêchons les discussions et les remises en question collectives.
Enfin, les statues sont visibles par tous et appartiennent à la collectivité. Il faut payer pour visiter un musée, mais pas pour voir ce mobilier urbain lorsqu’il est en place. Quand la commune d’Ixelles évacue la statue du «Général Storms», un des agents de l’Etat indépendant du Congo des plus controversés, du Square de Meeûs pour l’Africa Museum, elle rate l’occasion de raconter l’Histoire et d’éduquer le passant qui ignore tout. Le pourcentage de la population qui se rend dans nos musées reste minime et correspond souvent à des couches aisées. Or, ces statues peuvent être de vrais outils d’éducation populaire. A condition, bien sûr de les contextualiser, de les interpréter par des plaques explicatives ou d’autres formes de médiations appropriées, voire de les compléter par des œuvres d’art contemporaines. La véritable question n’est peut–être pas d’enlever ces statues, mais ce qu’il faut y ajouter ! Pensons à l’impact des « pavés de mémoire » qui commémore des victimes de la Shoah et apportent une histoire à des batiments anonymes. Il est par ailleurs intéressant de constater qu’aucun monument d’importance n’existe pour célébrer l’indépendance du Congo, aucune statue en Belgique ne représente des Congolais malgré une histoire « commune » de 80 ans.
Ici se trouve le vrai défi : cette contextualisation ô combien nécessaire doit être collective et éviter qu’un groupe dominant fixe seul les termes du débat. Dans une ville comme Bruxelles où la moitié des habitants est née hors de Belgique, trouver le ton juste, jauger les attentes des uns et des autres sera certainement une gageure. Mais avons-nous vraiment le choix ?
Faire disparaitre les traces, déboulonner les statues serait à mon sens une grave erreur. Si elles disparaissaient, quel débat sera encore possible ? Nous aurons peut être créé une ville décolonisée, mais sans mémoire, et nous risquons de le regretter par après. La Belgique ne pourra pas oublier Léopold II, il est partout sur nos places, dans nos rues. Son monogramme orne de multiples bâtiments. Il fait partie de cette histoire qu’il nous faut assumer. Nous serons peut–être déculpabilisés en surface de notre passé colonial en faisant disparaitre les représentations controversées. Quand ce passé sera devenu invisible et lointain, qu’en garderons–nous ? Nous portons tous comme Belges le poids de cette histoire peu glorieuse. N’oublions pas que c’est la Belgique entière qui a bénéficié de cette époque coloniale, et pas seulement Léopold II. Nous devons assumer que ce passé, avec toute son horreur, est bien le nôtre et que si nous ne sommes personnellement pas responsables, nous en sommes les héritiers. Un peu comme ces bronzes urbains, dérangeants mais que nous devons confronter. Le récent rapport des experts de l’ONU rappelle non pas les crimes coloniaux au Congo, mais bien nos difficultés à confronter cette histoire. C’est ce passé que nous devons enseigner dans nos écoles, c’est cette histoire que nous devons débattre, et les statues urbaines peuvent nous y aider.
Pascal Majérus
Conservateur de La Fonderie

Depuis 2000, La Fonderie vous a proposé des croisières sur les canaux bruxellois. Lors de celles-ci, on vous racontait le chantier du creusement du canal Bruxelles-Charleroi et le rôle qu’il a joué dans le développement de Bruxelles en pleine révolution industrielle. On vous expliquait le rôle et le fonctionnement des écluses. On vous narrait les nombreuses activités liées aujourd’hui encore au Port de Bruxelles et à ses bassins : transport, recyclage, incinérateur, yachting et plaisance… Bref, c’était l’occasion de vous faire découvrir Bruxelles et son histoire sous un angle original.
Ces croisières, nous vous les proposions à bord du bateau, la Gueuse. Initialement, il fut construit pour l’exposition universelle de 1939 en Suisse. Baptisé “Möve” – mouette en allemand -, il a transporté pendant 60 ans ses passagers d’une rive à l’autre du lac de Zürich. Et en 1999, il a fait le voyage jusqu’à Bruxelles par convoi exceptionnel. Rebaptisé « la Gueuse », il a entamé une seconde carrière sur les canaux bruxellois avec les parcours de La Fonderie.
Pour diverses raisons, La Fonderie se voit aujourd’hui dans l’obligation de cesser ses activités sur la Gueuse.
Dans sa cabine ou sur le pont, il aura emmené des milliers d’écoliers et autres visiteurs à qui nos guides ont fait découvrir les canaux bruxellois, leur histoire et leur patrimoine. Et c’est le cœur triste mais la tête pleine de bons souvenirs que nous quittons ce bateau.
Cependant, nous voulons réinventer nos parcours au fil de l’eau. Et nous reviendrons vers vous avec des propositions innovantes, éducatives et solidaires. Parce que nous n’abandonnons pas notre projet de mémoire et de promotion de la zone du canal.

Vous avez peut-être visité notre dernière exposition temporaire Au rivage de Bruxelles. Dans ce cas, vous avez pu vous rendre compte des nombreuses mutations qui ont transformé ce quartier. Autrefois, il fut industriel, industrieux et grouillant d’activités en tous genres. Il est devenu un quartier administratif, dont le paysage et la fréquentation se sont radicalement transformés. En parallèle à l’exposition, La Fonderie a organisé un atelier BD centré sur cette thématique.
Lors de leur première rencontre à La Fonderie, Céline, Chloë, Fanny, Farah, Joëlle, Khaled, Marie, et Rémi ne savaient pas encore très bien comment aborder le sujet. Mais suite à une visite guidée de l’exposition très instructive, les idées fusaient. A tel point qu’il a fallu quelques séances à certains participants pour trouver leur angle d’attaque : scénario, personnages etc.
Ils ont été pour cela conseillés et – disons-le ! – chouchoutés par Dennis Marien, dessinateur, éditeur et animateur de cet atelier. Des plus amateurs aux plus aguerris, ils ont finalement tous trouvé leurs marques pour raconter leurs histoires. Le résultat est une œuvre fantasque, riche de 8 personnalités différentes, et d’autant de styles graphiques.
Un corbeau traverse un poème d’Emile Verhaeren. Une chape de pragmatisme se coule sur le quartier. Un masque aspire à l’amour et à la liberté. Un mégot de cigarette évolue au milieu des grues et machines de chantier. Une serveuse de cabaret voit défiler des personnages hauts en couleurs. Un personnage énigmatique fait naître une colonne monumentale. Un souverain, des politiciens et des riverains s’entremêlent dans une cacophonie d’idées. La ville se transforme en plateforme de jeu Pac Man. Avec ces histoires, laissez-vous balader au fil des mutations du quartier du Rivage…
La bande dessinée est en vente au prix de 6€ à l’accueil du Musée bruxellois des industries et du travail.

Autour de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source, La Fonderie vous propose un riche programme culturel. Il comprend conférences, ateliers, animations et une nocturne. Ces événements s’adressent tantôt aux amateurs d’histoire locale, aux artisans en herbe et tantôt aux enfants.
Découvrez également Oh ! la balade. C’est une promenade interactive à faire en autonomie. Vous y apprendrez plein de choses sur les nombreux métiers liés à l’eau.
| Date | Événement |
| Me 15 décembre | Conférence – Les dessous de l’eau quotidienne à Bruxelles : histoire et perspective |
| Sa 18 décembre | Samedi rigol’eau – “L’eau cassée” et “Monsieur tuyau” |
| Ma 28 décembre | L’eau contée : histoires en kamishibaï |
| Me 29 décembre | L’eau contée : histoires en kamishibaï |
| Me 26 janvier | Conférence – Eau à tous les étages |
| Di 06 février | Visite guidée de l’expo Oh ! Ça ne coule pas de source |
| Sa 19 février | Samedi rigol’eau – water squad |
| Ma 22 février | Conférence – “Bancs publics ? Non ! bains publics…” |
| Di 06 mars | Visite guidée de l’expo Oh ! Ça ne coule pas de source |
| Sa 19 mars | Samedi rigol’eau – 1.000 milliards de fois plus petits qu’un petit pois |
| Date | Événement |
| Di 27 mars | Journée de l’eau et Printemps des sciences |
| Je 31 mars | Conférence – La problématique de la Senne à Bruxelles, des inondations de 1850 à la mise en service du second voûtement de la rivière en 1955 |
| Di 03 avril | Visite guidée de l’expo Oh ! Ça ne coule pas de source |
| Di 03 avril | Visite guidée – De la soif au soulagement |
| Je 7 avril | L’eau jouée : visite ludique et jeux de société |
| Sa 16 avril | Samedi rigol’eau – Eau à tous les étages |
| Me 20 avril | Conférence – Les fontaines, un fil rouge du développement urbanistique de Bruxelles ? |
| Di 1er mai | Journée des artisans |
| Di 1er mai | Visite guidée de l’expo Oh ! Ça ne coule pas de source |
| Sa 21 mai | Samedi rigol’eau – Des crabes dans les égouts |
| Di 05 juin | Visite guidée de l’expo Oh ! Ça ne coule pas de source |
| Sa 18 juin | Samedi rigol’eau -Un fatberg dans les égouts ? |
| Di 19 juin | Visite guidée – De la soif au soulagement |
| Di 26 juin | Oh ! La journée des tout-petits |

Oh! La balade est une promenade sonore en autonomie de La Fonderie au Musée des Égouts. Téléchargez le plan du parcours en cliquant ici. Ce plan en version papier est à votre disposition à l’accueil de La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail – et au Musée des Égouts. C’est gratuit !
Qu’est-ce qui se cache derrière une taque de distribution d’eau? D’où vient et où va l’eau de la douche? Y a-t-il des sources à Bruxelles? Cette balade sonore est un voyage dans les coulisses des métiers de l’eau à Bruxelles. Partez à la recherche des bornes-pavés en bronze, scannez le code QR ou lisez la puce NFC et écoutez les récits des acteurs de l’eau.
Les bornes ont été conçues par des jeunes de l’école de devoirs l’Amorce dans le cadre du stage Sous les pavés organisé par La Fonderie, le Musée des Égouts et Fabwest en juillet 2021. Les participants ont réalisé des modèles originaux en plâtre qui ont servi pour couler les bornes-pavés en bronze, inspirées par la grande variété de plaques présentes dans nos rues.
Pas de 4G? Écoutez les podcasts de chez vous.
Si vous souhaitez prolonger ce périple au fil des métiers de l’eau à Bruxelles, nous vous conseillons de découvrir une seconde balade sonore créée par notre partenaire VIVAQUA : Sur les traces de l’eau en région bruxelloise. Celle-ci vous mènera du Bois de la Cambre au Musée des Égouts.
Les plans de ces deux balades sont disponibles dans les deux musées.
Les acteurs de l’eau : Negi Ben Ali (SIAMU), Dimitri Crespin (VUB), Christian Debuyst (VIVAQUA), Pieter Elsen (Canal It Up), Roel Jacobs, Sophie Richelle (LIEU et ULB), Koen Van Den Broek (Infirmiers de rue), Roland Vereycken (Musée des Égouts).
L’équipe du projet : Martin Angenot, Aude Hendrick, Sylvie Jacobs, Katerina Papadopoulos (Musée des Égouts), Françoise Gutman, Pascal Majerus, Luiza Mitrache (La Fonderie) Stephy Maes, Julien Petrequin (Fabwest).


Exposition au Parc du Karreveld : Louis Mettewie, bien plus qu’un boulevard !
Découvrez les nombreuses réalisations d’un industriel défenseur du suffrage universel et d’un bourgmestre molenbeekois qui a profondément modernisé sa commune.
Ce sera également l’occasion de découvrir la publication qui lui est dédié.
En collaboration avec : 

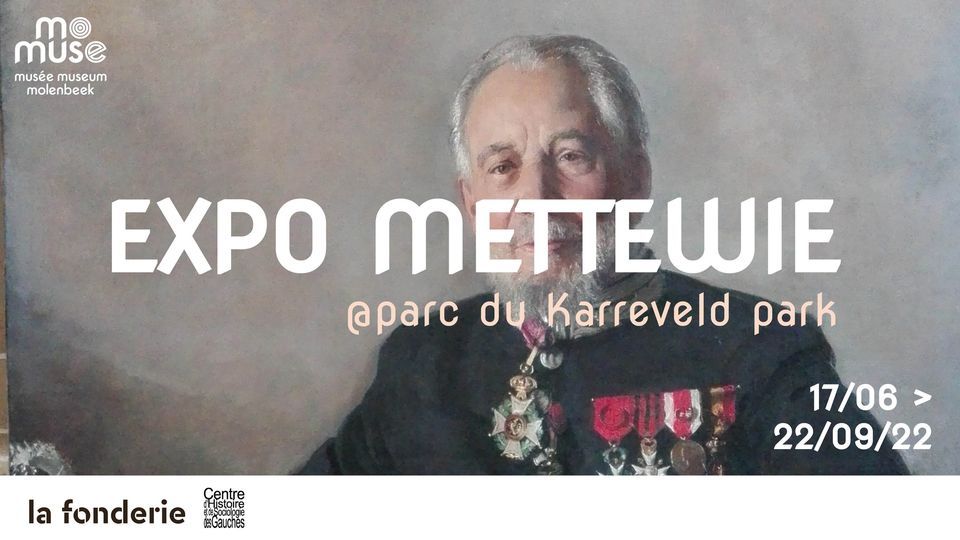
Participez à ce samedi rigol’eau !
Chaque troisième samedi du mois , La Fonderie vous propose un atelier créatif dédié aux enfants. Il vous permet de prolonger votre visite en famille de manière ludique et amusante. L’atelier est amorcé par une réflexion critique sur l’une des thématiques de l’exposition. Spectacles et lecture de contes seront également proposés.
Imaginez un énorme amas de graisse et de déchets qui pèse des tonnes et qui bouche les égouts. C’est ce qu’on appelle un fatberg. Est-ce qu’une telle monstruosité peut exister dans les égouts bruxellois? Et si cette chose était vivante ? Quelle horreur !
Ce samedi rigol’eau, venez réaliser à partir de matériaux de récup’ et de terre le plus épouvantable monstre des égouts… !

Ce dimanche, La Fonderie vous propose un programme spécialement pour les tout-petits…
Participez à une visite baby friendly de l’exposition Oh ! Ca ne coule pas de source.
Les réservations pour la visite baby friendly sont complètes.
La visite baby friendly vous est proposée en collaboration avec l’asbl La Court’Echelle.
Une après-midi avec des “jeux d’eau” en lien avec la salle de bains était prévue en plus. Malheureusement ces activités-ci sont annulées.

Participez à ce samedi rigol’eau !
Chaque troisième samedi du mois, La Fonderie vous propose un atelier créatif en continu dédié aux enfants. Il vous permet de prolonger votre visite en famille de manière ludique et amusante. L’atelier est amorcé par une réflexion critique sur l’une des thématiques de l’exposition. Spectacles et lecture de contes seront également proposés.
Venez explorer la faune des égouts lors d’un atelier de création de petites peluches en feutre ! Celui-ci vous est proposé par l’illustratrice et créatrice Anouk Jurdant.
Anouk Jurdant
Créatrice textile autodidacte, Anouk est un véritable couteau suisse. Initialement illustratrice-graphiste de formation, elle coud par instinct – le plus souvent à la main – pour réaliser des œuvres colorées naviguant avec équilibre dans un univers plus ou moins doux, plus ou moins rigolo.Curieuse chevronnée, elle prend plaisir à puiser son inspiration dans tout ce qui l’entoure. Sous leurs airs mutines et attachantes, ses œuvres textiles s’adressent aux enfants comme aux adultes. Persuadée de la richesse et de la puissance de l’échange des connaissances, Anouk propose des ateliers créatifs vous accompagnant dans un univers artistique pimenté d’originalité et de fraîcheur.


Cette année encore, La Fonderie participe aux Nocturnes des Musées. Ce jeudi … mai, venez découvrir notre musée en toute relaxation…
Visitez notre exposition Oh ! Ca ne coule pas de source. Les commissaires de l’expo seront présentes pour vous guider au travers de l’un ou l’autre segment de l’expo et répondre à toutes vos questions !
Une journée de travail sous tension ? Venez vous faire masser dans la section « hammam » de l’expo. Des étudiants en massage de l’école BGS vous prodigueront un massage assis dont vous ressortirez tout détendu…
Et puis sur le site extérieur, présence d’une installation sonore hydro-cinétique de Pierre Berthet, qui exposera et manipulera une variation de son cru sur le principe de la fontaine traditionnelle japonaise “Shishi Odoshi”.
Tous les jeudis soir du 21 avril au 9 juin, les Nocturnes vous ouvrent les yeux sur les trésors des musées et centres d’art bruxellois.
De 17h à 22h, découvrez les expositions du moment et les collections de 63 lieux insolites grâce à des visites guidées inédites, un accès aux coulisses et réserves ou des ateliers artistiques sur mesure. Pour combiner les plaisirs, les Nocturnes s’organisent toujours par quartier et proposent aussi des promenades extra-muros à la découverte de notre ville.

Le 1er mai, six artisans installent leurs ateliers à La Fonderie. Venez les rencontrer et exercez vos talents créatifs entre amis ou en famille.
La fonderie
Françoise Gutman est sculpteur céramiste. Elle partagera avec vous sa longue expérience du travail du métal. Vous prenez l’empreinte d’un modèle en plâtre dans du sable. Vous obtenez ainsi un moule de fonderie dans lequel on coule de l’aluminium en fusion.

La typographie
Aurélien Cecchi est designer graphique, animateur numérique et médiateur culturel. Amoureux de la communication et de la typographie, il vous introduit à la graphie des lettres tout en développant votre créativité plastique et manuelle. Vous réalisez des tampons et des lettres de typographie à l’aide de matériaux de récupération (lino, caoutchouc, mousse, blocs de bois, bouchons de liège). Aurélien transposera ensuite vos recherches et impressions sous la forme d’un jeu vidéo/portfolio numérique contemplatif créé spécialement pour l’occasion.

L’atelier textile
Saskia De Kinder est designer textile. Elle est diplômée de l’Académie des Beaux- Arts de Bruxelles. Elle crée ses propres motifs qu’elle tisse à l’aide de son métier à tisser manuel à lames. Elle vous propose de sortir des sentiers battus en tissant sur un CD. Vous combinez des textures et des couleurs pour réaliser une pièce unique à exposer chez vous.

L’atelier de feutrine
Anouk Jourdan est créatrice textile autodidacte. Elle est un véritable couteau suisse. Initialement illustratrice-graphiste de formation, elle coud par instinct – le plus souvent à la main – pour réaliser des œuvres colorées naviguant avec équilibre dans un univers plus ou moins doux, plus ou moins rigolo. Curieuse chevronnée, elle prend plaisir à puiser son inspiration dans tout ce qui l’entoure. Sous leurs airs mutines et attachantes, ses œuvres textiles s’adressent aux enfants comme aux adultes. Persuadée de la richesse et de la puissance de l’échange des connaissances, Anouk propose des ateliers créatifs vous accompagnant dans un univers artistique pimenté d’originalité et de fraîcheur.
Le 1er mai, venez réaliser un porte-clefs et des broches en feutrine.

L’atelier numérique
En collaboration avec le pôle Jeu Vidéo d’Arts et Publics, nous vous proposons un atelier numérique hors du commun.
Pauline Flajolet est artiste pluridisciplinaire avec une prédilection pour le textile et le numérique. Vous aurez l’occasion d’apprendre les différents points de broderie et d’explorer les frontières entre travail manuel et travail numérique. Mêler la broderie et le jeu vidéo ? Tout à fait possible. C’est d’ailleurs ce que je vais vous faire découvrir par la confection d’un personnage en broderie qui prendra place au sein d’un jeu vidéo sur le thème de l’exposition temporaire : Oh ! ça ne coule pas de source. A vos aiguilles et vos manettes !

Ekin Bal est créateur et animateur numérique. Il développe depuis plusieurs années des ateliers mêlant jeu vidéo et réflexion sur des thématiques de société, et ce avec des publics variés : enfant comme adulte. Il a notamment réalisé plusieurs projets de création virtuelle spatiale à l’aide de Minecraft. À l’aide de cet outil, il accompagne des groupes dans la création d’une ville utopique ou la réimagination d’un Musée comme La Fonderie. Le 1er mai, Ekin vous ouvre les portes de l’univers tridimensionnel de Minecraft.

Des visites guidées
Des visites guidées des expositions de La Fonderie vous seront également proposées. L’inscription se fera le jour de l’événement, à l’accueil du musée.

Avant que l’eau courante ne pénètre dans nos maisons, la fontaine occupait une place utilitaire et vitale dans la cité. Sa proximité influençait même le prix des immeubles…
Ce n’est que pendant le dernier quart du 19ème siècle qu’elle acquiert le statut d’objet d’art, réalisé par des sculpteurs de renom.
Dédié à la mémoire d’une personnalité imminente – politique (Jules Anspach, Charles De Brouckère) historique ou folklorique (Manneken Pis) – la fontaine devient ensuite pur geste artistique ou ludique, destiné à égayer places et rues pour le plus grand bonheur (?) des promeneurs et des petits baigneurs… Toute une histoire !
Thierry Demey
Thierry Demey est l’auteur des guides historiques BADEAUX dont la vocation est de rendre accessible au plus grand nombre les grands thèmes de l’histoire locale à travers des récits vivants et rigoureux, centrés autour d’un thème et agrémentés de promenades-découvertes commentées. La collection est née en 2003 avec la publication de Bruxelles en vert. Elle compte désormais 13 titres.
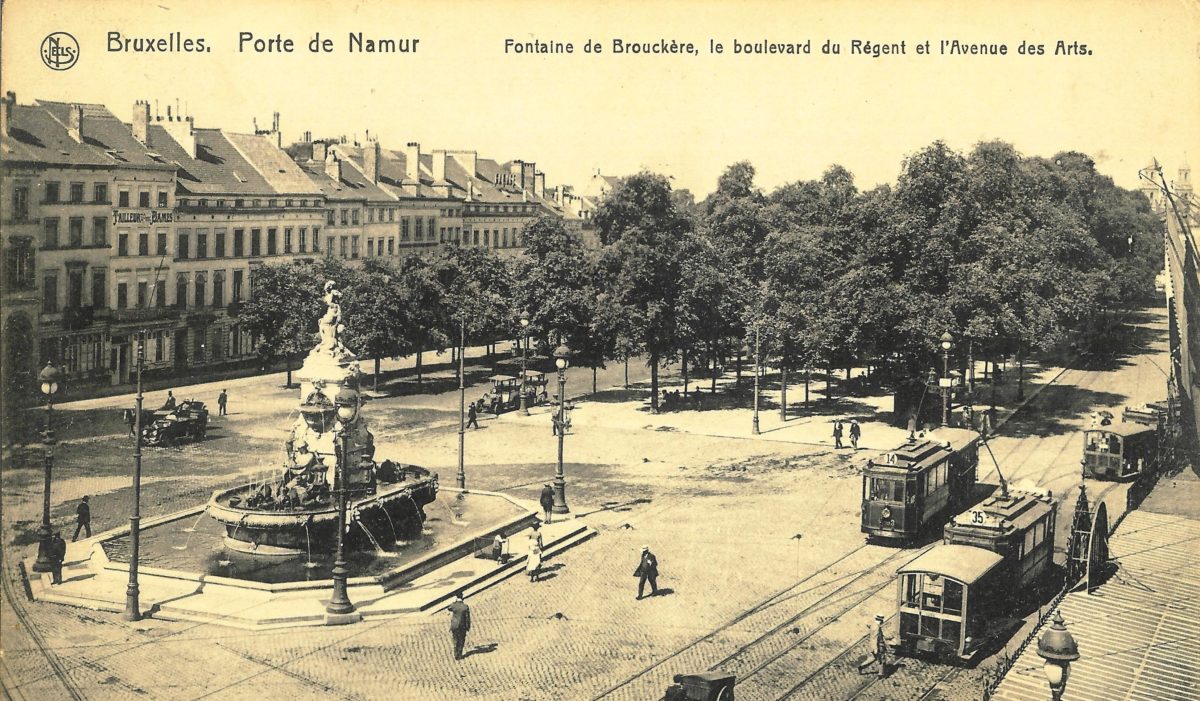
Encore un samedi rigol’eau !
Chaque troisième samedi du mois, La Fonderie vous propose un atelier créatif en continu dédié aux enfants. Il vous permet de prolonger votre visite en famille de manière ludique et amusante. L’atelier est amorcé par une réflexion critique sur l’une des thématiques de l’exposition. Spectacles et lecture de contes seront également proposés.
Ce samedi rigol’eau, on vous invite à participer à l’atelier Eau à tous les étages ! Que se cache-t-il derrière les murs de ta maison ? Après la visite de l’exposition, les enfants réalisent une maison en plâtre où tuyaux, canalisations et siphons sortent des murs !

Pendant ces vacances de Pâques, La Fonderie vous propose « l’eau jouée ». C’est un après-midi de jeux aquatiques…
La Fonderie vous propose une visite ludique de l’exposition Oh ! Ca ne coule pas de source. L’objectif de cette visite est de sensibiliser les enfants à la gestion durable de l’eau dans la ville.
Ensuite, la Ludothèque Speculoos vous propose une sélection de jeux de société situés dans des univers aquatiques !


Cette activité est déjà complète. Cependant, il reste des places pour L’eau jouée, le mercredi 6 avril.
Pendant les vacances de Pâques, participez à ce super atelier aussi ludique qu’instructif ! Profitez-en pour visiter l’exposition Oh ! Ca ne coule pas de source.
Au départ d’une sélection d’albums de jeunesse, les enfants créent un livre accordéon pour illustrer le cycle naturel et anthropique de l’eau. Quel est le trajet d’une goutte ? D’où part-t-elle ? Où va-t-elle ? Comment est-elle éventuellement transformée ?
Cet atelier sera animé par Caméléon bavard.
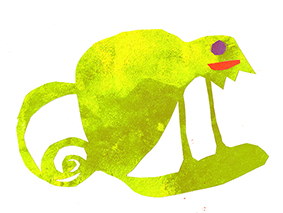
Le titre entier de la conférence est :
La problématique de la Senne à Bruxelles, des inondations de 1850 à la mise en service du second voûtement de la rivière en 1955
Cette conférence abordera les contextes architecturaux, financiers, politiques, sanitaires et urbanistiques qui présidèrent au voûtement de la Senne. Plusieurs questions y seront traitées, dont: Quel fut le rôle exact du bourgmestre Jules Anspach, de l’architecte Léon Suys et des concessionnaires anglais créateurs de la Belgian Public Works Company, Limited? Comment se déroula l’exécution des travaux et quelles furent leurs conséquences sur le sort des populations expropriées? Le conférencier se penchera aussi sur la thématique de l’épuration des eaux usées, sur les projets de prolongement du voûtement de la Senne vers l’aval de Bruxelles, ainsi que sur le second voûtement entamé en 1931.
Yvon Leblicq
Yvon Leblicq est Docteur en Philosophie et Lettres ( Histioire). Il a enseigné l’histoire urbaine à l’École polytechnique de l’ULB, où il est actuellement Professeur invité. Il est le lauréat de divers prix et l’auteur de nombreuses publications sur l’histoire de Bruxelles.


Pour des raisons de santé, nous nous voyons forcé d’annuler l’atelier dans le laboratoire de l’eau. Cependant, l’exposition reste accessible en visite libre et le spectacle L’eau cassée est maintenu à 16h.
Ce dimanche, La Fonderie vous propose un super programme pour mêler la Journée de l’eau et le Printemps des sciences…
Visite et atelier dans le laboratoire de l’eau (14h30 – 16h00)
Dans le laboratoire de l’eau, expérimentez avec les propriétés chimiques et physiques de l’eau.
Visite libre de l’exposition “Oh ! Ça ne coule pas de source” (14h – 16h)
Spectacle « L’eau cassée » (16h – 16h45)
« Ce qui vient de se passer est grave ! Très grave ! L’eau est cassée… Enfin elle n’arrive plus au musée. »
Voilà comment débute ce spectacle animation sur la thématique de l’eau. Et comme à chaque fois qu’une chose est cassée, on fait appel à un réparateur. C’est ainsi qu’arrive le réparateur de l’eau. C’est un monsieur un peu étrange, il a un costume bleu, de drôles d’outils et surtout de drôles d’histoires pour nous expliquer combien l’eau est importante et précieuse. Pour commencer, il faut la retrouver ! Mais d’où vient-elle l’eau ? Petit à petit, et avec l’aide des enfants, le réparateur va réparer l’eau et juste avant de partir, il la fera couler à nouveau sous leurs yeux… Ouf !
Ce spectacle vous est présenté par le Chakipesz Théatre. Il raconte aux enfants le voyage de l’eau, en passant par ses différents états jusqu’à sa sortie par le robinet ! Il allie les aspects ludiques aux aspects didactiques. Par sa dynamique, le comédien inclut les spectateurs qui deviennent ses complices, tout au long de l’aventure.

En écho à l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source, le projet “Piss and Love” vient se nicher dans un « petit coin » de La Fonderie et approche la question des toilettes publiques dans l’espace urbain bruxellois, en mêlant photographie et art plastique, intrigue et revendication.
Venez donc admirer les photographies de Patrice Niset et les incroyables carnets de dessins rassemblés par Cristina Cerqueira qui officie comme “Madame Pipi” au Beursschouwburg”. Le graffeur Danger Dan contribue à faire dialoguer ces oeuvres au travers d’une direction artistique de l’expo et d’une signalétique percutante. Cliquez ici pour en savoir plus sur l’exposition carte blanche Piss & Love.
L’inauguration de cette exposition aura lieu le vendredi 25 mars à 18h30. Tout un chacun est le bienvenu, sans réservation !

Participez à ce samedi rigol’eau !
Chaque troisième samedi du mois, La Fonderie vous propose un atelier créatif en continu dédié aux enfants. Il vous permet de prolonger votre visite en famille de manière ludique et amusante. L’atelier est amorcé par une réflexion critique sur l’une des thématiques de l’exposition. Spectacles et lecture de contes seront également proposés.
Ce samedi, plonge dans une goutte d’eau avec une technique surprise !
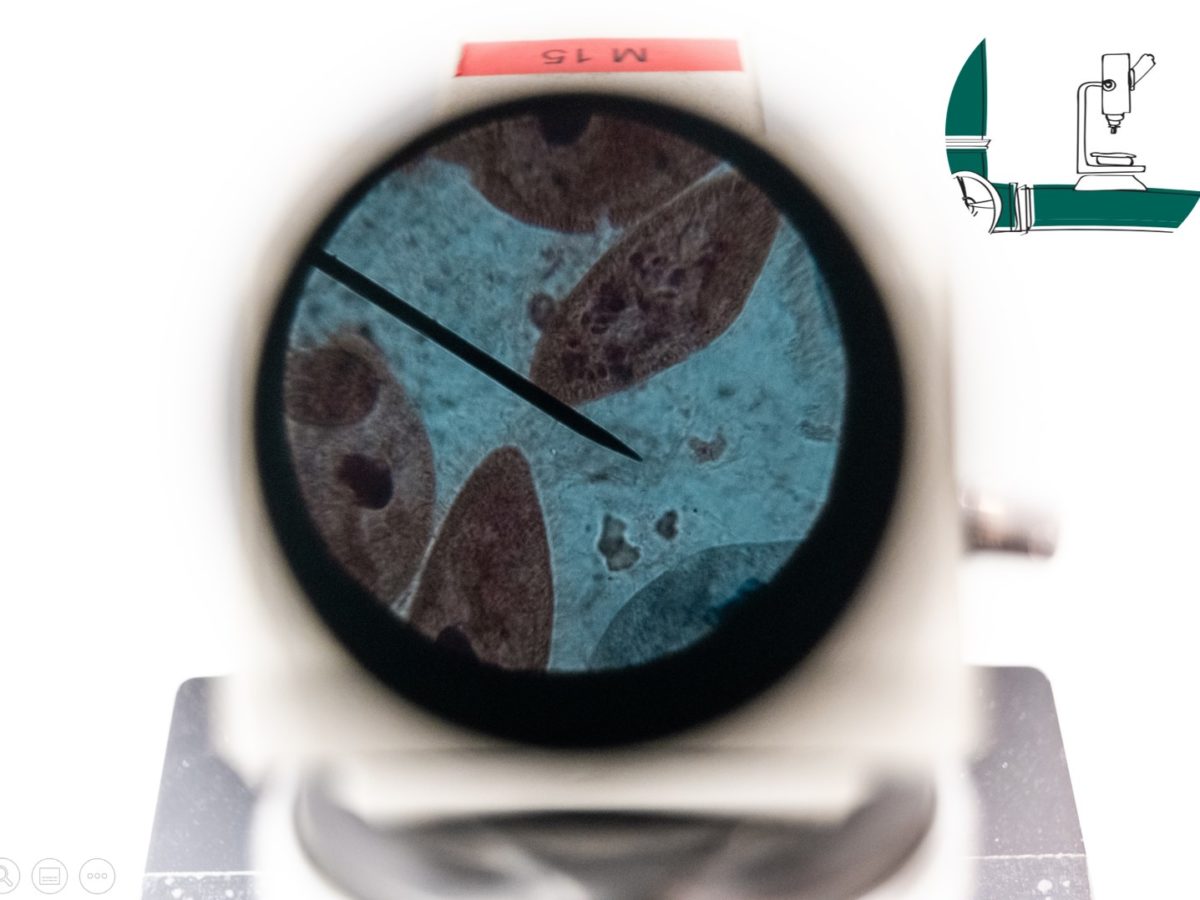
Venez passer une soirée ludique et conviviale à La Fonderie !
Dans le cadre de l’expo Oh ! Ça ne coule pas de source, nous vous proposons en partenariat avec la ludothèque Speculoos une soirée jeux de société.
Vous aimez les jeux de coopération ou les jeux de stratégie ? êtes-vous plutôt univers historique ou univers contemporain? Birmingham ou Tokyo ? Des jeux pour tous, à partir de 12 ans, pour revisiter nos deux thématiques-phares : l’industrie et l’eau.
La ludothèque intergénérationnelle “SPECULOOS” est un espace ludique et convivial destiné à tous. Elle met l’accent sur les relations et les rencontres qui se créent grâce à un outil culturel qu’est le jeu.


Lieux méconnus, effacés des mémoires par la généralisation des salles de bains individuelles à partir des années 1950, les bains publics nous racontent pourtant la ville et la vie des classes populaires. Présents dans la plupart des villes belges jusqu’à aujourd’hui, ils sont les témoins d’un histoire des gestes de l’intime qui n’échappe pas aux inégalités ordinaires de classes et de genre.
Sophie Richelle
Sophie Richelle est historienne, chercheuse post-doctorante à l’ULB. En plaçant au centre de son attention l’expérience sensible, matérielle et humaine d’espaces resserrés et particuliers, elle tente de raconter l’histoire de celles et de ceux qui ont laissé peu de traces. De l’asile de folles aux hospices de vieux, elle poursuit aujourd’hui ses questionnements avec les bains publics.

Participez à ce samedi rigol’eau !
Chaque troisième samedi du mois, La Fonderie vous propose un atelier créatif en continu dédié aux enfants. Il vous permet de prolonger votre visite en famille de l’expositon Oh ! Ça ne coule pas de source de manière ludique et amusante. L’atelier est amorcé par une réflexion critique sur l’une des thématiques de l’exposition. Spectacles et lecture de contes seront également proposés.
Pour ce samedi rigol’eau, nous vous proposons l’atelier « Water squad ». Lors de cet atelier vous allez personnaliser une veste et une casquette. Les enfants brodent et cousent leur badge “Pompier” ou “Égoutier” de la ville de Bruxelles. Cela vous fera un déguisement pour Carnaval !
Atelier proposé par Lili.
L’atelier est complet mais l’exposition reste accessibles pour tous les visiteurs qui souhaitent la découvrir.

Dans la seconde moitié du 19e siècle, l’eau courante est installée dans les habitations. Elle entraine toute une série d’évolutions dans l’architecture de la maison, mais aussi au niveau des comportements et de l’organisation de la vie quotidienne.
Vincent Heymans
Vincent Heymans est docteur en Philosophie et Lettres. Il dirige la Cellule Patrimoine historique de la Ville de Bruxelles, chargée de la gestion et de la valorisation du patrimoine architectural. Il est administrateur du site archéologique du Coudenberg.
Il enseigne l’histoire de l’architecture à l’Université Libre de Bruxelles, à l’ESA Arts2 et à l’ENSAV La Cambre. Il a de nombreuses publications à son actif, principalement dans le domaine de l’histoire de l’architecture et de la conservation du patrimoine.
Conférence donnée le 26 janvier 2022.
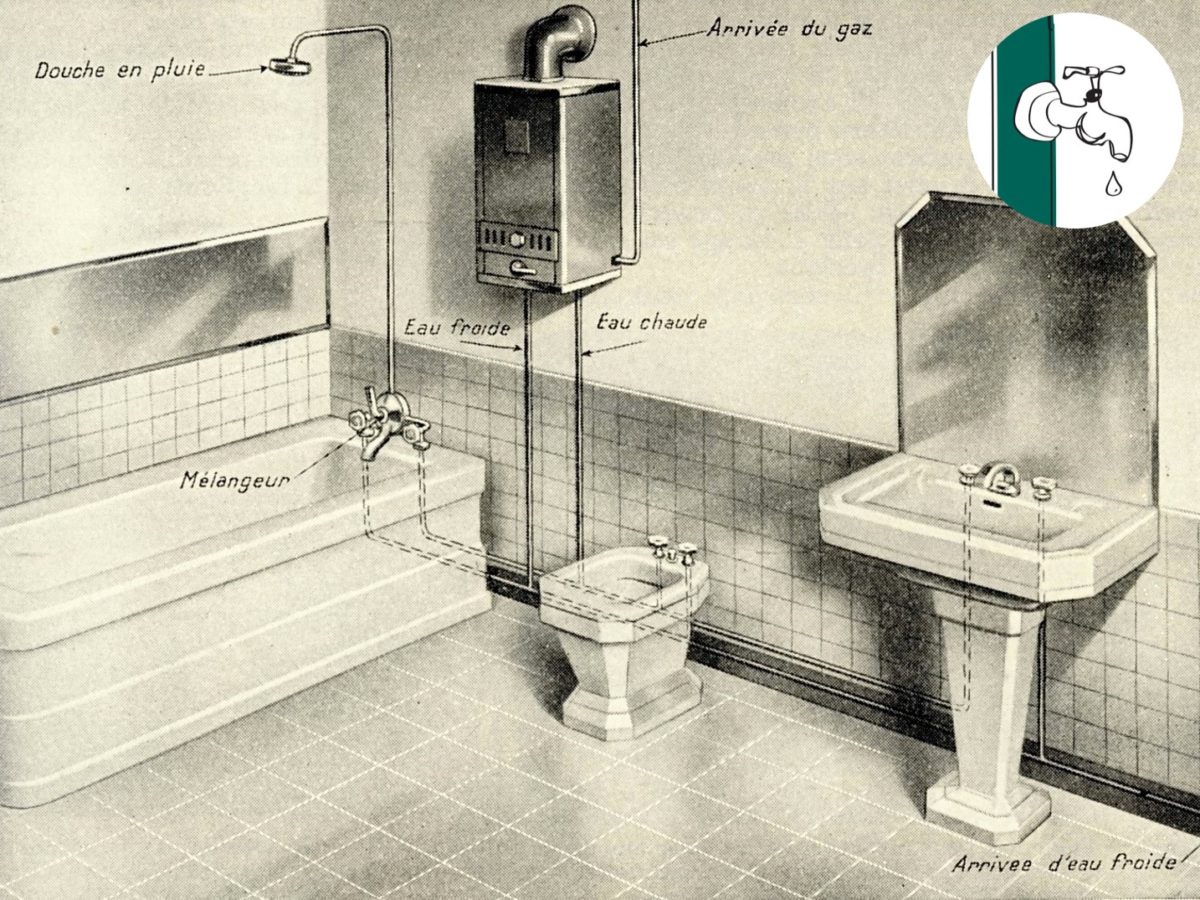
Les après-midis contés du 28 et du 29 décembre seront bien maintenus.
Les activités du musée ne sont pas concernées par les restrictions gouvernementales. Le public est limité à un nombre très restreint de participants (15). Et les gestes barrières seront bien mis en place (masque, distance physique et aération).
Attention : uniquement sur réservation !
Pendant ces vacances de Noël, La Fonderie vous propose « l’eau contée ». Ce sont des après-midis de lecture de contes aquatiques…
Une goutte d’eau suffit pour créer un monde. Dans un espace de lecture cocoon, Zoé interprète des histoires en kamishibaï. Des mondes se révèlent et des êtres fantastiques sortent de l’eau. La lecture est suivie de la visite libre de l’exposition.
Le kamishibaï (littéralement « pièce de théâtre sur papier ») est un genre narratif japonais où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. Il se rapproche du théâtre de Guignol, mais avec des images à la place des marionnettes.

Ce samedi rigol’eau affiche complet.
Participez à ce samedi rigol’eau !
Chaque troisième samedi du mois, La Fonderie vous propose un atelier créatif en continu dédié aux enfants. Il vous permet de prolonger votre visite en famille de manière ludique et amusante. L’atelier est amorcé par une réflexion critique sur l’une des thématiques de l’exposition. Spectacles et lecture de contes seront également proposés.
Pour ce samedi rigol’eau, nous vous proposons deux activités : l’atelier « Monsieur tuyau » et le spectacle « L’eau cassée ».
Atelier Monsieur tuyau (en continu 14h – 17h)
Dans cet atelier créatif, les enfants sont invités à fabriquer un mobile en papier à partir de collages de tuyaux, de robinets et de vannes… !
Spectacle « L’eau cassée » (16h – 16h45)
« Ce qui vient de se passer est grave ! Très grave ! L’eau est cassée… Enfin elle n’arrive plus au musée. »
Voilà comment débute ce spectacle animation sur la thématique de l’eau. Et comme à chaque fois qu’une chose est cassée, on fait appel à un réparateur. C’est ainsi qu’arrive le réparateur de l’eau. C’est un monsieur un peu étrange, il a un costume bleu, de drôles d’outils et surtout de drôles d’histoires pour nous expliquer combien l’eau est importante et précieuse. Pour commencer, il faut la retrouver ! Mais d’où vient-elle l’eau ? Petit à petit, et avec l’aide des enfants, le réparateur va réparer l’eau et juste avant de partir, il la fera couler à nouveau sous leurs yeux… Ouf !
Ce spectacle a été conçu et est joué pour vous par le Chakipesz Théatre. Il raconte aux enfants le voyage de l’eau, en passant par ses différents états jusqu’à sa sortie par le robinet ! Il allie les aspects ludiques aux aspects didactiques. Par sa dynamique, le comédien inclut les spectateurs qui deviennent ses complices, tout au long de l’aventure.

Le premier réseau de distribution à domicile est inauguré en 1855 à Bruxelles-Ville. L’extension rapide de ce réseau vers les communes limitrophes et la création d’un second réseau en 1891 par les communes des faubourgs ne signifie pas que l’entrée de l’eau dans les logements bruxellois s’est produite de façon “naturelle” et sans heurt. Au contraire, la mise en place de la distribution d’eau à domicile a ouvert de nouvelles lignes de tensions, voire de conflits, qu’elles soient scientifiques, politiques ou sociales. La conférence évoquera ces lignes de tensions à travers l’histoire de l’eau quotidienne aux 19e et 20e siècles et montrera que certaines sont toujours actives tandis que d’autres sont réactualisées par les changements profonds de ce début de 21e siècle (paupérisation de la population bruxelloise ou dérèglement climatique).
Chloé Deligne
Chloé Deligne est historienne, formée en géographie et en sciences de l’environnement. Elle est également enseignante à l’ULB et chercheuse au FNRS. Elle est passionnée par les histoires d’eau et, plus généralement, par les questions sociales et écologiques qui touchent les habitants des villes.

L’événement Monstres et Compagnie a malheureusement du être annulé. Toutes nos excuses pour les éventuels désagréments.
Faites parler votre créativité et frissonnez de plaisir avec cette journée des familles spéciale Halloween à La Fonderie.
Inspirez-vous de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source et créez votre monstre en terre, textile, feutrine et papier. Le monstre de la Meuse, celui de la Senne ou encore de la salle de bains seront au rendez-vous… Ensuite les enfants iront cacher leurs créations dans l’exposition et guideront leurs parents à la lampe de poche !
Venez déguisés. Nous nous occupons des grimages.
14h – 17h : atelier de création de monstres en continu
17h – 18h : exploration à la lampe de poche de l’exposition Oh! Ça ne coule pas de source

-CE STAGE EST COMPLET-
Ce stage est une introduction à la teinture sur tissu, à partir de pigments naturels et chimiques issus d’une production locale. Découvrez comment plier, ligaturer, nouer, coudre un tissu ou un vêtement afin de créer une teinture par réserve. Une matinée sera également consacrée à la découverte du cyanophyte sur textile, un ancien procédé photographique.
Le matériel est fourni sur place, mais n’hésitez pas à apporter de vieux draps de lit en coton blanc ou écru ainsi qu’une trousse rudimentaire de couture (jeu d’aiguilles à broder, petite paire de ciseaux).
| RÉSERVATION |


La Fonderie vous propose de découvrir la technique de la “fonderie au sable”. Au terme de ce stage de 3 jours, vous réaliserez un bas-relief ou un volume plein – c’est à dire une statuette – en bronze à l’aide d’un moule simple ou double. Chaque participant sera libre de choisir parmi ces deux techniques.
Le stage est animé par Françoise Gutman, sculpteur céramiste.
Descriptif des étapes :
Pour plus d’informations sur les techniques employées, merci de consulter les vademecums des stagiaires en cliquant ici pour le volume plein et ici pour le bas relief.

La mort de toute chose, de tout être vivant, est inéluctable. Elle nous attend tous au bout du chemin.
Mais dans le monde, elle est vécue différemment d’un peuple à l’autre, d’une famille à l’autre, d’une culture à une autre.

Notre âge ; notre culture, qu’elle soit familiale ou nationale ; nos expériences… nous font appréhender la mort de façon différente de celle avec laquelle l’appréhenderont nos parents, nos frères et sœurs ou nos voisins.

De quelle façon fréquentons-nous le cimetière ? Pourquoi l’évitons-nous ? Qu’y cherchons-nous, qu’y redoutons-nous ?
Quel est notre rapport à la mort ? Serein ou angoissant ? Nous paraît-elle proche ou éloignée, effrayante ou attendue ?
Anne Brunelle, animatrice à La Fonderie, vous invite à la suivre dans un voyage à travers nos représentations du cimetière et de la mort, grâce à l’écriture.
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2023 ou Les 2, 3, 9 et 10 septembre 2023

Lancée en 2001 par la fondation Marcel Hicter, la formation Res Urbis s’adresse aux acteurs culturels bruxellois privilégiant un rapport novateur à la ville.
Elle vise à renforcer leurs capacités à développer leur projet, à comparer leurs pratiques et comprendre les enjeux dans lesquels ils évoluent : politique de la ville, politique et actions culturelles, enjeux sociaux, politiques et économiques.
Les participants sont considérés comme acteurs du processus et non comme étudiants ou apprenants.
Res Urbis est une formation de 6 journées. Elle a lieu à La Fonderie. Elle est axée sur la conception de projets culturels et alterne :
Vous êtes intéressé.e ? Téléchargez le programme et le document d’inscription.
Cette formation est financée par la Cocof, Service Education permanente.

Entre les murs de l’ancienne halle de coulée de la Compagnie des bronzes, il s’agit d’une invitation à un voyage bien particulier. On y explore les méthodes traditionnelles du sculpteur, les gestes et les outils. On y expérimente le processus de la fonte au sable qui tire parti de la malléabilité de celui-ci pour réaliser un moulage à partir de l’empreinte d’un modèle en plâtre. Cette technique, utilisée par la Compagnie des bronzes et encore régulièrement dans certaines fonderies d’art, se différencie fortement de celle, plus connue, de la cire perdue. Au terme de trois jours intenses, chacun repart avec son petit volume en bronze et… son modèle en plâtre.
Vous expérimenterez la sculpture, la réalisation du modèle en plâtre, la fabrication du moule en sable, la coulée de bronze, la ciselure et la patine.
| RÉSERVATION |

Cette immersion dans le textile est l’opportunité de se familiariser avec les divers points et techniques de la tapisserie sur cadre. A partir de chutes de tissus et de vieux vêtements, chacun est amené à créer une nouvelle pièce originale, totalement personnalisée et 100% récup ! De fil en aiguille, nous explorerons le patrimoine matériel et les savoir-faire artisanaux lié au design textile d’hier et d’aujourd’hui : l’occasion d’approcher l’étonnante créativité déployée entre les fils de trame et de chaine, à l’aide d’exemples et d’expérimentations.
Vous avez un vêtement dont vous aimez la couleur ou les motifs mais que vous ne mettez plus car il est devenu trop petit, troué, abîmé ? Un foulard ou un tissu dont vous ne savez que faire ? Amenez-les, nous allons les transformer en matière première pour les intégrer dans un tissage que vous allez entièrement réaliser.
| COMPLET |

Entre les murs de l’ancienne halle de coulée de la Compagnie des bronzes, il s’agit d’une invitation à un voyage bien particulier. On y explore les méthodes traditionnelles du sculpteur, les gestes et les outils. On y expérimente le processus de la fonte au sable qui tire parti de la malléabilité de celui-ci pour réaliser un moulage à partir de l’empreinte d’un modèle en plâtre. Cette technique, utilisée par la Compagnie des bronzes et encore régulièrement dans certaines fonderies d’art, se différencie fortement de celle, plus connue, de la cire perdue. Au terme de trois jours intenses, chacun repart avec son petit relief en bronze et… son modèle en plâtre.
Vous expérimenterez la sculpture, la réalisation du modèle en plâtre, la fabrication du moule en sable, la coulée de bronze, la ciselure et la patine.
| COMPLET |

En 2020 et 2021, six personnes sont venues échanger à propos de leurs métiers à La Fonderie. Elles ont également participé à des animations réflexives et ludiques autour de la notion de métier et de travail. L’ouvrage que vous vous apprêtez à lire contient deux parties : la première est le recueil de leurs témoignages et la deuxième, un carnet d’exploitation de ceux-ci, proposant une série d’activités en lien avec les témoignages, à mettre sur pied pour des groupes d’adultes.
Les métiers abordés sont ceux de Roxane, coach entrepreneuriale ; Marguerite, artiste-pédagogue et architecte-paysagiste ; Claude, syndicaliste ; Margaux, artiste ; Sarah, formatrice en insertion socio-professionnelle et Carlo, sociologue. Certes, ces métiers ne reflètent pas la grande diversité des métiers existants, et aucun ne comporte une part importante de travail physique, mais tous renvoient à des questions universelles sur le travail et sur la façon dont il nous impacte.
Les témoignages et les activités que l’on vous propose en lien avec ceux-ci abordent des thématiques soit en lien direct avec les métiers des témoins (le syndicalisme, qu’est-ce qu’un-e artiste ?, comment s’approprier son environnement ?…) soit en lien avec le travail et la recherche d’un emploi en général (travailler pour l’argent ou pour s’épanouir ?, faire son bilan socio-professionnel, la législation du travail, l’école de mes rêves…).
Thématiques
Art (art et déchets, métier d’artiste, variété dans l’art, art outsider ou débutant) – citoyenneté (engagement, combat social) – compétences individuelles ou de groupe – emploi (recherche d’emploi, CV, maîtrise d’un logiciel informatique, lettre de motivation, chômage, bien-être, conditions d’embauche, conditions de travail, reconversion professionnelle) – environnement (biodégradabilité, écologie) – estime de soi – études (diplôme, enseignement, éducation, école, formation et compétences, comment choisir) – expérience de vie – gestion des déchets – identité – loisirs – métiers (genre, gestion des ressources humaines, balayeur de rue, artiste, reconnaissance et valorisation, changement des mentalités, bons et moins bons métiers, comment trouver le métier qui me correspond, métiers et valeurs personnelles, prestige, peut-on concilier aspirations professionnelles et aspirations financières, comment choisir) – récit de vie – syndicat (rôle, fonctionnement, bien-être) – travail (contrat, expérience professionnelle, législation, allocation universelle, utilité, environnement, objectif)
Description de l’outil/du service
Document 1 : un recueil de témoignages (renvoyant au carnet d’exploitation)
Document 2 : le carnet d’exploitation des témoignages (consignes pour organiser les activités avec un groupe d’adultes)
Objectif
Chaque consigne d’activité est accompagnée de ses objectifs.
Quelques exemples :
Publics
La plupart des activités proposées peuvent être organisées avec n’importe quel public. Cependant, certaines activités s’adressent à des publics plus spécifiques : public ayant peu ou pas accès au travail, ou de façon ponctuelle, primo-arrivants, public en insertion socio-professionnelle, étudiant.e.s, demandeurs d’emploi, personnes en réorientation professionnelle, public relevant du CPAS, public peu familier de l’art, public en formation, public sachant écrire et/ou sachant lire, public FLE ou alpha, public en burnout, public d’origines culturelle variées, personnes sans diplôme
Outil/Service en ligne
Téléchargez le recueil de témoignages : Ces métiers qui sont les notres -Temoignages-
Téléchargez le carnet d’exploitation pour groupes d’adultes : Ces métiers qui sont les notres -Carnet-

La collection Bilans de vies professionnelles se compose actuellement de 4 coffrets, dont le premier a été publié en 2021.
Les participant·es, avant de publier leurs livrets de témoignages, ont suivi un parcours quasiment identique chaque année. Ils et elles se sont raconté leur vocation, leur formation, leurs premiers pas, leurs erreurs et leurs victoires, la façon dont ils et elles ont – ou pas – réussi à concilier vie privée et vie professionnelle, leurs changements de trajectoire, comment les changements de management ou les évolutions technologiques ont impacté leur travail, la façon dont elles et ils ont appréhendé leur fin de carrière, le moment – inquiétant pour certain·es, enthousiasmant pour d’autres – où tout à coup a surgi le temps d’ « après » et ses longues plages de temps libres. Ils et elles se sont demandé ce qu’elles et ils avaient envie de faire ensuite.
Plus la collection s’étoffe, plus il y a de participant·es, et plus la publication a de sens, témoignant par exemple de l’évolution des mentalités par rapport à ces « seniors » devenus soi-disant « inactifs » mais soulevant également des questions telles celle du bénévolat et de sa place dans la société.
Bilans de vies professionnelles couvre actuellement un large panel de métiers : enseignant·e, assistant·e social·e, architecte, informaticien, statisticien·ne, comptable, camerawoman, bibliothécaire, secrétaire, syndicaliste, inspecteur social… Mais la collection raconte également des parcours bigarrés, de personnes qui, sans être capables de définir leur métier, en ont pratiqué des dizaines et se sont ainsi rendues essentielles à la société.
La collection Bilans de vies professionnelles peut donc se révéler utile à plusieurs catégories de gens : des personnes suivant un parcours de formation professionnelle, que ce soit dans un cadre d’études classiques (écoles supérieures ou universitaires) ou dans un cadre d’insertion socioprofessionnelle ; des personnes en reconversion professionnelle ; des personnes en burn out ; des personnes en thérapie, suite à des problèmes dans le domaine professionnel ; des personnes en transition entre la vie dite « active » et la pension…
Infos
Les coffrets Bilan de vies professionnelles 1, 2, 3 et 4 sont en vente à l’accueil du Musée bruxellois des industries et du travail (15€ par coffret)
Une fiche pédagogique contenant des pistes d’exploitation des coffrets pour les groupes d’adultes est disponible sur demande au Service éducation permanente – ep@lafonderie.be – 02 413 11 79 – 0499 134 955
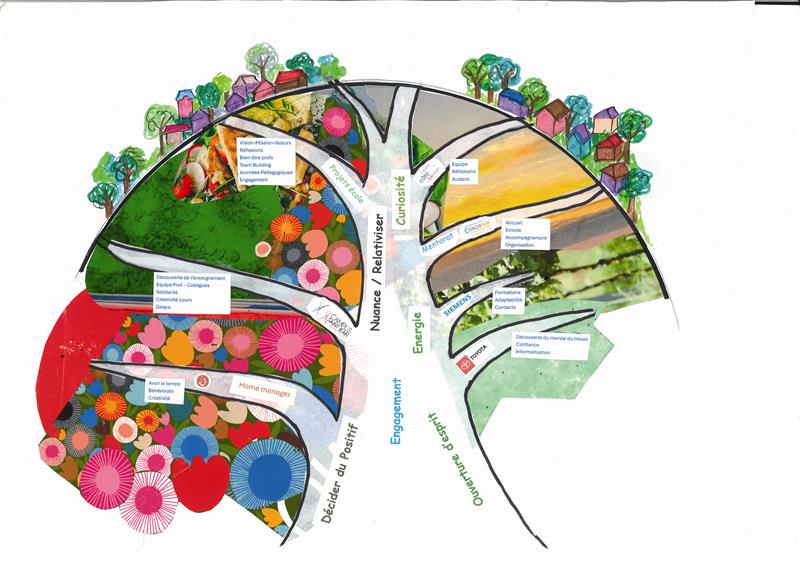
Année de création
2019 – toujours en cours…
Thématiques
Les thématiques sont différentes chaque année, en fonction des participants inscrits aux rencontres « Dis-moi ce que tu fais…»
Description de l’outil/du service
Le Dictionnaire subjectif du travail est un recueil de définitions élaborées à partir de témoignages individuels. Il assume son caractère subjectif.
Il traite notamment de structures, de compétences qui – selon les interlocuteurs – sont nécessaires pour effectuer un travail donné ; de ce qu’ils-elles font et qui ne fait pourtant pas partie de leurs profils de fonction ; ou encore de ce qui leur plaît le plus dans leur travail...
Objectif(s)
Faire connaître la grande diversité de types de travail et valoriser chacun d’eux. Témoigner du travail à notre époque.
Qui peut l’utiliser ?
Tous
Comment l’utiliser ?
Le Dictionnaire subjectif du travail parait en ligne, par tome (un par année). Chaque tome contient un sommaire (appellations des différents types de travail qu’on peut y trouver).
Outil en ligne
Téléchargez le tome 1 (2019)
Une fiche pédagogique contenant des pistes d’exploitation du dictionnaire pour les groupes d’adultes est disponible sur demande au Service éducation permanente – ep@lafonderie.be – 02 413 11 79
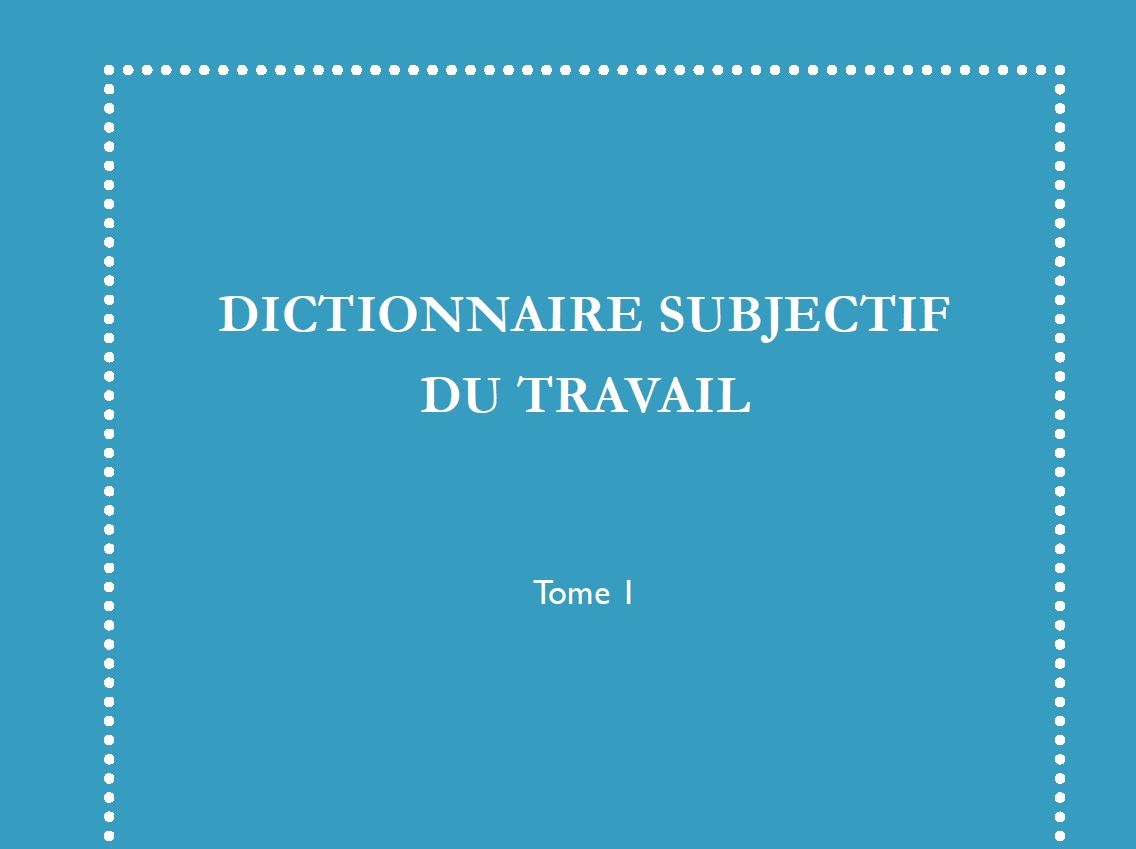
Année de création
2020
Thématiques
Évolution/bouleversement socio-économique, urbanisme, industries, Molenbeek, Bruxelles, bande dessinée, créativité
Description de l’outil / du service
Dennis Marien est auteur de bande dessinée et dirige une maison d’édition. Il est également formateur. Début 2019, il a animé un atelier BD pour La Fonderie et en a publié le résultat : La lessive du futur.
Dans le cadre de l’exposition “Au rivage de Bruxelles”, il a animé un nouvel atelier. Le sujet traité était les bouleversements socio-économico-urbanistiques du quartier de la Porte du Rivage. Chaque participant a réalisé quelques planches et pages de la BD Rivages.
Objectifs
Permettre au groupe de dessinateurs confirmés et amateurs de s’approprier une exposition de La Fonderie et d’exprimer leurs opinions sur le sujet qui y est abordé.
Publics
La publication s’adresse à un public adulte.
Comment utiliser la BD en tant qu’enseignant ou formateur ?
La BD est un support ludique pour aborder le thème des changements urbains, de la désindustrialisation et des transformations.
La publication est en vente au bookshop du musée bruxellois des industries et du travail, au prix de 6€
Une fiche pédagogique contenant des pistes d’exploitation de la publication pour les groupes d’adultes est disponible sur demande au Service éducation permanente – ep@lafonderie.be – 02 413 11 79
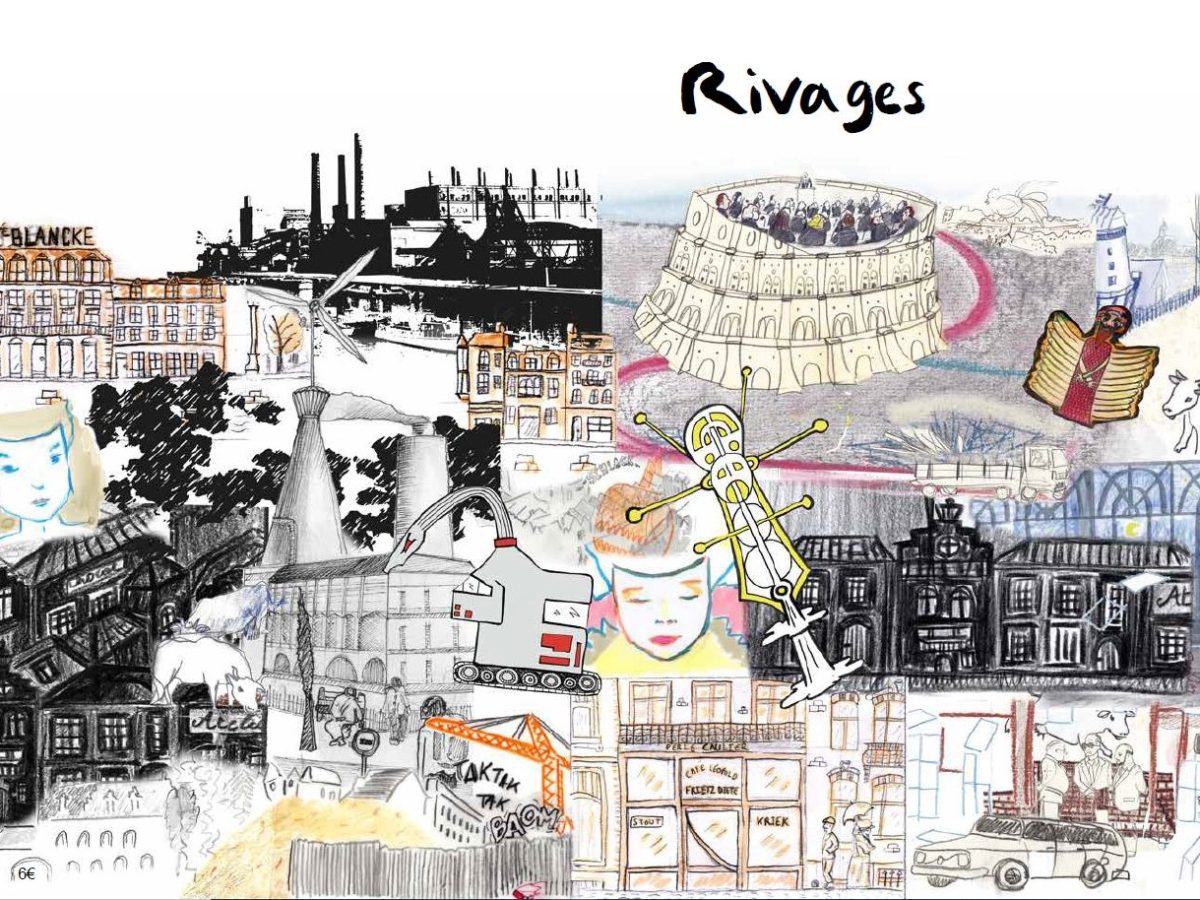
Année de production
2019-2020
Thématiques
bénévolat – travail et bien-être – environnement de travail – horaires de travail – métiers – métiers du futur – secteurs professionnels – travail au jardin – travail domestique – travail scolaire – maladies du travail – enfants au travail – chômage – lieux de travail – travail et Covid-19
Descriptif
Suite aux diverses sessions de l’atelier d’écriture « Une vie de labeur » , les participant.e.s ont désiré partager avec vous leurs productions : des textes qui parlent du travail.
Les exercices donnés à faire durant l’atelier d’écriture ont permis la production de textes aux thèmes et formes diverses, drôles ou profonds, légers ou bouleversants. On y parle aussi bien du facteur à vélo de notre enfance que du chercheur du futur, du travail de bureau à l’administration que du travail de vendeur en magasin…
Ces textes sont rassemblés dans un site internet consultable par tous, et une sélection de ces textes a été publiée sous la forme d’un petit livre illustré, disponible au prix de 7€ à l’accueil du Musée bruxellois des industries et du travail.
Objectif
Si vous désirez aborder le sujet du travail avec votre groupe, allez lire ces textes, piochez-y ceux qui vous intéressent et livrez-les au ressenti et à l’analyse de votre public.
Qui peut l’utiliser ?
Enseignants, formateurs et animateurs de groupes d’adultes francophones. Vous trouverez les textes classés sur le site internet selon deux types de classement :
Quant au livre, il présente également les consignes d’écriture, que vous pouvez à loisir reproduire avec vos participant.e.s dans vos locaux.
Outil en ligne
Accédez au site internet Une vie de labeur
Une fiche pédagogique contenant des pistes d’exploitation du site internet pour les groupes d’adultes est disponible sur demande au service éducation permanente – abrunelle@lafonderie.be – 0499 134 955.

Année de création
2019
Thématiques
Les thématiques sont différentes en fonction du quartier ciblé
Description du service
Le projet C’est dans la boîte ! se base sur les boîtes de documentation du centre de documentation de La Fonderie : des boîtes physiques ou virtuelles dans lesquelles les lecteurs peuvent trouver de la documentation sur un sujet précis (un quartier, le canal, l’électricité, l’eau dans la ville…). Nous proposons aux groupes en éducation permanente comme à d’autres types de groupes (collègues, comités de quartier…) qui le souhaiteraient de construire avec et pour nous une boîte de documentation sur la vie dans leur quartier. Ils seraient ainsi amenés à se former à l’utilisation du centre de documentation, à mener des enquêtes sur le terrain, à prendre images et sons en témoignage de la vie du quartier à un moment précis, à se découvrir experts sur un point de vue particulier…
Description de l’outil
Les boîtes de documentation ainsi créées seront versées dans les collections du centre de documentation.
Objectif(s)
L’objectif est double.
Pour le groupe, il s’agit de s’approprier son environnement immédiat pour mieux le comprendre et le maîtriser, développer un pouvoir d’action dans le quartier, agir collectivement pour s’approprier l’espace et les us et coutumes du lieu.
Pour le centre de documentation de La Fonderie, il s’agit d’élargir ses collections et de travailler sur le présent d’un quartier (en général, La Fonderie travaille surtout sur l’histoire passée de la ville). Il s’agit également d’élargir le cercle des lecteurs du centre doc et de former ceux-ci à son utilisation de façon collective.
Qui peut l’utiliser ?
Un groupe intéressé par la découverte de divers aspects de leur quartier : vie économique, politique, sociale, associative…
Avec quel type de public ?
Adultes parlant français
Comment l’utiliser ?
Un programme type est disponible sur demande auprès du Service éducation permanente – ep@lafonderie.be – 02 413 11 79
Concrètement, qu’est ce que cela peut donner ?
Vous trouverez un exemple d’une boite de documentation déjà réalisée en collaboration avec La Samaritaine (Marolles) sur un site dédié au projet. Pour le consulter, cliquez ici…

Année de création
2019 – 2020
Thématiques
Le travail bénévole ou rémunéré, domestique ou de bureau, à l’usine ou à l’atelier, intellectuel ou manuel…
Description de l’outil :
Objectif(s)
Faire connaître et valoriser un large panel de types de travail
Avec quel public l’utiliser ?
Les discussions sont accessibles à toute personne ou tout groupe de personnes comprenant le français, ou en apprentissage du français (oral ou écrit).
Une fiche pédagogique contenant des pistes d’exploitation des enregistrements pour les groupes d’adultes est disponible sur demande au Service éducation permanente – ep@lafonderie.be – 02 413 11 79

Année de création : 2019 (préparation de 2017 à 2019)
Thématiques : métiers – travail – déterminisme social – robotisation – travail des femmes – pénibilité au travail – salaires
Description du service
Après plus d’un an de rencontres, les membres du groupe ont souhaité élargir le débat à 3 types de publics : les écoles primaires et secondaires, les associations et le grand public.
Les 10, 11 et 12 octobre 2019, nous vous invitions à nous rejoindre pour débattre avec nous de toutes ces questions, sous la forme d’expositions et d’ateliers ludiques et interactifs.
Consultez le programme général que nous proposions aux différents publics : écoles, associations et grand public.
Objectif
Permettre à chacun.e de s’exprimer sur son métier, d’en savoir plus sur d’autres métiers, de réfléchir à ce que c’est qu’un métier, ce que signifie avoir un métier, et l’importance que ça a dans la vie de chacun.e.
Retrouvez le rapport final du projet sur le site internet de Ces métiers qui sont les nôtres.

Année de production 2019
Thématiques
salaires – inégalités salariales – mérite – métiers – travail
Descriptif
En sous-groupes, décidez de la stratégie à adopter et partagez l’enveloppe budgétaire entre les différents travailleurs. Ensuite, confrontez votre politique à celle des autres sous-groupes et débattez-en.
Objectif
Chaque participant à cet atelier apportera aux autres ses propres connaissances et compétences en matière de salaire. Chacun sera également amené à argumenter pour persuader les autres « joueurs » de le suivre dans sa politique de distribution des salaires. Ainsi, un débat naîtra spontanément mais la forme ludique de l’activité permettra d’éviter les tensions qui pourraient naître d’un tel débat.
La façon dont les participants s’informeront auprès des autres de la réalité des salaires leur permettra de mieux maîtriser leur environnement économique.
En fin d’atelier, l’animateur peut, s’il le souhaite et si les participants en émettent le désir, donner les salaires réels des métiers en présence dans l’atelier. Ainsi, chacun pourra confronter sa vision avec la réalité.
Outil
L’outil est disponible pour emprunt à La Fonderie.

Année de création
2018
Thématiques
Capsule LA FAMILLE : intergénérationnel, mariage, diversité religieuse et culturelle au sein de la famille, homosexualité, divorce, interculturalité.
Capsule ETRE D’ICI ET DE LA-BAS : déracinement, origines, démarches administratives, intégration, interculturalité, communautarisme, économie, racisme.
Capsule ETRE HOMME OU FEMME : violence intrafamiliale, stéréotypes, émancipation, polygamie, absence d’un parent, femmes et travail, femmes dans l’Eglise, travaux ménagers, mariage arrangé.
Capsule L’ECOLE : illettrisme, interculturalité, transport, mixité, langue des études, autorité, émancipation.
Capsule RELIGIONS, CROYANCES ET PHILOSOPHIES DE VIE : catholicisme, islam, athéisme, intolérance, mixité, port du voile, radicalisme.
Capsule LE TRAVAIL, ETRE UTILE A LA SOCIETE : travail dans les mines, âge et travail, travail au noir, pension, bénévolat, chômage, travail et migration, relations de travail, épanouissement au travail, émancipation.
Description de l’outil/du service
Pendant plusieurs mois, un groupe de 11 personnes s’est réuni à La Fonderie dans le cadre du projet “je raconte ma vie”. Elles se sont raconté leur vie en fonction de certaines thématiques prédéterminées. Ces rencontres se sont avérées particulièrement riches mais il ne s’agissait pas de débattre de questions de société mais bien de se raconter et ainsi mieux se connaître. Toutes ces discussions ont été enregistrées et retranscrites. De ces retranscriptions, nous avons tiré des citations dans le but de réaliser 6 capsules audio. Ces capsules servent à lancer ou alimenter des débats en groupes d’adultes.
Objectif
Fournir aux formateurs et animateurs de groupes d’éducation permanente de la matière à débattre sur les 6 sujets suivants : la famille ; être d’ici et de là-bas ; être homme ou femme ; l’école ; religions, croyances et philosophies de vie ; le travail, être utile à la société.
Qui peut les utiliser ?
Les formateurs, animateurs et enseignants travaillant avec des groupes d’adultes.
Avec quel type de public ?
Tout groupe sur le point de débattre d’un des 6 sujets précités.
Comment l’utiliser ?
Si vous travaillez l’un des sujets précités, et souhaitez entamer ou alimenter un débat sur ce sujet, faites écouter à votre auditoire la capsule s’y référant. Les citations qu’elle contient sont de nature à alimenter un débat.
Outil/Service en ligne
| La famille | |
| Être d’ici et de là-bas | |
| Être homme ou femme | |
| L’école | |
| Religions, croyances et philosophies | |
| Le travail, être utile à la société |
Merci à Michèle Piron (Ages et transmissions) d’avoir été à l’initiative du projet « Je raconte ma vie » sans lequel ces capsules n’auraient pas existé. Merci à Danielle, Elisabeth, Eva, Fatima, Habiba, Mariette, Meriem, Micheline, Mina, Mohamed et Philippe de nous avoir autorisés à les citer. Merci à Anne Brunelle (La Fonderie), Danielle Marion, Guy Raucq, Mohamed Lamine, et Sylvie Lefèbvre (La Fonderie) pour la sélection des extraits. Merci à Thibault Coeckelberghs (GSARA) pour l’enregistrement, et à Christiane Dampne pour le montage. Merci à Anne Brunelle (La Fonderie), Danièle Piette, Danielle Marion, Dominique Braeckman, Mohamed Lamine, Pascale Deberghe (La Fonderie), Pascal Majérus (La Fonderie) et Robin Pringels de nous avoir prêté leurs voix.
Année de création
2018
Thématiques
Description de l’outil/du service
De l’histoire de la Révolution Industrielle au dessin des plans d’un musée rêvé, ce dossier invite les groupes à aborder une série de questions, débats et ateliers en utilisant leurs savoirs propres comme base de travail.
Objectif
Faire émerger des groupes d’utilisateurs un savoir qu’ils seront ensuite amenés à partager et structurer. Aborder une série de questions de société à partir de l’exposition permanente du musée bruxellois des industries et du travail.
Public
Ce dossier s’adresse aux formateurs, enseignants et groupes d’adultes dans un cadre d’éducation permanente, de formation, d’études…
Comment l’utiliser ?
Le dossier liste et explique une série d’activités à mettre en place avant ou après la visite de l’exposition. Le temps de réalisation de ces activités peut varier entre deux heures et une année.
Outil/Service en ligne
| TÉLÉCHARGEZ LE DOSSIER |

Année de création
2018
Thématiques
Descriptif
L’exposition Temps de travail. Mesures et démesures s’est tenue à La Fonderie jusqu’en mars 2018. Depuis, elle est disponible à la location. Téléchargez ci-dessous le dossier descriptif de l’exposition.
Objectif(s)
Permettre aux animateurs et formateurs qui veulent emmener leur groupe visiter l’exposition de préparer la visite et d’y donner suite en centrant le propos sur les membres du groupe et en leur permettant de s’approprier le sujet en profondeur.
Qui peut l’utiliser ?
Les animateurs de groupes d’adultes en éducation permanente ou en alphabétisation
L’exposition et son exploitation sont particulièrement intéressantes pour les formateurs de délégués syndicaux
Les formateurs de groupes d’adultes en ISP
Les enseignants des universités et hautes écoles
Avec quel type de public ?
Les pistes d’exploitation sont suffisamment diversifiées pour être utilisables avec n’importe quel type de groupe parlant le français
Comment l’utiliser ?
Les activités sont souvent annoncées comme étant à organiser avant ou après la visite. Lorsque rien n’est annoncé, cela signifie que l’activité peut-être organisée indépendamment de la visite de l’exposition.
Le type d’activité est également annoncé en début de paragraphe (débat, animation, discussion, atelier, jeu de rôles…)
Enfin, d’autres outils (films, séries et livres) sont conseillés pour prolonger la réflexion.
Outil en ligne
Téléchargez le dossier descriptif de l’exposition
Téléchargez le dossier d’exploitation de l’exposition
Téléchargez le livret de textes de l’exposition
Année de création
2018
Thématiques
Description de l’outil/du service
Le dossier d’exploitation du parcours “Le petit Manchester” va pousser ses utilisateurs à structurer et partager leurs compétences et savoirs sur les thèmes abordés lors de la visite. De l’histoire de la Révolution Industrielle au dessin des frontières « rêvées » de leur commune, les groupes aborderont une série de questions, débats et ateliers en utilisant leurs savoirs propres comme base de travail.
Objectif
Faire émerger des groupes d’utilisateurs un savoir qu’ils seront ensuite amenés à partager et structurer. Aborder une série de questions de société en ayant pour support une visite guidée dans la ville.
Qui peut l’utiliser ?
Les formateurs, animateurs et enseignants
Avec quel type de public ?
Les groupes d’adultes dans un cadre d’éducation permanente, de formation, d’études…
Comment l’utiliser ?
Le document propose une série d’activités à mettre en place avant ou après avoir suivi le parcours. Le formateur, l’animateur ou l’enseignant choisira les activités à mettre en place en fonction de la nature de son groupe et du temps qu’il peut ou veut consacrer à l’exploitation de ce parcours.
Outil/Service en ligne
Téléchargez le dossier d’exploitation du parcours “Le petit Manchester”.
Année de création
2018
Thématiques
Histoire et avenir de l’évolution du temps de travail en Belgique, débats et projections.
Description de l’outil/du service
Synthèse des interviews et conférences réalisées et mises sur pied dans le cadre de l’exposition Temps de travail. Mesures et démesures à La Fonderie.
Objectif(s)
Permettre aux lecteurs d’appréhender et de comprendre les tenants et aboutissants de l’évolution du temps de travail en Belgique pour pouvoir se positionner sur les politiques et actions à venir.
Qui peut l’utiliser ?
Tout le monde
Avec quel type de public ?
Un public adulte alphabétisé
Comment l’utiliser ?
Les chapitres de cette publication sont les suivants :
Outil/Service en ligne
Téléchargez la publication Discours sur le temps de travail.
Année de création
2019
Thématiques
Santé communautaire, santé mentale, santé, vocation, relation au travail, utilité de la supervision, enseignement et formation, utilité des stages, théorie et pratique, bonnes et mauvaises pratiques,…
Description de l’outil
Dans le cadre de l’exposition itinérante Vivre: les métiers du social, 100 ans d’histoire et de formation, La Fonderie a organisé un groupe de parole sur ces métiers. Toutes les discussions de ce groupe ont été retranscrites. D’autres témoignages de travailleurs sont venus enrichir ce corpus.
Des membres du groupe de parole et des membres du personnel de La Fonderie ont collaboré à la rédaction d’un recueil de ces témoignages. La publication a été illustrée par une dessinatrice qui a suivi des professionnels dans le cadre de leur travail.
La publication est parue en décembre 2019.
Objectif
Qui peut l’utiliser ?
Les étudiants, enseignants, usagers et travailleurs dans les métiers du social.
Infos pratiques
Publication disponible à l’accueil de la Fonderie – musée bruxellois des industries et du travail
Une fiche pédagogique contenant des pistes d’exploitation de la publication pour les groupes d’adultes est disponible sur demande au Service éducation permanente – ep@lafonderie.be – 02 413 11 79
Année de création
2018
Thématiques
L’évolution du temps de travail en Belgique. Les combats sociaux, syndicaux. Les politiques liées au temps de travail.
Description de l’outil :
Le jeu “Ligne du temps de travail” permet aux animateurs et formateurs d’ancrer de façon ludique et interactive une ligne du temps de l’histoire du temps de travail chez les membres de leur groupe.
Objectif
Permettre aux animateurs et formateurs de donner suite à la visite de l’exposition Temps de travail, mesures et démesures de façon ludique et interactive. Les participants se familiarisent avec l’histoire du temps de travail au travers d’un jeu.
Qui peut l’utiliser ?
Avec quel type de public ?
N’importe quel groupe d’adultes parlant le français
Comment l’utiliser ?
Téléchargez le jeu La ligne du temps de travail. Un mode d’emploi accompagne le jeu.
Année de création
2018
Thématiques
Aux 19è et 20è siècles : la condition ouvrière, le chômage, les luttes et les acquis sociaux et syndicaux, les conditions de la vie quotidienne, la condition et le travail des femmes et des enfants, le suffrage universel
Description de l’outil
Montage vidéo de la conférence organisée conjointement par La Fonderie et Brussels Academy, qui s’est tenue au Musée bruxellois des industries et du travail le 21 octobre 2016, sur le thème de la condition ouvrière à Bruxelles au 19è et au début du 20è siècle. La conférence a été donnée par Florence Loriaux, historienne au CARHOP.
Objectif(s)
Cet outil est destiné à alimenter, documenter, et offrir un support médiatique à tout animateur ou formateur qui aborderait avec un groupe d’adultes l’une des thématiques développées ici.
Vous trouverez ici un document d’exploitation de la conférence.
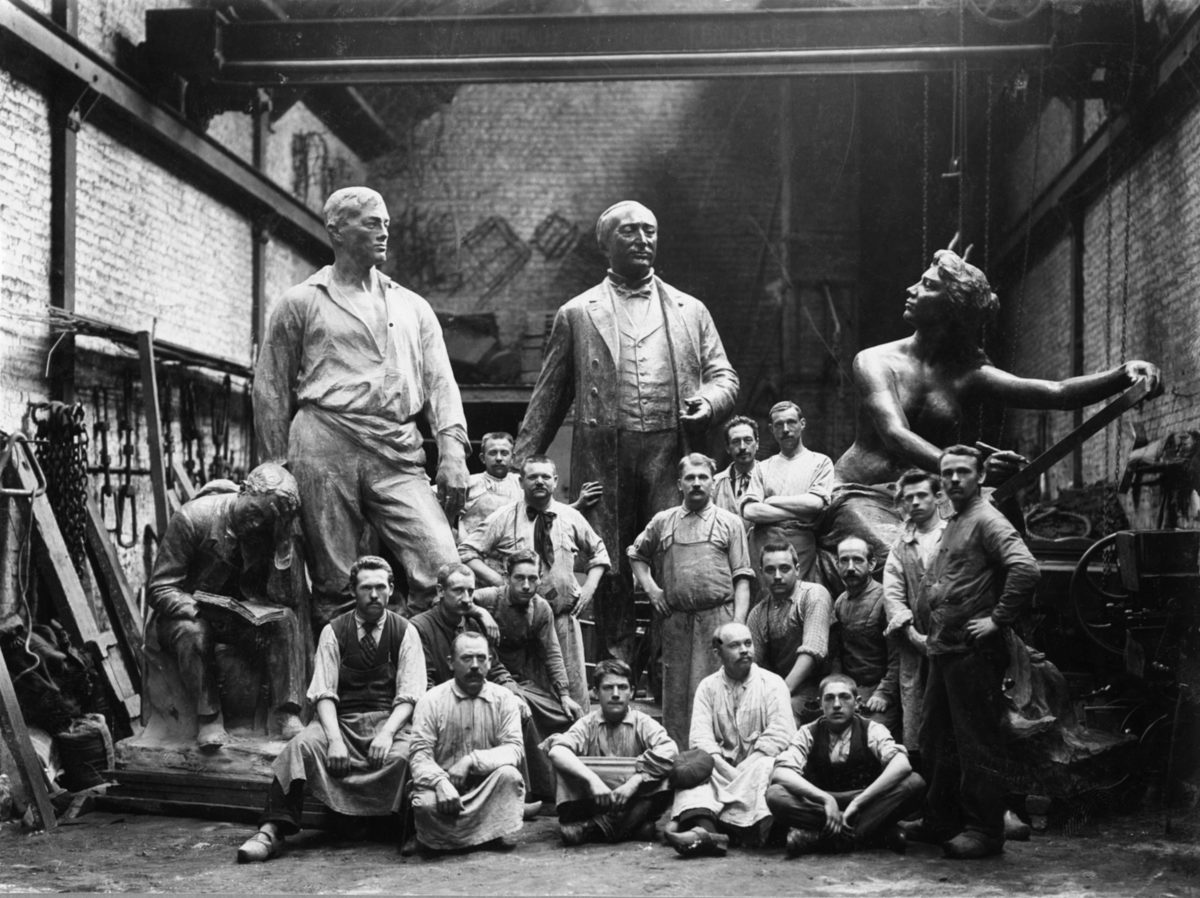
Année de création
2019 – 2020
Thématiques
Les thématiques sont différentes en fonction du quartier ciblé : urbanisme et architecture, maillage social, histoire socio-économique, culture et arts…
Description du service
Le projet “C’est dans la boîte!” se base sur les boîtes qu’on trouve dans tous les centres de documentation, notamment celui de La Fonderie. Ce sont des boîtes physiques ou virtuelles dans lesquelles les lecteurs peuvent trouver de la documentation sur un sujet précis (un quartier, le canal, l’électricité, l’eau dans la ville…).
Ici, la boîte n’a pas été constituée par des professionnels de l’histoire et du documentaire mais par des habitants et usagers du quartiers, experts dans certains domaines touchant à ce quartier pour l’expérimenter tous les jours.
Outil en ligne
Un site web “C’est dans la boîte” reprend les boîtes virtuelles ainsi qu’un journal qui expose les rencontres et étapes de chaque projet.
Actuellement, un premier groupe développe son projet “C’est dans la boîte !”. C’est le Comité culturel de la Samaritaine qui travaille sur le quartier des Marolles. La boîte sera disponible dès la fin de l’année 2020.
Année de réalisation
2017
Description de l’outil
Musée de proximité, La Fonderie propose une animation en soutien à tout projet, à destination d’un public de quartier, qui doit aider les habitants à mieux appréhender leur histoire. Ceci implique potentiellement diverses interventions :
Objectifs :
Avec quel type de public ?
Idéalement, un public d’adultes, écrivant et comprenant le français, personnes inactives, souvent isolées avec des problèmes de logement, de santé. Public fragilisé. Ils connaissent la ville mais ne la comprennent pas nécessairement.
Thématiques :
Outil/Service en ligne
Télécharger le document Connaître mon quartier.
Par ailleurs, La Fonderie met à votre disposition son personnel et son centre de documentation (bibliothèque, iconothèque, médiathèque) pour les recherches concernant l’histoire du quartier sur lequel vous souhaitez travailler.
À l’initiative de l’asbl La Fonderie et de l’antenne du Projet Lama, une première matinée d’échange, rassemblant plus de 60 personnes et 20 associations, a eu lieu à La Fonderie le 17 mai 2017.
Ce rapport a pour but de présenter le déroulé et les traces écrites de la rencontre et d’exposer les étapes-clés dans l’organisation de l’événement dans le cadre de l’axe 3.1 de l’éducation permanente. Il a été réalisé à l’intention des participants, des travailleurs du milieu socio-culturel et de toute personne souhaitant entreprendre une démarche similaire.
Téléchargez le rapport du forum Ransfort.
Année de création
2019
Thématiques
Description de l’outil
Les participants, au nombre de 6, ont été invités à réfléchir individuellement et collectivement à ce que serait la lessive dans le futur. Ils ont chacun choisi d’aborder l’une des trois sous-thématiques suivantes : la technique, la question du genre, les problématiques environnementales.
Les participants ont conçu un scénario et imaginé un ou plusieurs personnages. Ils ont ensuite été guidés par Dennis Marien dans la réalisation de leur BD.
Objectif(s)
La BD est en vente à l’accueil du musée à prix libre.
Une fiche pédagogique contenant des pistes d’exploitation de la publication pour les groupes d’adultes est disponible sur demande au Service éducation permanente – ep@lafonderie.be – 02 413 11 79
Que nous ayons un emploi ou que nous n’en ayons pas, que nous soyons jeunes ou que nous soyons âgés, que ce soit à l’école ou à l’usine, que ce soit par choix ou par nécessité… nous travaillons tous. Rejoignez-nous pour écrire votre métier.
Année de création
2019 – 2020
Thématiques
Travail, écriture, atelier
Description du projet
La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail s’intéresse à toutes les formes du travail. Nous vous proposons de nous rejoindre pour une série d’ateliers d’écriture. Nul besoin d’être un grand écrivain, un prof de français ou un petit génie de l’orthographe. L’envie d’écrire est la seule condition pour participer.
Venez écrire votre travail avec nous. Aidez-nous à documenter le monde du travail…
Le projet atelier d’écriture “Une vie de labeur” dispose de son propre site internet. Vous pouvez y retrouver des textes écrits par les participants. Consultez-le en cliquant ici…
Publics
A partir de 15 ans
Ateliers 2023
Atelier en soirées – de 18h30 à 20h30 :
jeudi 27 avril, jeudi 4 mai, lundi 8 mai, jeudi 11 mai, lundi 15 mai, lundi 22 mai, jeudi 25 mai, jeudi 1er juin, jeudi 8 juin. Participation demandée à au moins 6 soirées. 30€ pour les 9 soirées.
Contact et inscriptions
abrunelle@lafonderie.be – 02 413 11 85 – gsm 0499 134 955

 Une participante raconte un bout de chemin parcouru à travers un objet qui l’a particulièrement marquée.
Une participante raconte un bout de chemin parcouru à travers un objet qui l’a particulièrement marquée.
Le projet Bilan est un espace de rencontre pour jeunes pensionné·es de tous types de métiers. Les membres sont invités à se raconter leurs carrières professionnelles, leurs bonheurs et leurs déboires, leurs visions de leurs métiers, l’évolution de ces métiers et la place que leurs carrières leur a permis de prendre dans la société.
 Un exemple d’objet apporté par une participante.
Un exemple d’objet apporté par une participante.
De notre formation jusqu’à nos derniers jours de travail (rémunéré), nous développons une série de compétences et acquérons de l’expérience qui fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Quelle importance a eu mon travail dans ma vie ? Quelle place m’a-t-il permis de prendre au fil du temps ? Que referais-je aujourd’hui et que ne referais-je pas ? Au vu de ma carrière, comment puis-je encore être utile à la société ? Ai-je encore envie de jouer un rôle à l’avenir ?
Rejoindre le groupe de parole proposé par La Fonderie, c’est partager avec d’autres des questions fondamentales : quelle personne suis-je devenue après la relecture de ma vie professionnelle ? Qu’ai-je semé en moi et autour de moi ? Comment les témoignages des autres participants résonnent-ils ? Quel est mon désir pour le projet du reste de ma vie ? Sabine, 2023
Un de mes souhaits, en commençant ce groupe de parole, était de porter un regard moins sévère sur ma vie professionnelle, et sur la façon dont j’ai géré les choses. Par rapport au mois d’août, quand je me suis inscrite, je suis arrivée à un résultat plus que positif. Marie F, 2024
 Le projet “bilan de vie”, c’est aussi écouter les autres pour mieux comprendre ce qu’ils et elles ont vécu et vivent aujourd’hui.
Le projet “bilan de vie”, c’est aussi écouter les autres pour mieux comprendre ce qu’ils et elles ont vécu et vivent aujourd’hui.
De septembre à décembre 2025, le groupe de parole se réunira pour 12 rencontres. Celles-ci auront lieu les jeudis, de 10h à 12h30 :
15 janvier – rencontre 1 : je raconte ma vie professionnelle en quelques mots
22 janvier – rencontre 2 : mes besoins + mon passage à la retraite
5 février - rencontre 3 : ma vocation et ma formation
12 février – rencontre 4 : ma carrière et ses rebondissements
5 mars - rencontre 5 : évolution de mon métier
12 mars - rencontre 6 : illustrer ma carrière professionnelle
19 mars - rencontre 7 : comment mon métier m’a permis de prendre une place dans la société
26 mars – rencontre 8 : comment j’ai réussi – ou pas – à concilier vie privée et vie professionnelle
2 avril – rencontre 9 : comment j’ai transmis mes savoirs et compétences
23 avril – rencontre 10 : comment je vis ma retraite, que vais-je faire demain
21 mai – rencontre 11 : évaluation du groupe de parole et suite du projet
29 mai – rencontre 12 : rencontre avec les précédents participants au projet, suivie d’un repas

Année
2019 – 2021
Thématique : la ville en changement
Prendre conscience des réalités urbaines proches de soi permet à l’individu de mieux se situer socialement et engendre plus de maîtrise de son environnement.
Mieux maîtriser son environnement, c’est être en mesure d’exercer son pouvoir démocratique, de faire entendre sa voix, de se rassembler et de se concerter pour améliorer la ville pour ses habitants.
Outre ce parcours “clé sur porte” à commander à La Fonderie, nous proposerons également aux formateurs-trices une boîte à outils qui leur permettra soit de répéter les animations pensées pour notre groupe-test à Molenbeek, dans les mêmes quartiers ; soit d’adapter ces activités dans un autre quartier ou une autre commune bruxelloise.
Descriptif
Le projet est mené avec un groupe du Collectif alpha de Molenbeek, encadré par deux animatrices du Collectif et par La Fonderie. Il teste en ce moment une série d’activités interactives à la découverte de leur quartier : vieux Molenbeek, abords du canal…
Les activités que le groupe aura préférées, celles qui leur auront le plus apporté en termes de connaissances sur l’histoire de leurs quartiers, seront retenues pour construire un parcours-type. Ce parcours sera ensuite proposé aux groupes inscrits dans un processus en alphabétisation.
En outre, un “journal de bord” retrace tout le travail qui aura permis la création de ce parcours-type. Il sera mis à la disposition de toute association qui souhaiterait mettre sur pied le même type de projet.
Objectifs
Publics
Groupes en alphabétisation
Infos
Pour toute info, contactez le Service éducation permanente : ep@lafonderie.be – 02 413 11 79
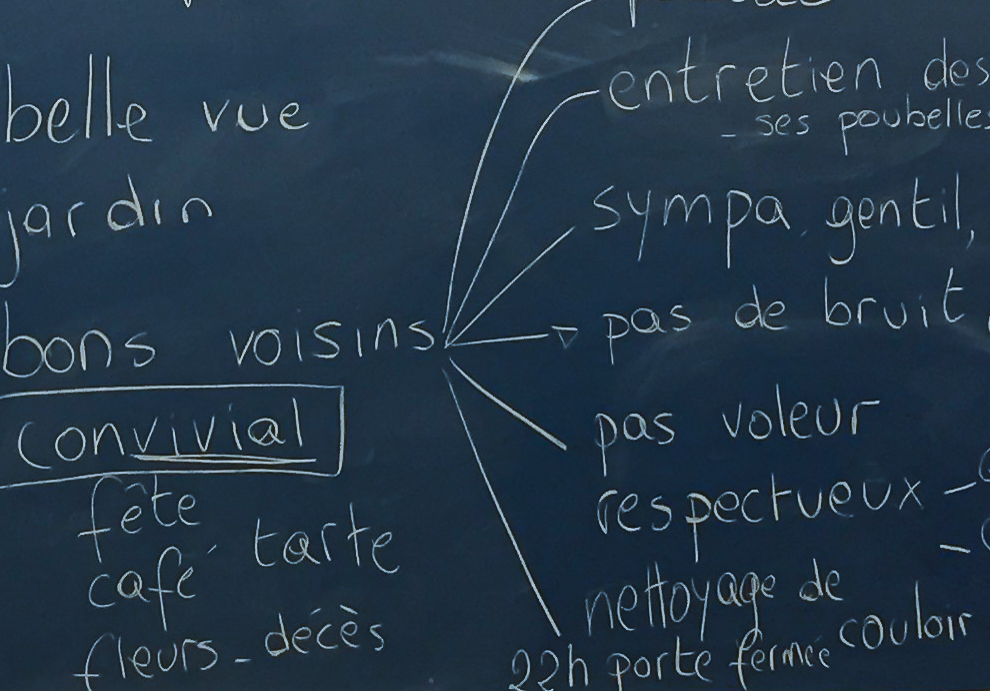
Année
2020
Thématiques
Il s’agit ici principalement du confinement et de la question des libertés : de mouvements, de rassemblement, de déplacement, de relations sociales…
Description du projet
Au début du confinement Covid-19, nous avons cherché un moyen de lancer un projet en éducation permanente en ligne, qui puisse éventuellement avoir des suites moins virtuelles. C’est ainsi qu’est né le site internet “L’intime confinement”. Chacun y présente la photo d’un objet accompagnée d’un texte expliquant en quoi cet objet a pris tant d’importance, à quoi il sert, d’où il vient… Le résultat est donc un site internet qui relate le confinement de plusieurs dizaines de personnes.
Dans un avenir que nous espérons proche, nous pourrions réunir les participant-e-s qui le souhaitent pour leur proposer de réfléchir ensemble à un événement autour de ce site, qui encouragerait la réflexion du grand public sur ce qu’a été le confinement pour nous, de son impact sur notre vie à ce moment-là mais également après, et de ce que l’on peut en tirer comme leçons pour l’avenir.
Objectifs
Publics
Tous
Infos pratiques
Accédez au site “L’intime confinement”. Lisez, participez, partagez…

L’exposition “Derrière le hublot, la lessive d’hier à demain”, est présentée à La Fonderie du 20 décembre 2020 au 22 aout 2021. Une animation de découverte est proposée pour les publics FLE (A1 et A2) et Alpha. Cette visite du musée aidera vos apprenants à mieux comprendre l’histoire de ce travail domestique tout en travaillant l’apprentissage de la langue (la description, les souvenirs, les verbes, les matières, le passé et le présent, …). Au moyen d’une pédagogie active et ludique, elle permet de travailler les quatre compétences de base (écoute, parole, lecture, écriture), en s’articulant autour d’objectifs linguistiques, discursifs et socio-culturels
Pourquoi le thème de la lessive ? Aujourd’hui, la lessive est une activité qui paraît anodine. Pourtant, elle nous concerne tous, peu importe notre milieu social ou nos origines. Omniprésente dans notre quotidien, elle renvoie à des évolutions techniques, culturelles, sociales et économiques.
Cette animation est en lien avec le dossier d’activités pédagogiques préparé spécialement autour de cette exposition par le Collectif Alpha et disponible gratuitement en cliquant sur ce lien.
Loin d’être un lieu ennuyeux, le musée propose des espaces dynamiques d’étude et d’émancipation. La Fonderie, musée bruxellois des industries et du travail, se veut un outil d’appui à l’apprentissage de la langue.
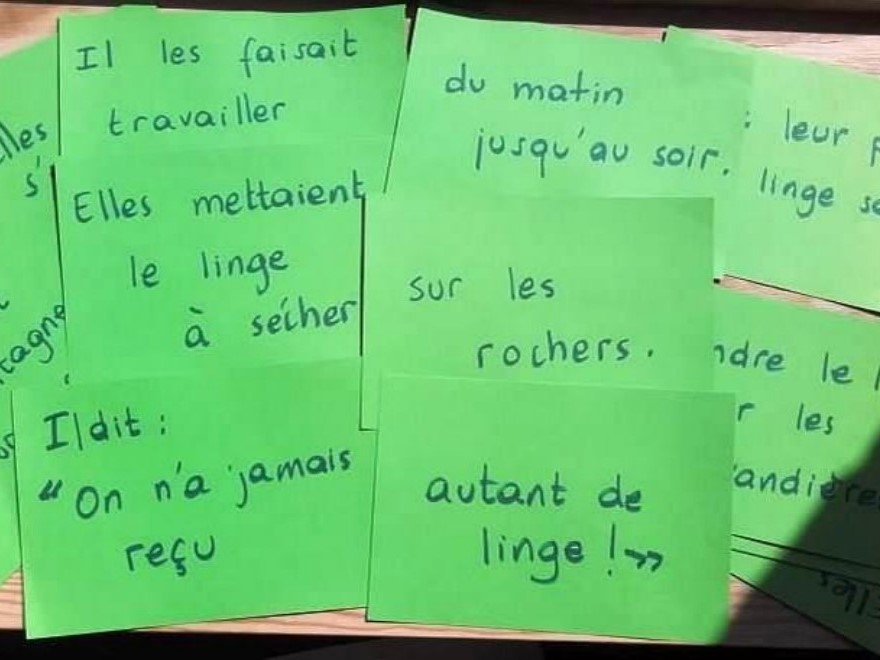
Enquête 01 : Comment lavait-on ses vêtements avant la machine à laver ?
Tu t’es déjà demandé comment on lavait ses vêtements avant l’invention de la machine à laver automatique ? Nora et Théo testent pour toi les plus extraordinaires outils et machines.
Enquête 02 : Comment blanchissait-on le linge avant les poudres à lessiver ?
Nora et Théo ont lessivé avec de l’eau et du savon râpé. Les poudres à lessiver que nous utilisons aujourd’hui n’ont pas toujours existé. Elles commencent à être utilisées après la Seconde Guerre mondiale. Mais comment obtenir un linge bien blanc sans poudre à lessiver ? Ce film montre le déroulement d’un jour de lessive dans les années 1930 à Rijssen (Pays-Bas).
Enquête 03 : Est-il dangereux de faire la lessive ?
Propose à ta grand-mère ou à une personne âgée de visionner ce film ensemble et de t’aider à répondre aux questions. Ces images filmées il y a 70 ans pourraient lui réveiller des souvenirs. Suis le petit garçon aux cheveux blonds !
Enquête 04 : Quand la lessive arrive sur le grand écran
Les frères Auguste et Louis Lumière sont deux ingénieurs français qui réalisent la première projection d’un film sur grand écran. Aujourd’hui, on les considère les inventeurs de la salle de cinéma. Ils sont également les réalisateurs du premier film publicitaire au monde. C’était pour le savon Sunlight en 1897.
Enquête 05 : Les tâches ménagères sont-elles plus partagées aujourd’hui ?
Cette campagne publicitaire a été réalisée par la marque Ariel en 2018 sous le slogan Partageons les tâches ! La lessive reste aujourd’hui l’un des derniers obstacles à lever, nous dit Ariel.
Le kit et le dossier pédagogique
Le kit comporte des objets et des documents historiques, un dossier pédagogique et des fiches d’exploitation. Ces éléments permettent d’explorer trois thématiques différentes afin de répondre aux questions suivantes :
Le public
Ce kit s’adresse aux classes de la 3ème jusqu’à la 6ème primaire.
L’enseignant peut l’exploiter dans le cadre de ses cours d’histoire et de sciences. Il peut s’en charger de façon entièrement autonome ou faire appel à La Fonderie pour animer le premier module “comment lavait-on ses vêtements avant la machine à laver ?”
Le déroulement
Les documents à télécharger
Le mode d’emploi du kit et du dossier
Le dossier pédagogique pour les élèves
Le labo de la lessive – expériences
Le labo de la lessive – dossier
Infos et réservations
Participation à une après-midi d’initiation. Gratuit. Réservation nécessaire. Maximum 4 personnes par séance.
Location du kit pendant 1 semaine : Gratuit.
Caution : 50 euros. Celle-ci vous sera rendue à la fin de la location.
1h d’animation en classe par La Fonderie (optionnel) : 50 euros
Pour toute question et pour les réservations, adressez vous à Luiza Mitrache – Chargée du service éducatif – lmitrache@lafonderie.be – 02 413 11 78.
Le kit et le dossier pédagogique “Derrière le hublot” ont pu être réalisés grâce au soutien d’Innoviris.
Cinq enquêtes complémentaires à réaliser en classe ou chez soi vous sont proposées. Elles sont assorties de vidéos. Vous les retrouverez toutes sur la page des enquêtes pour prolonger l’expérience pédagogique “derrière le hublot”.

Descriptif
On commence par arpenter le site de l’ancienne Compagnie des bronzes, véritable entreprise entre art et technique, installée dans le petit Manchester d’une jeune Belgique qui, dès les années 1840, est à la pointe de la Révolution industrielle. On explore ensuite, à travers les objets et machines de l’exposition permanente, l’évolution du travail et des industries à Bruxelles au cours des 19e et 20e siècle.
A travers des focus sur le métal, le bois, le textile et l’alimentation ; la découverte active de l’exposition amène à comprendre comment la machine comme outil de travail a amené une nouvelle structure de production, l’usine ; et un nouveau statut, l’ouvrier, qu’à l’époque aucune législation sociale ne protège. Les postes de travail y sont définis par rapport à l’ensemble de la fabrication du produit, sans relâche et à la chaine.
A destination du cycle supérieur de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire
Objectifs
Comprendre la révolution industrielle et les principaux changements sociaux et économiques qu’elle a entrainés dans notre société.
Parmi les thèmes abordés : la machine à vapeur, la mécanisation, la standardisation, l’efficacité, les changements de la ville liés aux implantations industrielles, le travail des enfants et les conditions de travail en général.
Plusieurs possibilités
* Visite animée, avec manipulation d’objets et mise en fonctionnement d’une machine à vapeur miniature (ou visionnement d’un extrait d’un film se déroulant dans une usine au 19es) ;
* Visite animée avec exploration technique en guise d’expérience du travail en usine au 19es, via la (re)construction d’une petite machine ;
* Visite guidée du site et de l’exposition permanente.

Quel est le processus technique derrière les nombreux objets métalliques dont nous sommes coutumiers ? L’atelier permet de mettre plus particulièrement le doigt sur le processus de la fonte au sable qui tire parti de la malléabilité de celui-ci pour réaliser un moulage à partir de l’empreinte d’un modèle en plâtre. Après avoir fortement tassé un sable fin et gras autour du modèle placé dans un châssis métallique, on retourne le châssis et retire le plâtre… Ensuite, c’est la dextérité de l’artisan, la précision de l’orfèvre et la sensibilité de l’artiste qui amènent chacun à tracer en deux ou trois dimensions, les motifs qui caractériseront son moule. A proximité de l’impressionnante ancienne halle de coulée de la Fonderie, les participants assisteront ensuite à la coulée du métal dans leurs moules. Chacun repart avec son objet en aluminium.
Atelier à destination du cycle supérieur de l’enseignement fondamental
Objectifs
Découverte et application rigoureuse des différentes étapes techniques de la fonte au sable ;
Exploration de la matière, aptitudes créatives, concentration et imagination ;
Mise en contexte historique dans le cadre de l’ancienne fonderie d’art de La Compagnie des Bronzes.

De décembre 2020 à octobre 2021, La Fonderie accueille Saskia De Kinder en résidence d’artiste. Elle est designer textile. Ensemble, nous souhaitons sensibiliser le public bruxellois au patrimoine matériel et au savoir-faire artisanal lié au design textile d’hier et d’aujourd’hui.
Nous vous proposons des ateliers d’initiation avec Saskia lors duquel chaque participant apprend d’abord les techniques de base de la tapisserie sur cadre. Ensuite, il tisse une petite toile qu’il emporte à la maison.
Vous êtes un accompagnateur de groupe en formation ou un particulier ? Vous souhaitez découvrir le tissage manuel avec vos proches ? Réservez un atelier d’initiation !

Descriptif
La plupart des machines et petits appareils qui nous entourent fonctionnent grâce à des mécanismes. Sans eux, que les machines transmettent ou transforment le mouvement, la plupart ne serait d’aucune utilité, malgré toute l’énergie déployée. Engrenages, bielle-manivelle, pignon-crémaillère, poulie et courroie, chaîne et roue dentée… Comment fonctionnent ces mécanismes et à quoi servent-ils exactement ? Nous en proposons une découverte à la fois concrète et intuitive qui associe la manipulation à l’observation et l’explication historique.
A destination du cycle supérieur de l’enseignement fondamental
Objectifs
Différenciation, à partir d’objets familiers, des mécanismes de transformation et de transmission du mouvement ;
Découverte des différents mécanismes à travers les machines du Musée et expériences autour des engrenages ;
Sensibilisation à l’histoire des sciences et des techniques dans un contexte industriel ;
Sensibilisation à l’évolution des techniques et des sciences.
Déroulement
Introduction au milieu des machines en extérieur ;
Identification des différents types de mécanismes : bielle-manivelle, poulie et courroie, vis-crémaillère, arbre à cames, engrenage, chaîne et roue dentée ;
Démonstration des différents mécanismes ;
Travail pratique sur les engrenages ;
Jeu dans le musée pour retrouver les machines.

Descriptif
En nous fournissant chaleur, lumière et confort matériel, toute notre vie est régie par différentes formes d’énergies. La gestion des énergies est encore l’une de nos préoccupations majeures, malgré la maîtrise grandissante des techniques. Mais que sont ces énergies et d’où viennent-elles ? Au moyen de maquettes et de jeux, les enfants sont amenés à découvrir les différentes sources et formes d’énergies… Ils découvrent le fonctionnement de quelques machines élémentaires, dont le moulin à eau ou la machine à vapeur ; autant d’inventions incontournables qui façonnent encore les modes de vie actuels.
A destination du cycle supérieur de l’enseignement fondamental
Objectifs
Découverte des différentes formes d’énergies et de leur utilisation au cours du temps ;
Approche des machines élémentaires et de leur fonctionnement de base ;
Observation et expression autour des résultats des observations ;
Apprentissage d’un vocabulaire technique spécifique ;
Sensibilisation à l’histoire des sciences et des techniques dans un contexte industriel.
Déroulement
Présentation de la Fonderie et des machines ;
Apprentissage et classement des sources d’énergie ;
Démonstration du fonctionnement d’un moulin à eau et d’une machine à vapeur ;
Sensibilisation à la consommation d’énergie et au développement durable.

Toute machine complexe est la somme de mécanismes simples. Les élèves s’inspirent des machines de notre exposition pour construire leurs propres vis d’Archimède. C’est une machine capable de monter des billes d’un point A vers un point B, sans les toucher directement. Cette animation constitue une approche ludique de la technologie, des maths, des sciences et de l’histoire.
Objectifs
Déroulement

Les céréales sont à la base de notre alimentation. Les participants apprivoisent le blé, le maïs, le mil et le riz. Ils expérimentent la fermentation et la production de farine avec un pilon et un mortier. Ils réalisent une recette à base de chacune de ces quatre céréales.
Objectifs
Déroulement

Quels sont les enjeux du recyclage aujourd’hui ? Pour le comprendre, les participants se mettent dans la peau d’un scientifique et d’un ferrailleur. Ils se rendent compte que le tri est écologique et qu’il permet de créer de la valeur marchande. Les élèves explorent les enjeux du recyclage et apprennent à reconnaître les métaux les plus utilisés de nos jours.
Objectifs
Déroulement
Notre musée possède bon nombre de modèles en plâtre qui ont servi à la réalisation de chefs d’oeuvre en bronze. Le plâtre est un matériau simple à travailler et permet de faire des miracles en peu de temps. Pendant l’atelier, les enfants le travaillent à la manière d’un mouleur du temps de la Compagnie des bronzes.
Objectifs
A travers une activité manuelle, ludique et créative, l’atelier a pour but de sensibiliser les enfants à un savoir-faire artisanal.
Déroulement
Au départ d’un jeu, les enfants appréhendent le rôle du plâtre dans la fabrication d’une statue en bronze. Ensuite ils s’initient à la réalisation d’un modèle de fonderie, du modelage jusqu’au moulage.
Tout métal a un pouvoir magique et il suffit d’un geste pour le maîtriser ! Le repoussé est une technique de travail à froid du métal. Elle est employée en orfèvrerie depuis l’Antiquité. L’apprenti orfèvre travaille la feuille de métal à l’envers à l’aide de divers outils en métal ou en bois. Il fait ainsi ressortir une image ou un ornement.
Objectifs
A travers une activité manuelle, ludique et créative, l’atelier a pour but de sensibiliser les enfants à un savoir-faire artisanal.
Déroulement
Pendant cet atelier, les enfants réalisent et décorent des bijoux, des masques et des frises en aluminium cuivré qu’ils emportent à la maison.
Comprendre la ville est indispensable pour pouvoir y jouer un rôle. Armés d’appareils photos, les jeunes partent à la recherche des traces du passé. En comparant leurs clichés et d’anciennes cartes postales ils appréhendent des problématiques telles que le logement et l’environnement de travail. Adapté à chaque niveau d’enseignement, cet atelier permet aux élèves de développer un regard critique et d’apprendre à se positionner en tant que citoyen.
Objectifs
Déroulement
Développement industriel, migrations, urbanisme : Molenbeek-Saint-Jean a connu une évolution bouillonnante au cours du 19ème et du 20ème siècle. Pour comprendre le processus de constitution d’un habitat urbain, les élèves se familiarisent avec les toponymes, décalquent des cartes anciennes de Bruxelles et construisent une maquette de la commune.
Objectifs
Déroulement
Secteur primaire, secondaire ou tertiaire ? Grâce à un travail de cartographie de l’activité économique d’un secteur de la ville, les participants revisitent les principes de base de l’économie urbaine.
Objectifs
Déroulement
Immergez-vous…
Remplir un verre d’eau, prendre une douche ou tirer la chasse… Ces gestes simples sont aujourd’hui tellement évidents que « nous n’y pensons même pas ». Cette exposition vous emmène à la découverte de tout ce qu’il a fallu pour que nous n’y pensions plus et, justement, vous y fait « (re-)penser » !
Remontant le temps, elle retrace les pratiques bruxelloises d’approvisionnement en eau aux périodes anciennes. Elle décrit les travaux colossaux entrepris aux 19e et 20e siècles pour abreuver la ville ainsi que les disputes politiques et les découvertes scientifiques qui les ont accompagnés.
Elle raconte aussi tout ce qu’il a fallu de transformations de nos rapports à l’eau, au corps et à l’hygiène à travers l’histoire des bains publics et de la salle de bain.
Elle rappelle également que le rejet des eaux usées, chargées d’excréments, directement dans des rivières transformées en égouts, n’a pas toujours existé. D’ailleurs, à Bruxelles, il a fallu longtemps avant de voir construire des stations d’épuration (au début du 21e siècle) et on vous raconte pourquoi.
Surtout, l’exposition montre comment le réseau d’approvisionnement et d’évacuation des eaux de Bruxelles ne fonctionne que grâce au travail quotidien et engagé de centaines de personnes : du chimiste au goûteur d’eau, en passant par le fontainier et l’égoutier.
En d’autres mots, l’exposition cherche à rendre visible l’épaisseur du temps qui coule dans les tuyaux, l’histoire longue et multidimensionnelle dont ils sont le produit et le travail quotidien qui rend possibles les usages que nous faisons aujourd’hui de l’eau.
Loin de se contenter de décrire le passé, l’exposition cherche à tisser des liens avec les questions contemporaines. En ville, de plus en plus de personnes n’ont plus un accès facile à l’eau. Le dérèglement climatique nous pousse à remettre profondément en question notre rapport aux ressources. Les pollutions se diversifient et posent de nouveaux problèmes ou défis. Pour mieux y penser, nous vous proposons plusieurs espaces de « décantation ».
L’exposition s’adresse aux adultes et aux enfants (dès 5 ans). Elle se veut immersive avec des vidéos, des témoignages sonores, des expériences sensorielles et ludiques.
Visites guidées
Dès février, des visites guidées sont organisées tous les premiers dimanches du mois à 15h. Durée : 1h30.
Vous pouvez également réserver une visite guidée privée à une date de votre choix pour un groupe de maximum 15 personnes. Tarif : 110 – 130 euros. Infos et réservation : parcours(at)lafonderie.be
Autour de l’exposition, découvrez…
Infos pratiques
Oh ! Ça ne coule pas de source est à voir à La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail – du 15 octobre 2021 au 26 juin 2022.
Trouvez toutes les infos pratiques relatives au musée (adresse, tarifs, heures d’ouvertures, contacts…) en cliquant ici.
Merci à nos partenaires
Cette exposition est le fruit d’un partenariat entre La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail –, le Laboratoire interdisciplinaire en Études urbaines de l’Université Libre de Bruxelles et VIVAQUA qui y participe dans le cadre de ses 130 ans.

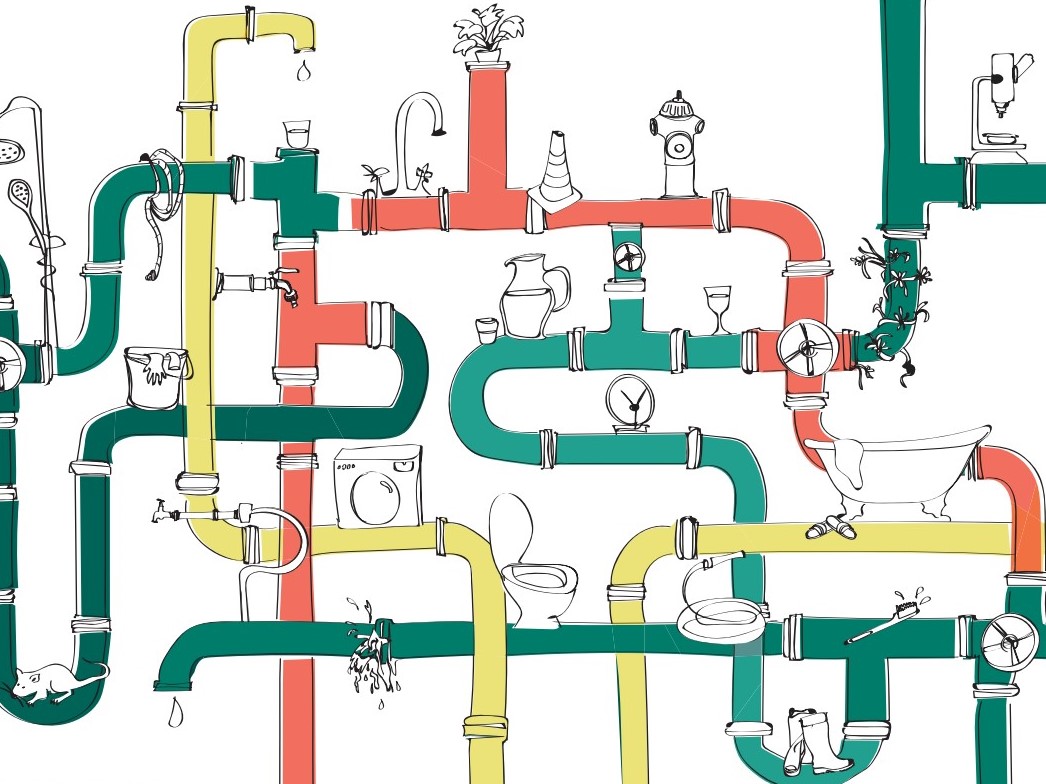
L’exposition est prolongée jusqu’au 22 août 2021.
Aujourd’hui, la lessive est une activité qui nous paraît anodine. Dans cette exposition, on vous démontre qu’elle est en réalité omniprésente dans notre quotidien et éminemment représentative des évolutions techniques, culturelles, sociales et économiques de notre société.
L’exposition aborde le sujet de la lessive au travers de registres thématiques larges et variés : la sociologie, l’histoire des techniques et de la chimie, l’industrie et le commerce, l’hygiène, la condition féminine, la distribution de l’eau, la gestion des ménages, l’environnement, les mentalités et les pratiques, l’histoire de la lessive à Bruxelles, la littérature ou encore la peinture.
L’exposition est richement documentée. Elle présente nombre de machines à laver, ustensiles, des produits de lessive, documents originaux et reproductions, films, témoignages… Les visiteurs sont invités à manipuler les machines ou encore à réaliser des expériences instructives et ludiques.
La Fonderie propose en parallèle une programmation culturelle variée sur la lessive : conférences, projection de films, journées des familles ou encore des ateliers de lessive à l’ancienne… Vous les retrouverez dans nos événements et dans notre agenda.
Découvrez la lessive au travers de ses nombreuses dimensions et questionnez votre rapport à ses enjeux. Vous ne verrez plus jamais une machine à laver de la même manière après votre visite de l’exposition Derrière le hublot. La lessive d’hier à demain.
Vous trouverez notre dossier de presse, notre communiqué de presse, notre affiche et quelques images à télécharger en cliquant ici.
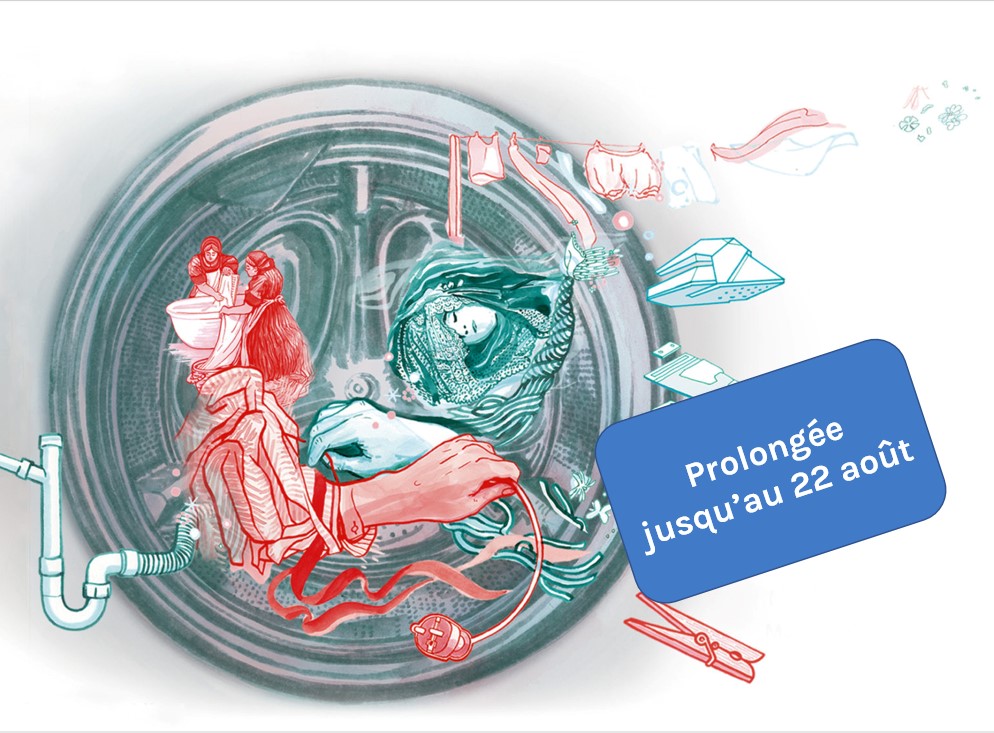
L’exposition Au rivage de Bruxelles retrace les mutations du quartier entourant l’ancienne Porte du Rivage, jadis installée à l’emplacement de l’actuelle place de l’Yser. Les documents et photos, d’hier et d’aujourd’hui, révèlent un riche passé industriel, un monde pratiquement disparu qui interpelle les aficionados de l’histoire et du patrimoine bruxellois.
En 1991, les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française rejoignent leur nouveau siège sur le boulevard Léopold II. Parmi eux, Pierre Wanlin constate avec dépit que le nouvel immeuble a supplanté les bâtiments industriels de la grande menuiserie et entreprise générale de construction De Waele, présente dans le quartier pendant près de 100 ans. Dans la foulée, d’autres ensembles de bureaux sont encore construits et balayent peu à peu la mémoire de ce quartier à la fois bourgeois, industriel et populaire.
Peu avant son départ à la pension en 2018, Pierre Wanlin effectue un gigantesque travail de mémoire sur ce quartier de Molenbeek-Saint-Jean. Il en tire une exposition dont la présentation s’imposait naturellement à La Fonderie.
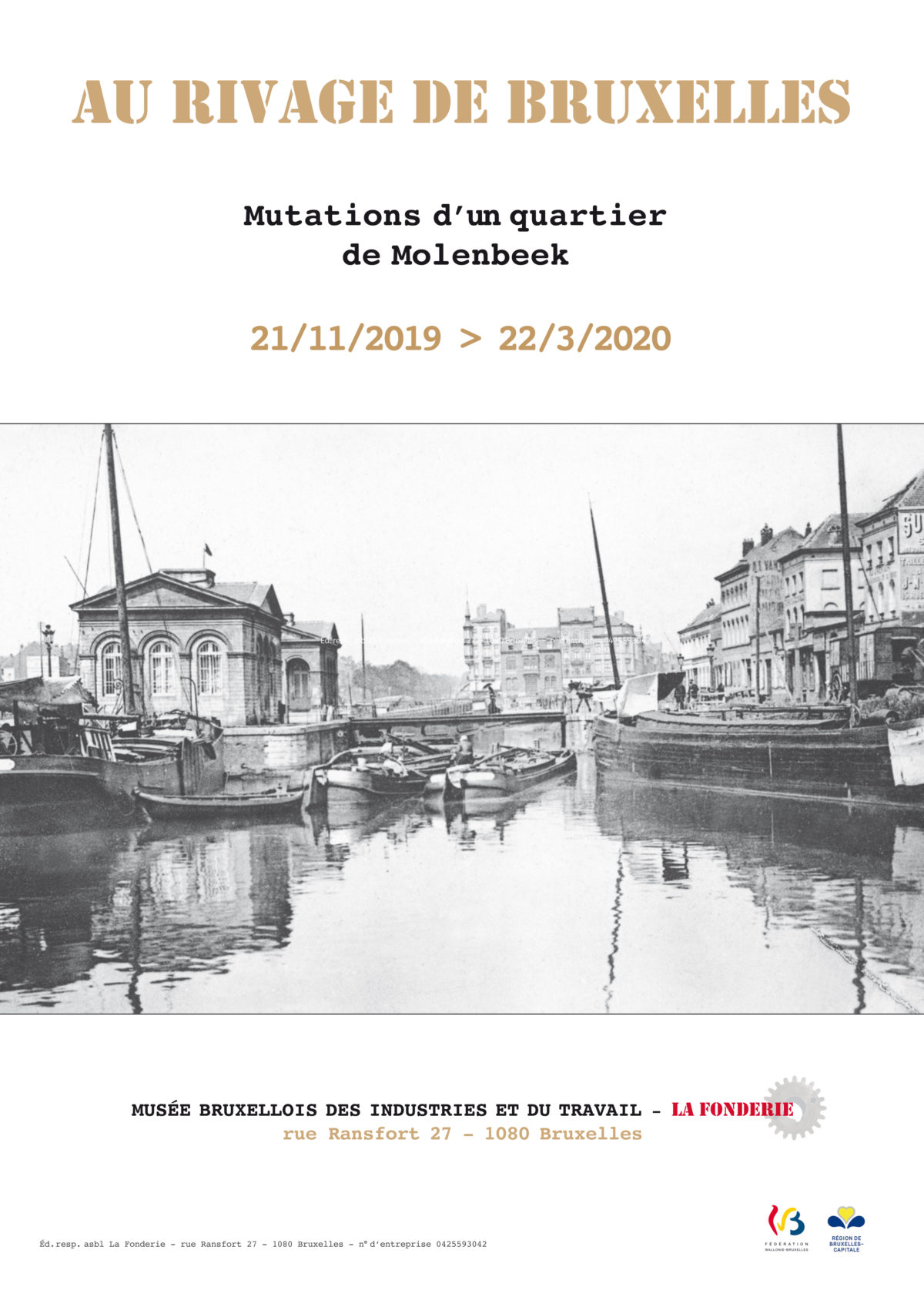
À l’été 2019, La Fonderie ouvrait une exposition du travail photographique de Patrice Niset*1. Ce dernier part à la rencontre d’hommes et de femmes au travail, entre dans leurs ateliers, capte les gestes mille fois répétés. Pour l’exposition La Gueule de l’Emploi, il a saisi le travail manuel et artisanal tel qu’il perdure et se renouvelle à Bruxelles. Ses clichés révèlent comment les artisans et créateurs intègrent de nouveaux outils et techniques aux savoir-faire passés. Dans l’espace public, son objectif s’est posé sur les travailleurs anonymes qui contribuent à l’intérêt collectif et assurent la bonne marche de la cité.
Les photographies de Patrice Niset font surgir les “gueules”, les gestes et les univers de ces artisans et travailleurs qui participent au dynamisme de Bruxelles. Exposées en extérieur sur le site de l’ancienne fonderie de la Compagnie des Bronzes, elles étaient comme un écho contemporain aux métiers manuels qui y furent exercés jadis.

Une superbe exposition produite pas la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège : Vies de zinc
Cette exposition invite à découvrir l’atmosphère et la vie des ouvriers du zinc au travers de textes, outils, objets, photos, …
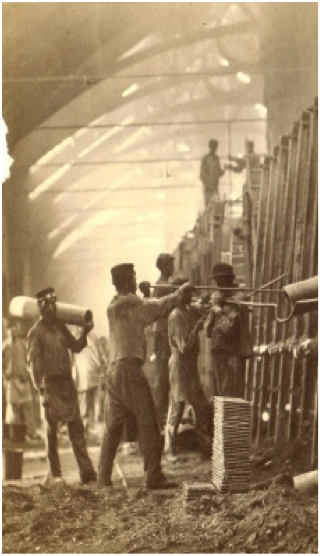
Suivant une démarche exceptionnelle pour l’époque (1868), Louis-Alexandre Saint-Paul de Sinçay, directeur général de la Société des mines et des fonderies de zinc de la Vieille-Montagne, commande trois albums photographiques (trois albums lui sont dédiés et portent son monogramme), dont deux sont aujourd’hui classés trésors du patrimoine mobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces albums de société rassemblent des photographies d’ouvriers et d’employés des différents sites de la Vieille-Montagne (en Belgique, France, Prusse,…), posant avec leurs habits et outils de travail. Cette demarche témoigne d’une véritable culture d’entreprise.
De portrait en portrait, le visiteur découvre ces travailleurs du zinc d’hier et leur rôle dans le processus technologique. Mais l’exposition aborde également le travail du zinc dans les usines d’aujourd’hui.
L’extraction du zinc concerne peu la région bruxelloise, mais notre angle d’approche est délibérément tourné vers la représentation photographique de l’ouvrier. Notre programmation d’activités en lien avec l’exposition et nos activités pédagogiques reflètent cette thématique.
.
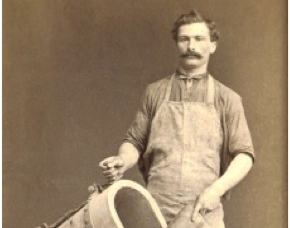
Le débat autour de la réduction collective du temps de travail a repris le devant de la scène. Face à la crise et au chômage, le partage du travail serait-il une solution ? Une piste en contradiction avec les “lois travail” européennes mises en place pour plus de flexibilité et de compétitivité.
En près de 150 ans, nous travaillons en moyenne deux fois moins. Mais la réduction collective du temps de travail, moteur de l’émancipation des travailleurs et du progrès social et économique, connaît un ralentissement et même une tendance inverse. Nos temps de travail se diversifient de plus en plus, sans améliorer pour autant nos conditions de travail : flexibilités non choisies, rythmes accélérés, porosité entre la vie professionnelle et la vie privée, nouvelles maladies professionnelles, partage inégal du travail…
Et dans le futur, combien de temps travaillerons nous ? L’intelligence artificielle, la numérisation, la robotisation accroîtront-elles notre temps de loisirs ou effaceront elles de plus en plus la frontière entre le temps privé et le temps professionnel ?… En 1930, l’économiste John Maynard Keynes préconisait la semaine de 15 heures, qu’il envisageait pour 2030. L’avenir lui donnera-t-il raison ?
L’exposition Temps de travail. Mesures et démesures est disponible à la location. Téléchargez le dossier descriptif de l’exposition itinérante.
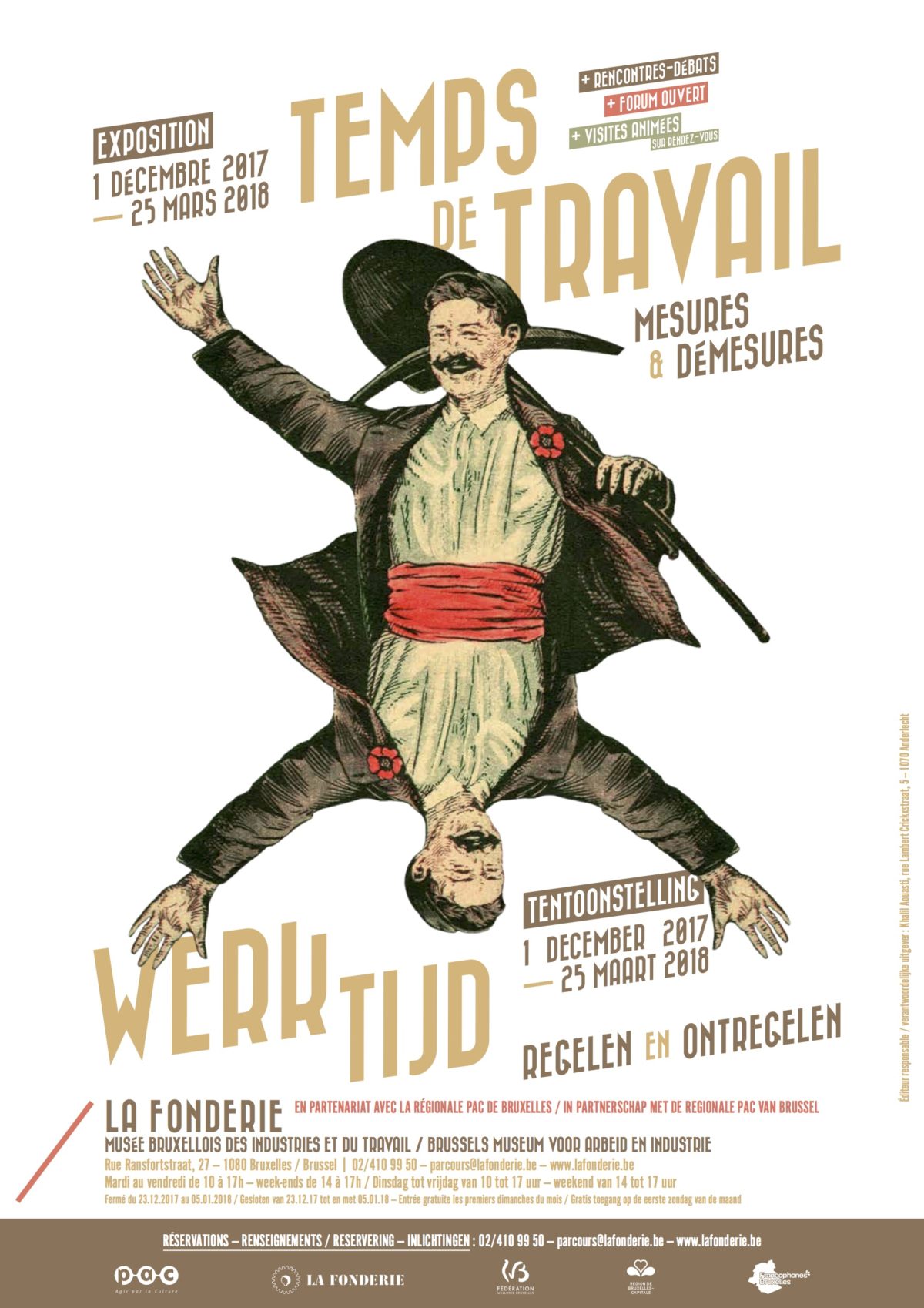
Les photographes du collectif sont partis à leur rencontre “là-bas” dans les camps de réfugiés au Liban, en Jordanie, mais aussi “ici” en France et en Belgique. À Calais, ils ont documenté leur vie quotidienne dans la jungle. En Belgique, ils ont sillonné la côte et ont suivi quelques-uns des plus jeunes d’entre eux occupés à reconstruire leur vie, faisant preuve d’une détermination qui force le respect.
#JeSuisHumain, c’est un regard sur le drame humain de ce parcours migratoire, sur la résilience de ces réfugiés et demandeurs d’asile. C’est cette capacité à surmonter les moments douloureux de l’existence et à se développer en dépit de l’adversité qui est mise en valeur.
En présentant ce reportage, le collectif Huma et Amnesty International veulent créer des ponts entre le public belge et ces hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui vivent “chez nous”. Ils cherchent à les présenter non pas comme des victimes, mais comme des acteurs de leur propre vie.
L’exposition à La Fonderie
Les vagues de migrations successives font partie des réalités sociales, économiques et culturelles qui ont transformé et transforment Bruxelles. Aujourd’hui, la capitale compte plus de 170 nationalités. Depuis sa création, La Fonderie s’est régulièrement attachée à éclairer et faire comprendre l’histoire de l’immigration à Bruxelles, notamment au travers du prisme de l’histoire socioéconomique et de l’intégration des populations migrantes dans le monde du travail.
En accueillant l’exposition #JeSuisHumain d’Amnesty, La Fonderie veut mettre cette histoire en résonnance avec la crise migratoire de ces dernières années, combattre la peur de l’autre et contribuer à déconstruire les préjugés sur les migrants.
Avec la collaboration du collectif Huma, La Libre Belgique, et Amnesty International.
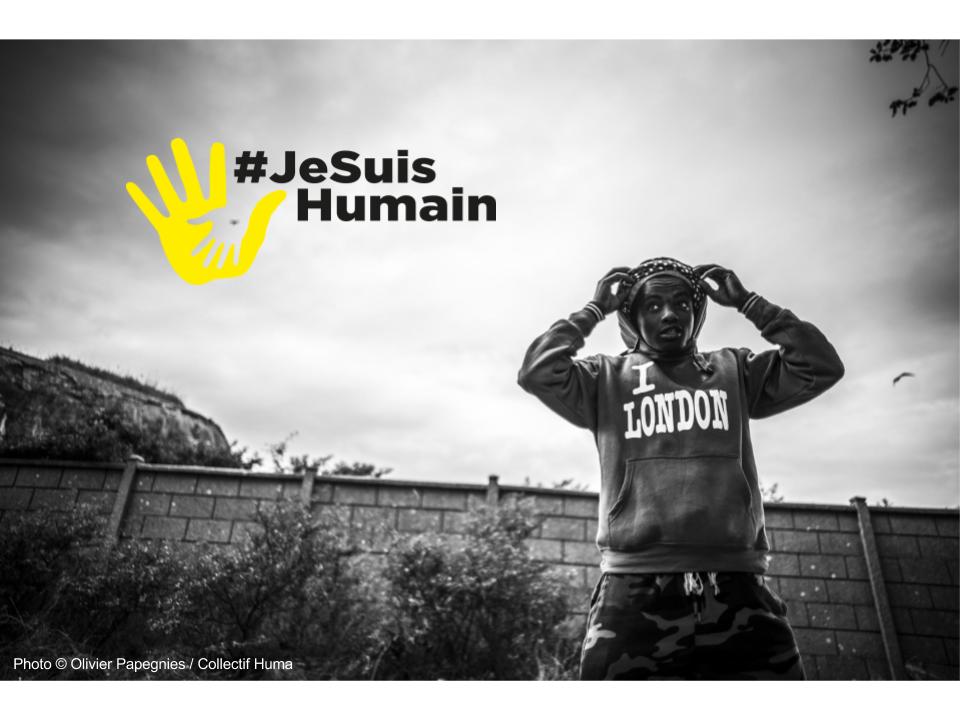
La semaine de 5 jours, les congés payés, les salaires minimums, les allocations de chômage et de maladie, les différentes formes de crédit-temps, mais aussi le suffrage universel pour tout citoyen qui habite en Belgique… Ces avancées sociales sont le fruit de combat de femmes et d’hommes engagés pour la solidarité et la justice sociale.
L’exposition comprend également un chapitre consacré à la CSC et l’immigration. Celui-ci a été réalisé avec la collaboration du CARHOP, Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire.
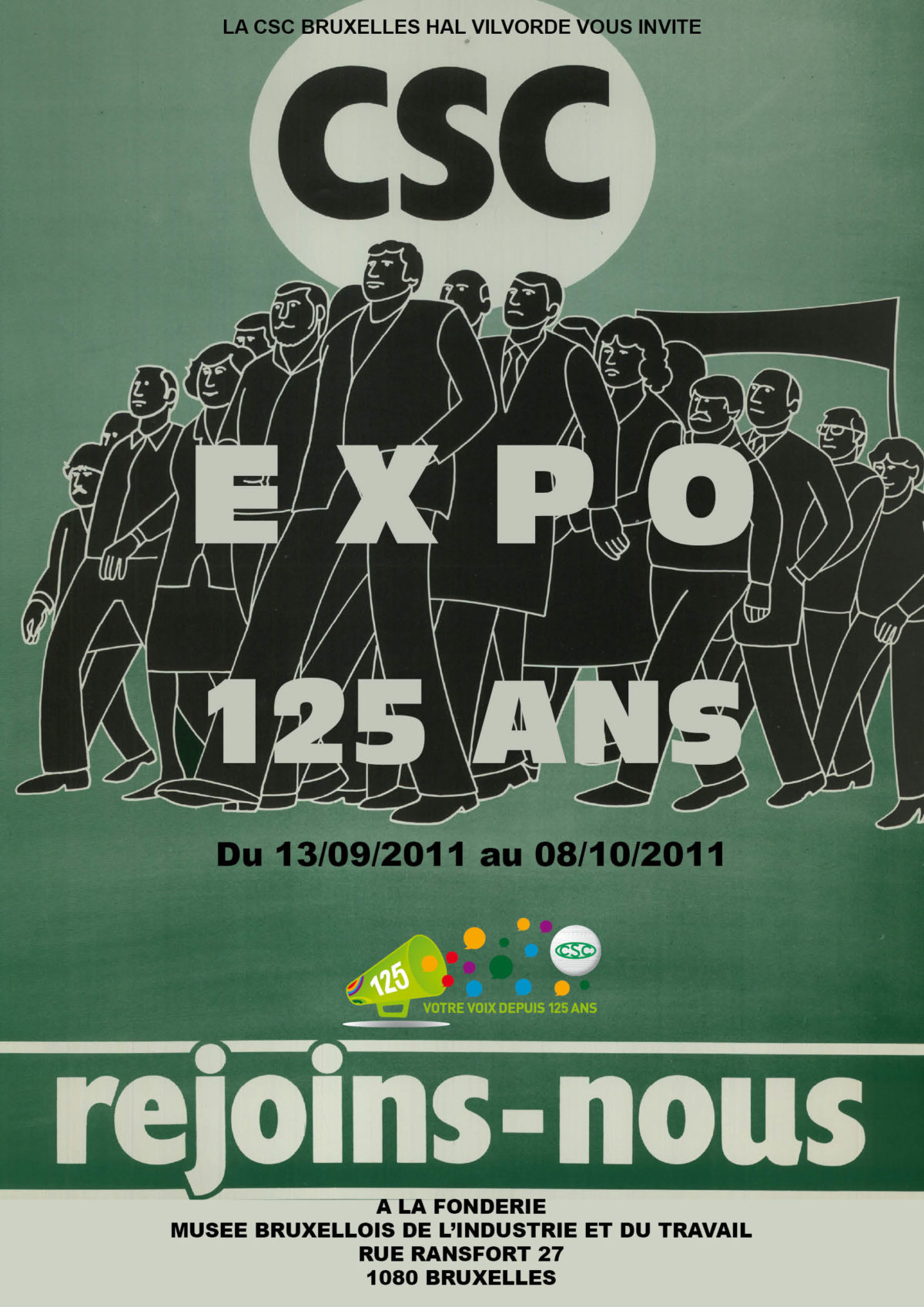
L’exposition répond à ces questions et révèle le rôle, longtemps sous-estimé, du papier peint dans l’ornementation intérieure. Décoration murale la plus courante depuis la seconde moitié du 18e siècle, il est un représentant exceptionnel de l’histoire du goût, de l’évolution de la société et des mentalités, mais aussi un objet technique remarquable, résultat de nombreuses innovations. Produit en masse grâce à l’industrialisation de la seconde moitié du 19e siècle, il s’est largement démocratisé et est venu orner les demeures de tout un chacun.
Entre produit de luxe et produit de masse, madeleine de Proust pour certains, déco tendance, vintage ou customisée pour d’autres, le papier peint séduit par son extraordinaire diversité.
Dans le décor préservé d’un ancien atelier de tourneurs, parmi d’anciennes machines dignes représentantes du passé industriel bruxellois, de précieux modèles et échantillons de papiers peints vous dévoilent leurs gammes variées de techniques, couleurs, matières et motifs. La plupart proviennent d’intérieurs bruxellois et furent même produits par des fabricants de la capitale, fabricants dont l’histoire méconnue est également retracée. Papiers peints, publicités, catalogues, objets pour la fabrication… ont été sortis de leurs réserves pour s’offrir à votre regard.
L’exposition Les murs ont des couleurs est une réalisation de La Fonderie-Musée bruxellois des industries et du travail, en collaboration avec la Direction des Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale et l’Institut royal du Patrimoine artistique. Elle s’est déroulée du 3 octobre au 24 décembre 2009.

Alors que l’événement Molenbeek – Métropole Culturelle 2014 battait son plein, La Fonderie présentait la commune sous un autre regard. En collaboration avec l’asbl « Bruxelles Nous Appartient », nous avions demandé à quelques dizaines d’habitants de choisir un objet important pour eux et de nous expliquer pourquoi il était indispensable à leur vie. Certains de ces objets sont porteurs de souvenirs, d’autres sont des outils du quotidien, certains suscitent la nostalgie ou nous apportent du réconfort. Sans véritable valeur marchande, ils sont pourtant inestimables pour leur propriétaire car porteurs de sens.
Cette exposition invitait à découvrir Molenbeek et ses habitants dans toute leur diversité.

Fatima Talbaui est une sculptrice confirmée. C’est elle qui fut à l’initiative de ce projet d’exposition. André Stengele a rapidement rejoint le projet car les thématiques de La Fonderie, il les connaît et les exploite depuis longtemps. Quant à Alexis Remacle, il a pratiqué une coulée à La Fonderie il y a quelques années et a accepté avec enthousiasme de joindre ses œuvres à celles de ses collègues.
Chacun de ces trois sculpteurs a créé une œuvre originale pour cette exposition. Ils se sont inspirés de l’ancienne fonderie de bronze autrefois installée ici, de la poésie de notre jardin des machines et du pouvoir évocateur des vestiges de l’activité passée.

En écho à l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source, le projet “Piss and Love” vient se nicher dans un « petit coin » de La Fonderie et approche la question des toilettes publiques dans l’espace urbain bruxellois, en mêlant photographie et art plastique, intrigue et revendication.
Au travers de connivences visuelles, l’exposition convoque chez les visiteurs des sentiments multiples où se mêlent étonnement, expériences vécues, curiosité et questionnements. Elle interroge la façon dont une ville conçoit et gère l’accès aux toilettes publiques, un service essentiel à la collectivité dont personne ne devrait être écarté. La politique d’une ville en matière d’accès aux toilettes n’est-elle pas un révélateur de la façon dont elle « fait société » ?
Un photographe et une Madame Pipi…
Pour ses photographies, Patrice Niset part à la rencontre d’hommes et de femmes au travail, entre dans leur univers, s’approche au plus près de leur geste, de l’objet qu’ils travaillent. Il capte les corps investis, la concentration au moment de façonner, les attentions et les mouvements mille fois répétés et affinés au cours du temps. Ce faisant, le photographe établit un état des lieux du monde du travail manuel actuel où les acteurs font corps avec leur passion.
Par extension, la vie de la cité s’est imposée au photographe comme un prolongement logique de son travail. Son œil capte tout ce qui fait fonctionner le métabolisme de la ville. L’accès aux lieux d’aisance publics en est partie intégrante. Patrice se lance donc dans un inventaire photographique des urinoirs publics, parfois bien cachés, de la capitale.
Cristina Cerqueira est née au Portugal sous la dictature de Salazar. Dans son lycée, elle lisait les slogans antifascistes écrits sur les murs et les portes des toilettes. Là d’où elle vient, les toilettes étaient des lieux de résistance.
Bien plus tard, Cristina devient « madame pipi » pour le Beursschouwburg, un club avant-gardiste bruxellois. Elle se souvient que les WC sont des lieux qui invitent à la libre expression. Sortir les mots des toilettes pour les libérer devient une évidence. La table habituellement occupée par la modeste coupelle destinée aux oboles voit débarquer un arsenal créatif fait de carnets, crayons, matériels de découpe et de collage. Cristina transforme un service habituellement monnayé en un échange humain. Des moments inattendus, des fêtes non programmées s’invitent dans les toilettes entretenues par Cristina qui deviennent un lieu à part dans la nuit bruxelloise. Aujourd’hui ce sont près de 200 carnets qui renferment les petits trésors de Cristina.
Une rencontre, un projet…
Plongé dans son inventaire des toilettes publiques, mais fidèle à son intérêt pour le travail, Patrice approche des « madames pipi ». Son chemin croise celui de Cristina. De cette rencontre jaillit un projet commun, beau et utile : mettre en dialogue les photos de Patrice et les carnets de Cristina, offrir un double regard sur une réalité à laquelle nul n’échappe.
… et un graffeur
Danger Dan est passionné par la démarche de Cristina depuis plusieurs années et travaille à ses côtés pour la mise en valeur de sa collection. Il a contribué à la direction artistique et à la signalétique de l’expo Piss and Love à La Fonderie.
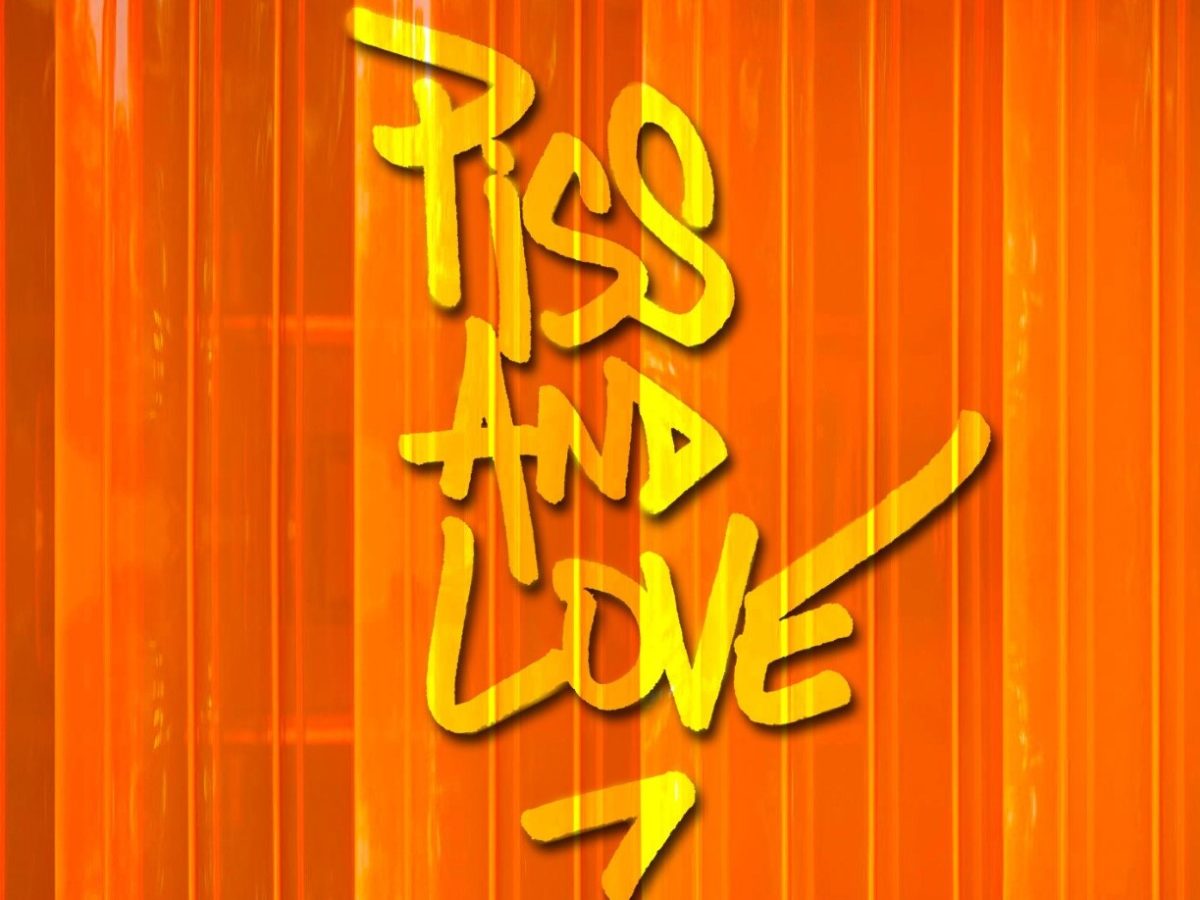
De décembre 2020 à octobre 2021, La Fonderie – musée bruxellois des industries et du travail accueille Saskia De Kinder. Cette jeune et talentueuse designer textile est diplômée de l’Académie des Beaux- Arts de Bruxelles. Elle crée ses propres motifs qu’elle tisse à l’aide de son métier à tisser manuel à lames. Bienvenue dans son atelier !
À travers cette résidence La Fonderie et Saskia souhaitent sensibiliser le public bruxellois au patrimoine matériel et au savoir-faire artisanal lié au design textile d’hier et d’aujourd’hui ; et ce, dans une perspective de durabilité.

Par sa formation de designer textile, l’artiste a une sensibilité graphique et esthétique qu’elle projette sur la collection de machines et outils du musée. Cette démarche s’inscrit dans un contexte sociétal post-moderne marqué par une volonté de revenir à des techniques artisanales. C’est ce que l’on appelle le « néo-artisanat ». A travers sa pratique, Saskia explore et promeut la complémentarité entre des techniques de tissage ancestrales et les technologies contemporaines. En effet, tout le travail de dessin des motifs est fait à l’aide d’un programme informatique, alors que le tissu est réalisé à la main.
Un petit atelier vitrine à été aménagé au sein du musée pour que Saskia y installe son métier à tisser. Pendant la résidence elle va y développer ses projets personnels de design textile. L’ensemble du processus de recherche, d’assemblage de matières, de partages de compétences et de démonstration de savoir-faire ouvert au public sera réalisé en live exclusivement au musée de la Fonderie.
La résidence sera le point de départ d’un programme d’ateliers participatifs s’adressant aux publics de La Fonderie. Assister au projet de design textile de Saskia, permettra au public de prendre conscience de l’importance de consommer et de produire local et en circuit court, des enjeux particulièrement mis en évidence par la crise sanitaire. Il comprendra quel est le processus derrière l’objet et comment il justifie le coût du travail artisanal.
Le design du textile vous intéresse ? Vous êtes invités à assister au processus de création à travers un programme d’ateliers participatifs :

Cette exposition vous offre un aperçu des trésors que recèlent les casernes du SIAMU. Les quelques objets sélectionnés font partie d’une collection de plus de 300 pièces. Ils ont été patiemment rassemblés depuis les années 1980 par l’asbl Les Amis du Musée du Feu (ou « AMUFEU »), des collectionneurs privés et le Service d’incendie lui-même.
L’ambition de cette exposition est donc d’éveiller les curiosités et d’introduire, sur le mode de l’avant-goût, l’histoire du travail complexe et dangereux des sapeurs-pompiers. Pour cela, elle juxtapose dans le contexte bruxellois le passé et le présent des trois facettes principales du métier : pompier bien sûr, mais aussi ambulancier et centraliste.
Cette exposition s’est tenue du 28 aout au 25 octobre 2020 à La Fonderie.

Pour ce faire, les participants ont apporté une ou plusieurs photos de personnes de leur entourage proche ou lointain qu’ils souhaitaient mettre à l’honneur dans cette exposition.
Ces clichés ont été minutieusement décrits et racontés lors de cercles de parole de façon à faire découvrir au groupe qui était la personne représentée, quel lien le participant entretenait avec elle, où la prise de vue avait été réalisée, dans quel pays, à quelle époque…
Des motifs en écho à ces filiations ont vu le jour : teints, imprimés, tricotés, crochetés, pliés… des motifs sonores aussi!
Des heures durant, les participants ont brodé les portraits de leurs ancêtres, les yeux dans les yeux. Ils y ont rajouté des mots extraits de leur témoignage sonore sur des motifs sérigraphiés par leurs soins.
Une constellation de portraits brodés dans des cercles s’est peu à peu formée pour donner naissance à un panthéon imaginaire composé des ancêtres des participants.
Exposition carte blanche réalisée par Istudio et l’asbl Le Cactus, présentée du 17février au 28 juin 2020.

Après un master en études cinématographiques, Margaux est propulsée en 2014 dans un centre d’enfouissement de déchets afin de comprendre : que faisons-nous avec nos déchets ? Pourquoi ? Comment ? Elle observe, mène des recherches pour un film documentaire avec l’association Image de ville, puis travaille sur l’exposition Vies d’ordures, de l’économie des restes en méditerranée pour le MuCEM (Musée des civilisations de la méditerranée, Marseille).
Ensuite, du musée à la rue, n’y avait-il pas qu’un pas ? Le musée n’est-il pas une énorme poubelle néguentropique ? Elle travaille alors plusieurs mois comme balayeuse de rue pour Bruxelles–Propreté. Elle écrit et photographie, avec son téléphone portable, les trottoirs, les déchets, le travail autour de nos ordures. Ces traces, elle les a scénographiées pour La Fonderie, car du musée à la rue, et de la rue au musée, n’y a-t-il pas comme un va-et-vient coriace ? Et toujours avec cette question obsédante : comment produire de l’énergie en transformant nos déchets ?
L’exposition Journal de rue a été créée dans le cadre du projet d’éducation permanente « Ces métiers qui sont les nôtres ». Elle était à voir à La Fonderie d’octobre à décembre 2019.
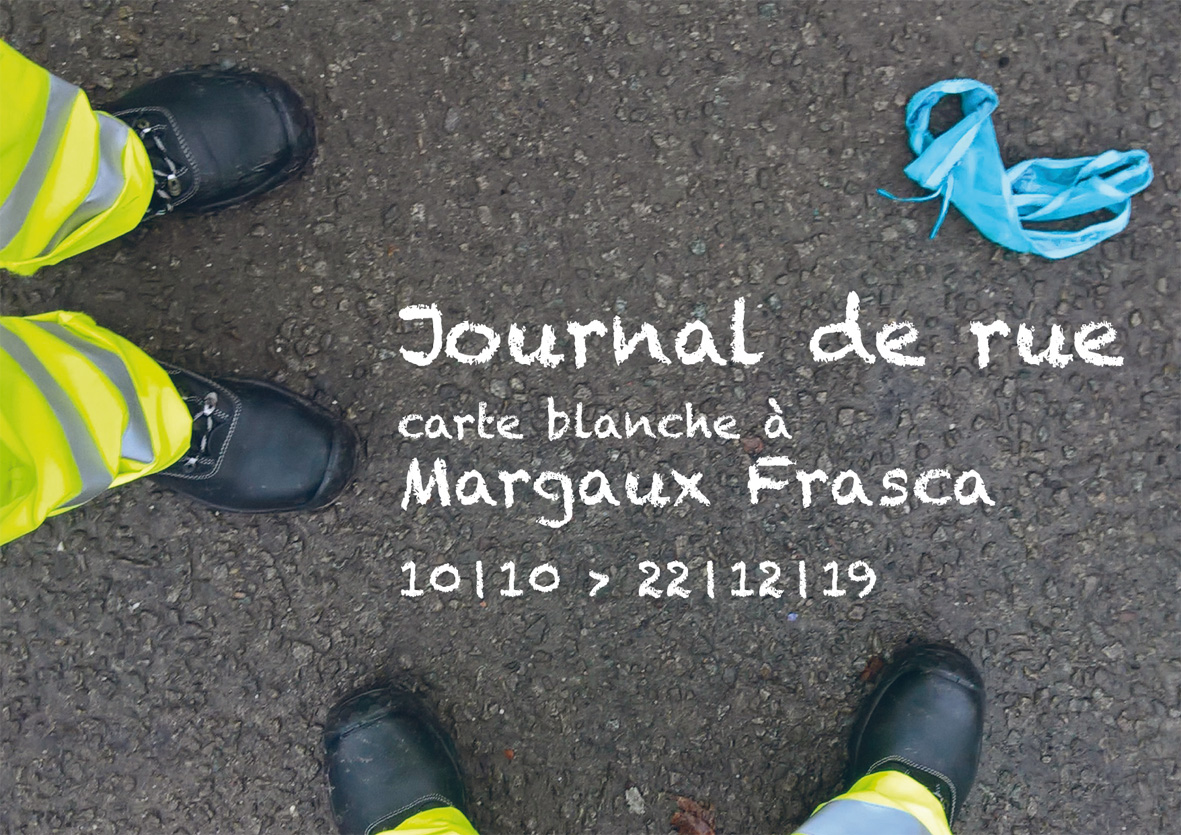
L’une crée des empreintes d’outils de jardin semblant sortir d’une obscure découverte archéologique. Elle transforme leurs silhouettes dessinées en motifs quasi floraux s’affichant sur des vases, des tapis, des tabliers… L’autre fait subir aux outils tous les maux habituellement réservés à leurs utilisateurs. Comme si ceux-ci les avaient contaminés : ils se tordent, se déforment, comme des corps écrasés de travail.
Christine Mawet et Rohan Graeffly ont décidé de faire dialoguer leurs œuvres et de mettre leurs talents en commun. Au-delà du rapprochement de leurs créations respectives, ils ont entamé une sorte de bouturage artistique où chacun répond à la proposition de l’autre.
La Fonderie, Musée des industries et du travail, est dès lors un terrain de jeu idéal pour les deux artistes. La collection permanente de papier peint revisitée donne naissance à des motifs en 3D. À l’inverse, les outils de fonderie de la Compagnie des Bronzes redessinés deviennent le matériau de base d’une nouvelle collection de motifs pour papier peint. Les cuillères à lisser quittent l’acier pour la porcelaine. Reproduites en série, elles se superposent en de fragiles colonnes vertébrales. Clin d’œil à la vanité des êtres qui seraient tentés de goûter aux fruits défendus.
Dans cette exposition « carte blanche » proposée par La Fonderie, les allégories se succèdent pour inviter le spectateur, non sans humour, à se maintenir dans un état de vigilance à l’égard des tentations.

Pour assurer cette mission, La Fonderie dispose d’un personnel scientifique qualifié qui mène des recherches de fond – parfois à la demande d’autres institutions – alimentées par les nombreuses ressources documentaires et archives conservées par La Fonderie (voir Centre de documentation).
L’équipe scientifique de La Fonderie est soutenue dans ses activités de recherches et d’acquisition d’archives par un conseil scientifique composé de 11 membres permanents extérieurs à La Fonderie ayant une compétence scientifique ou professionnelle dans l’une ou plusieurs des disciplines suivantes : architecture, géographie, histoire économique/sociale, muséologie, patrimoine, sociologie, tourisme, urbanisme.
Le lecteur pourra trouver sur la page “nos projets scientifiques” les principaux projets passés et actuels de La Fonderie.
Notre société tente à l’heure actuelle de s’adapter aux bouleversements engendrés par la Révolution digitale et d’en saisir les opportunités. Depuis une vingtaine d’année, nos régions lancé d’ambitieuses politiques veillant à apurer la dette écologique résultant principalement des révolutions industrielles qui ont façonné notre environnement depuis plus de deux siècles.
Les pollutions du sol sont très fréquentes dans les zones urbaines au passé industriel. Peu visibles elles présentent des risques réels et peuvent être à la source de problèmes de santé. En milieu urbain, les dangers de cette contamination pour les habitants sont accrus du fait de la mixité « logement-entreprise » et de la densité de population. La pollution du sol peut également avoir un impact significatif sur l’environnement en portant atteinte à la biodiversité, aux écosystèmes et aux nappes d’eau souterraines.
Le risque d’acquérir sans le savoir un sol pollué peut entraîner des désagréments financiers. Dans tous les cas, cette situation introduit un risque économique lié à l’incertitude. La pollution du sol pose également des problèmes en termes de bonne gestion foncière et immobilière de la ville. Les pouvoirs publics mènent une politique visant à réhabiliter des sites pollués ou potentiellement pollués afin de répondre aux nécessités de redéploiement économique par la création de nouveaux espaces, et visant à améliorer l’environnement de nos régions.
La mise en place d’un programme de réhabilitation des anciens sites industriels passe par une étude historique des sols et par des campagnes de mesures sur le terrain. Les bureaux d’étude en charge de ces analyses ont parfois du mal à expliquer certaines pollutions notamment à cause d’une documentation difficilement disponible ou des migrations de pollutions non expliquées, souvent engendrées par un bâti sous-terrain mal identifié (sections d’égouttage abandonnées, puits désaffectés ou un ancien détournement du lit de la Senne à Bruxelles, par exemple).
Le projet Salamandre est né d’un consortium entre les Archives de l’Etat à Bruxelles, la Fonderie, le Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques de l’Université de Liège, le Pôle d’Histoire et de Sociologie environnementales de l’Université de Namur, le Earth and Life Institute de l’Université catholique de Louvain et l’asbl BruxellesFabriques. Il portait sur la recherche de nouvelles pistes archivistiques et documentaires en vue d’aider les acteurs de terrain. En tenant compte de l’urgence dans laquelle doivent souvent travailler les acteurs de l’assainissement des sols et la complexité de la recherche archivistique, il était indispensable de trouver des synergies entres les milieux économiques, administratifs et archivistiques afin de réfléchir, de concevoir et de rechercher des moyens de contribuer à alimenter l’inventaire des sols élaboré par Bruxelles-Environnement.
Nous avons démontré que les archives peuvent aider les administrations à veiller sur la santé des habitants et aménager au mieux le territoire. Parallèlement, la connaissance du passé permet aux citoyens de réapproprier les espaces qu’ils occupent. Ce projet débouche déjà sur un autre projet de co-création financé par Innoviris.brussels en vue de favoriser l’agriculture urbaine et la sauvegarde du patrimoine industriel par une mobilisation citoyenne en vue d’une valorisation des archives, ArchiSols.
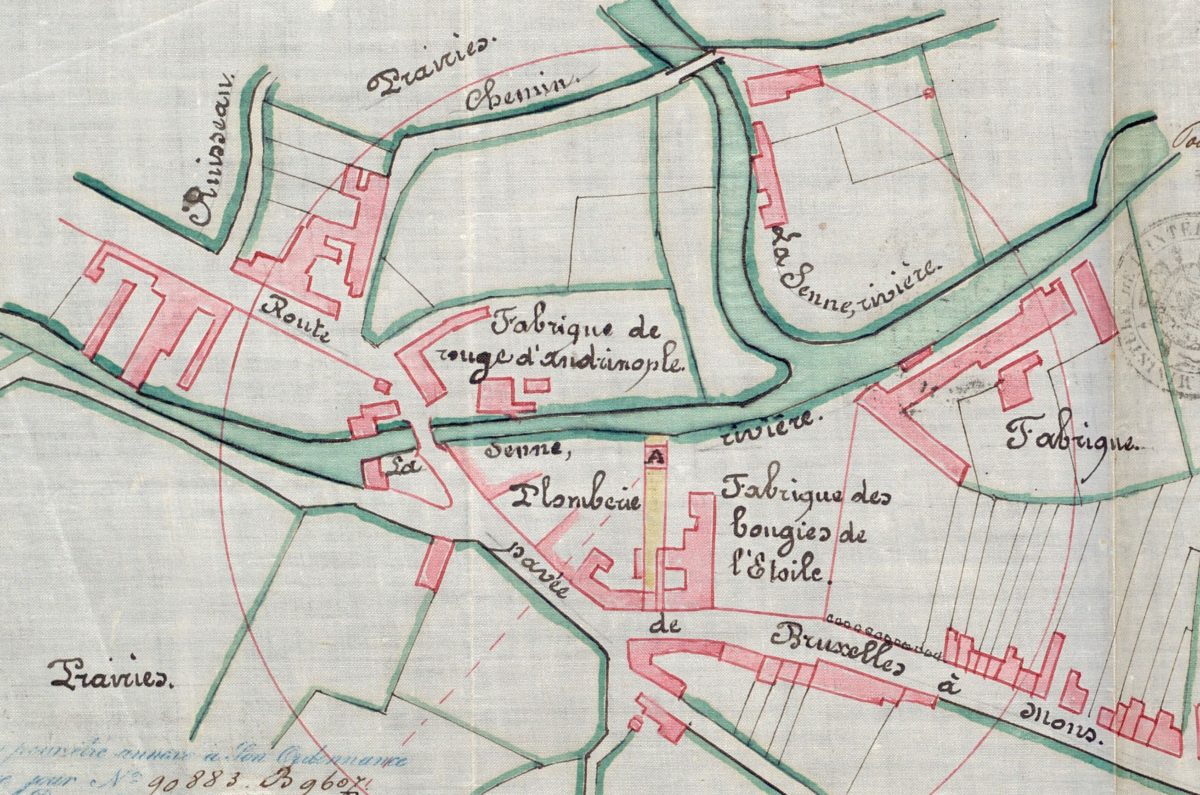
Si de nos jours la lessive est un geste tellement simple et facile qu’on le pratique presque quotidiennement, il n’en a pas toujours été ainsi. Pendant des siècles, elle a été une besogne particulièrement ingrate, fastidieuse et chronophage. Tant qu’il y aura du linge aborde la thématique du lessivage sous des aspects aussi divers que le sujet est riche. Les questions historiques et sociologiques renseignent sur les pratiques culturelles, alors qu’un questionnement relatif à des problématiques actuelles (écologie, redécouverte de techniques de saponification), permet de redécouvrir cette activité trop longtemps genrée. Enfin, une approche plus patrimoniale nous fait découvrir la diversité ces objets du quotidien, machines et savoir-faire anciens. L’ensemble est richement illustré par une magnifique iconographie et des témoignages inédits.
Sommaire
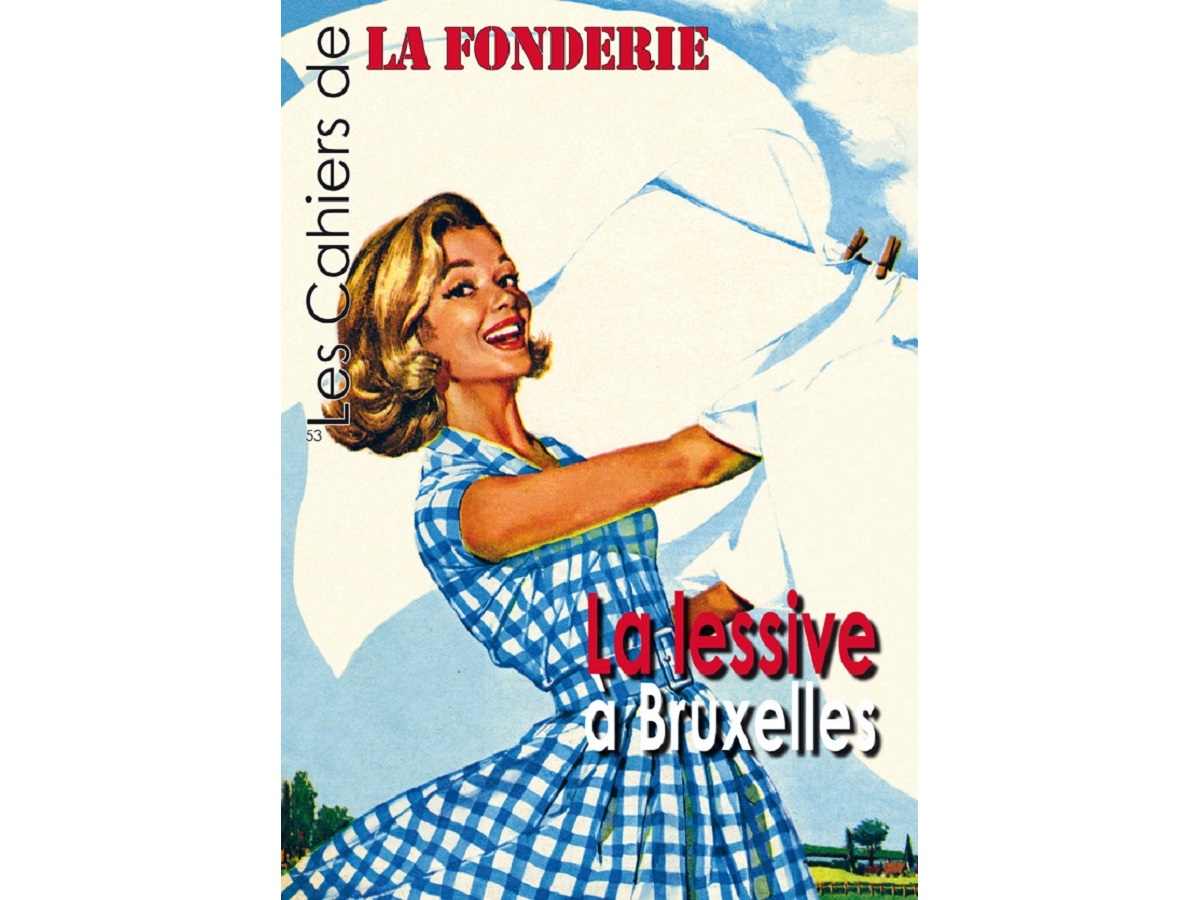
23 hôpitaux, plus de 338.000 admissions, 6.000 lits, 23.000 membres du personnel. C’est ce que représente le secteur hospitalier à Bruxelles en 2017. Un enjeu socio-économique majeur !
La première partie de la publication se penche sur des lieux, connus ou moins connus tels que Saint-Pierre ou Saint-Luc, les institutions coloniales, l’hôpital militaire ou encore l’institut dentaire George Eastman. Dans la deuxième partie du cahier, l’humain occupe le devant de la scène.
Sommaire
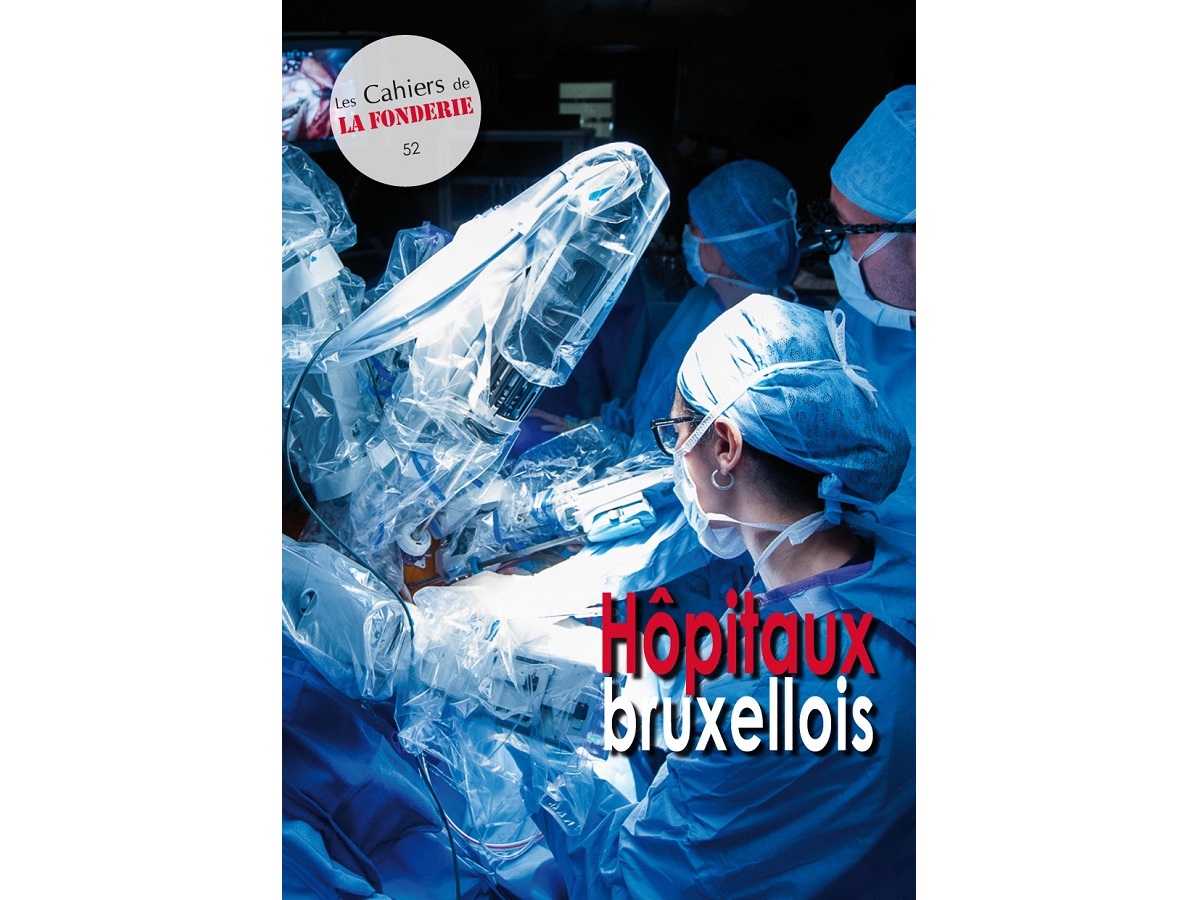
Le 5 décembre 2012, Jean-Pierre Nandrin nous quittait. Cet historien engagé, à l’université comme sur le terrain de la mémoire et de la communication de l’histoire, laisse derrière lui un héritage d’une grande richesse.
Le cahier est en trois parties. La première, communiquer l’histoire. La deuxième, enseigner l’histoire et la troisième, l’historien comme expert dans les commissions d’enquête. Voilà des thèmes qui tenaient particulièrement à cœur à Jean-Pierre Nandrin.
Sommaire
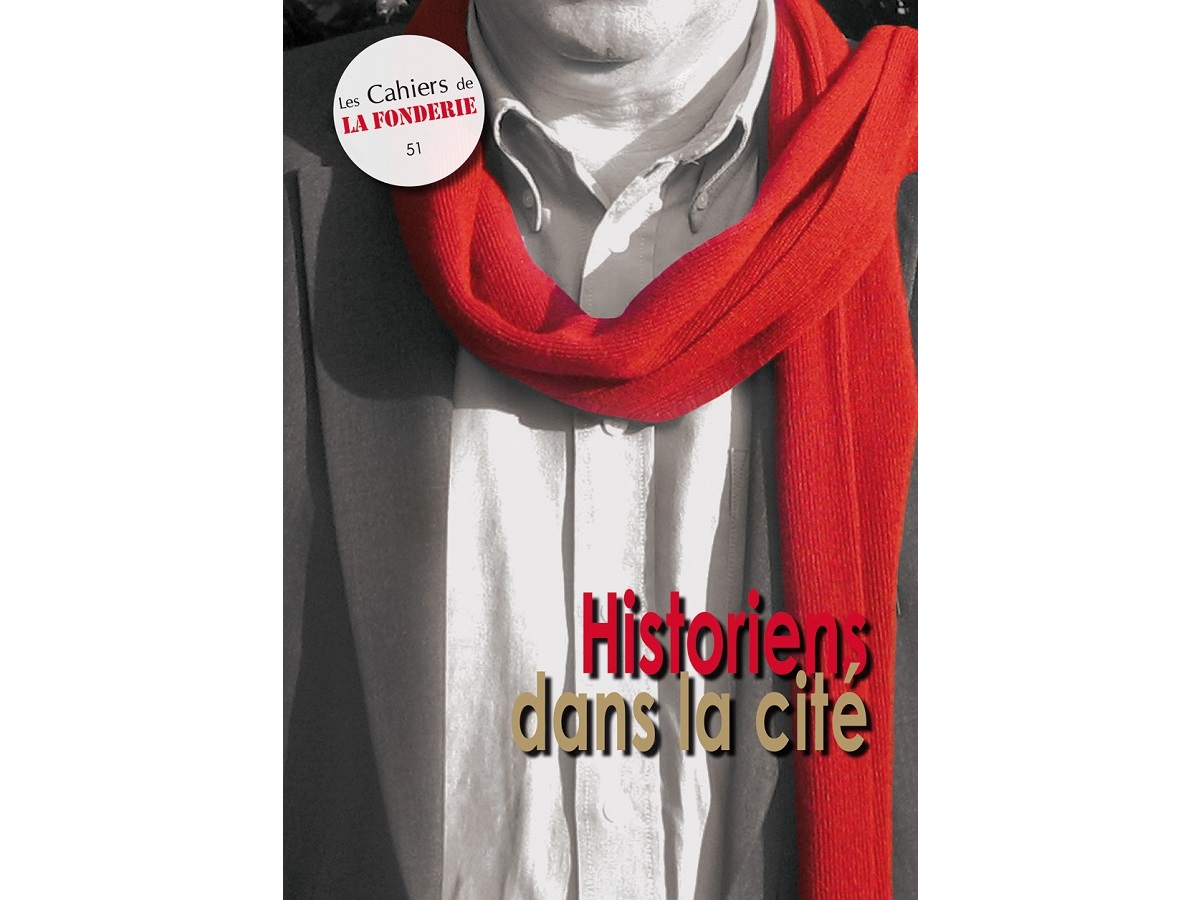
Depuis 2008, les tentatives d’analyse de la crise économique que nous vivons n’ont pas manqué de faire référence à la grande dépression des années ‘30. S’agit-il pour autant d’un parallèle pertinent ? L’équipe de rédaction des Cahiers de La Fonderie a voulu en savoir plus sur ce que représente la crise à l’échelle d’une ville. Notre publication s’est donc arrêtée à Bruxelles, dans les années ‘30, pour tenter de faire écho à la situation actuelle.
Sommaire
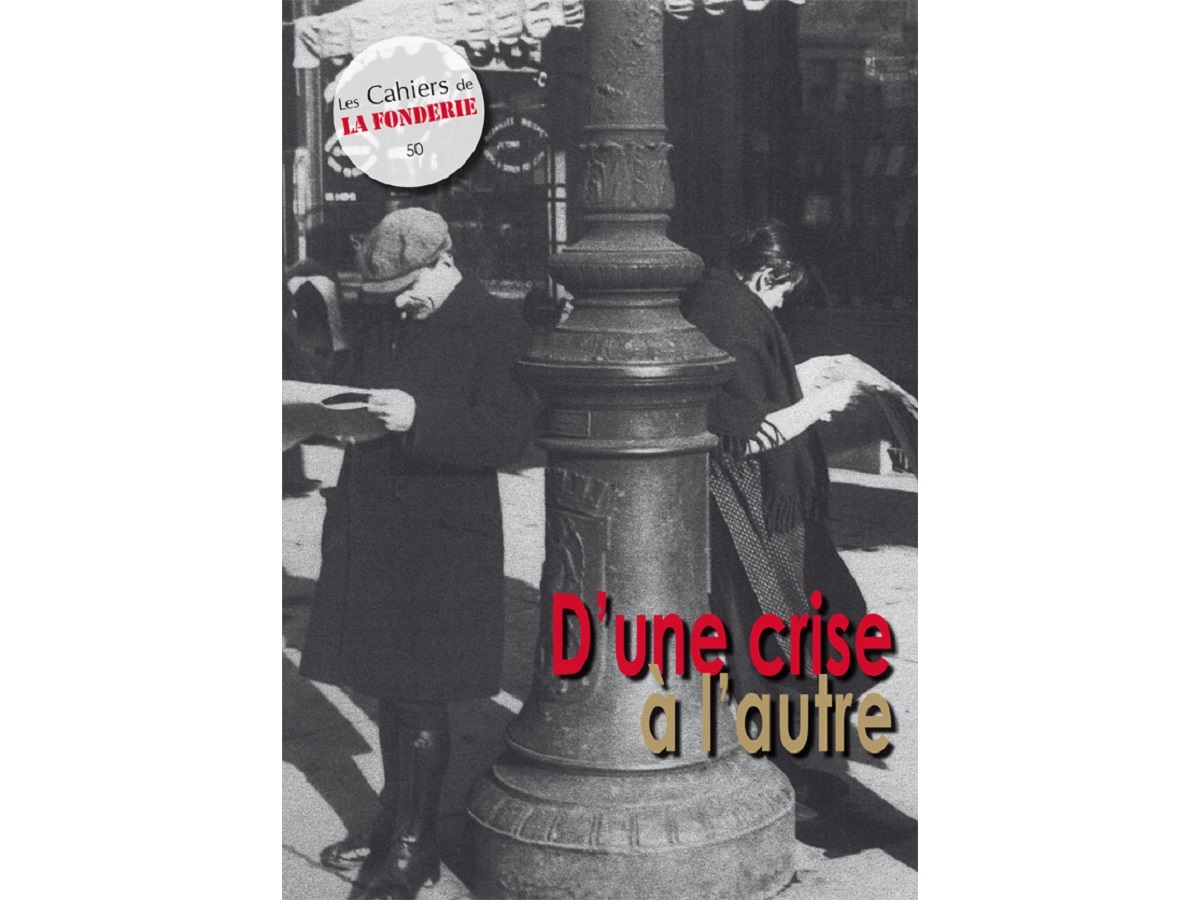
Tout en conservant un caractère scientifique et pluridisciplinaire, Les Cahiers de La Fonderie, sont destinés au grand public. Ils présentent des articles variés, illustrés par une abondante iconographie et des interviews dynamiques enrichissant la mémoire orale. Souvent, une courte bibliographie permet d’approfondir le sujet. La publication se veut être un lieu de rencontre entre une information diversifiée et une réflexion sur la société.
Les Cahiers de La Fonderie sont des publications de la maison d’édition de La Fonderie. Ils sont édités depuis 1986.
Où trouver les Cahiers de La Fonderie ?
Vous pouvez vous les procurer à La Fonderie, à l’accueil du musée bruxellois des industries et du travail.
Vous pouvez également les recevoir par courrier. Les frais d’envoi sont calculés selon le destinataire.
Pour toute commande, info ou question : info@lafonderie.be – 02 410 10 80
Tous les Cahiers de La Fonderie
n° 53 – Tant qu’il y aura du linge à laver
n° 52 – Hôpitaux bruxellois
n° 51 – Historiens dans a cité
n° 50 – D’une crise à l’autre
n° 49 – Made in Brussels
n° 48 – Écoles bruxelloises
n° 47 – Port du masque obligatoire
n° 46 – Fêtes hivernales : renaissance ou mort annoncée ?
n° 45 – (in)sécurité sociale
n° 44 – Carré blanc, pratiques de l’intime à Bruxelles
n° 43 – Les élites dans la ville
n° 42 – Bruxelles industrielle ? Aujourd’hui et demain
n° 41 – Bruxelles industrielle ? Hier
n° 40 – Boire et manger
n° 39 – Le travail des femmes
n° 38 – Bruxelles et le Congo
n° 37 – Exposition universelle
n° 36 – Ouvriers et vile en mouvements
n° 35 – Tout feu, tout flamme
n° 34 – Destination Bruxelles
n° 33 – Molenbeek, une commune bruxelloise
n° 32 – Bruxelles en 14-18, la guerre au quotidien
n° 31 – En avant pour le suffrage universel
n° 30 – La mode dans tous ses états
n° 28-29 – La Cie des bronzes de Bruxelles, fabrique d’art
n° 27 – Ordre public et justice
n° 26 – La Fonderie s’expose
n° 25 – La vie en musique
n° 24 – Bruxelles entre en gare
n° 23 – Les lumières de la ville
n° 22 – Tous les enfants ÉGAUX ?
n° 21 – Quand la ville dort…
n° 20 – La viande – tranche de ville – mode de vie
n° 19 – Construire
n° 18 – Service compris – Hôtels, restaurants, cafés
n° 17 – Je jette, tu récupères
n° 16 – Au fil des eaux
n° 15 – Tailleurs et couturières
n° 14 – Et les ouvriers ?
n° 13 – Du carrosse princier à la voiture populaire
n° 12 – Les autres…
n° 11 – Bonbons, pralines, esquimaux, chocolats !
n° 10 – Machines et mécaniciens
n° 9 – L’art du métal
n° 8 – Bières brasseries patrimoine industriel
n° 7 – Le travail des femmes et des enfants
n° 6 – Le logement ouvrier dans l’impasse ?
n° 5 – Les vagabonds – et autres articles
n° 4 – Les écoles primaires – et autres articles
n° 3 – Petit commerce et grands magasins – et autres articles
n° 2 – Bruxelles et la prostitution au 19ème siècle – et autres articles
n° 1 – Bruxelles : un canal, des usines et des hommes
n°0 – Les Cahiers de La Fonderie
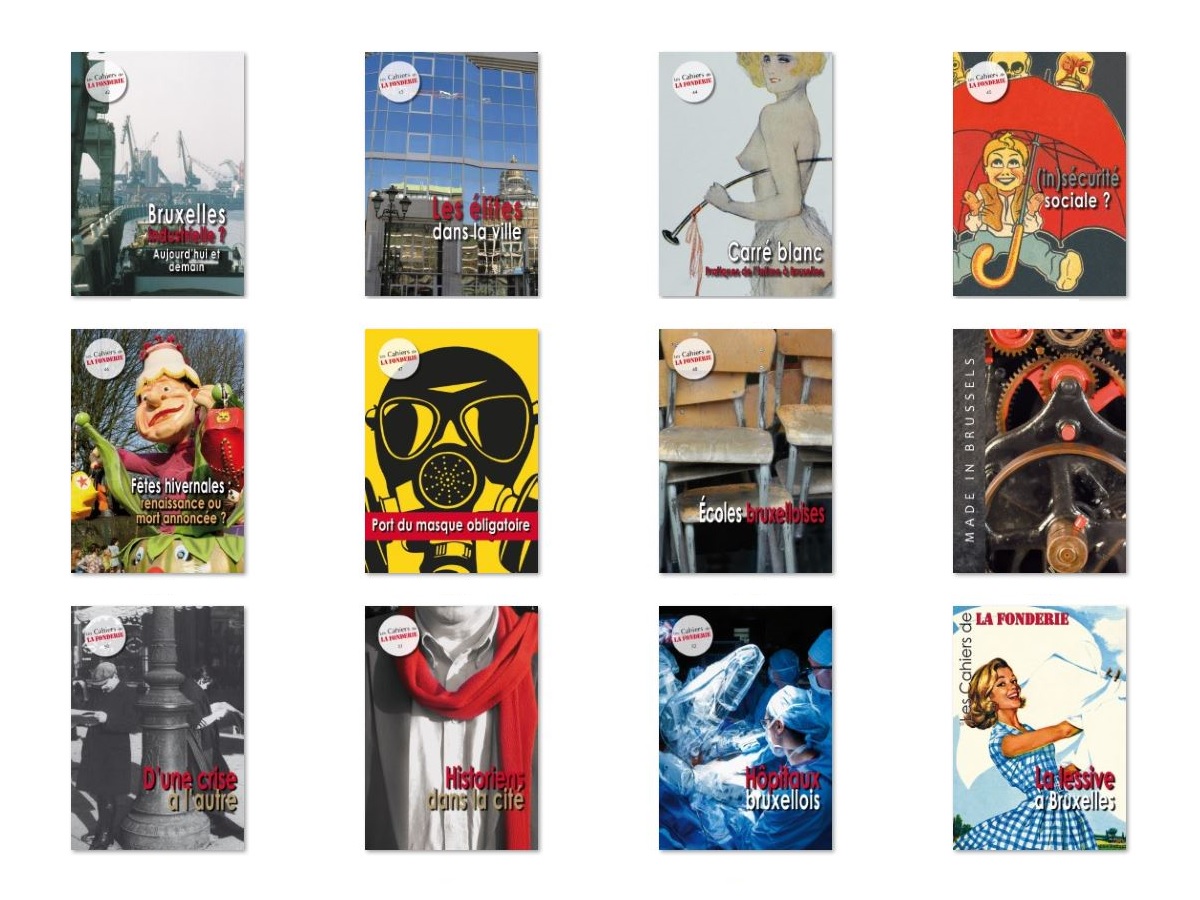
Ce numéro des Cahiers de La Fonderie fait la part belle aux illustrations, documents et objets issus de nos collections. Il présente l’exposition permanente constituée de quatre modules. Ces modules sont enrichis par des explications et des schémas techniques sur les machines présentées ou par des documents iconographiques inédits.
Le support idéal pour en savoir plus et prolonger la visite du musée bruxellois des industries et du travail chez soi.
Sommaire
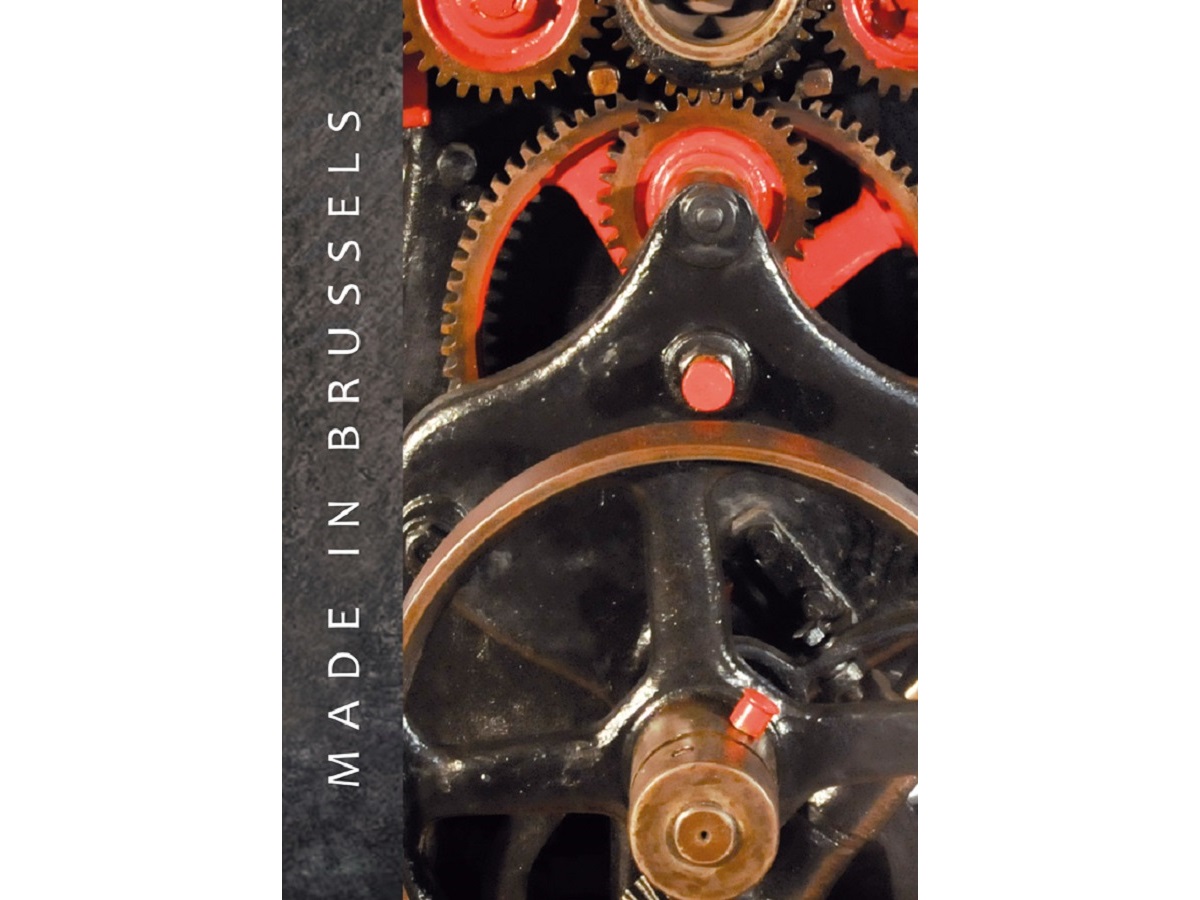
Sommaire
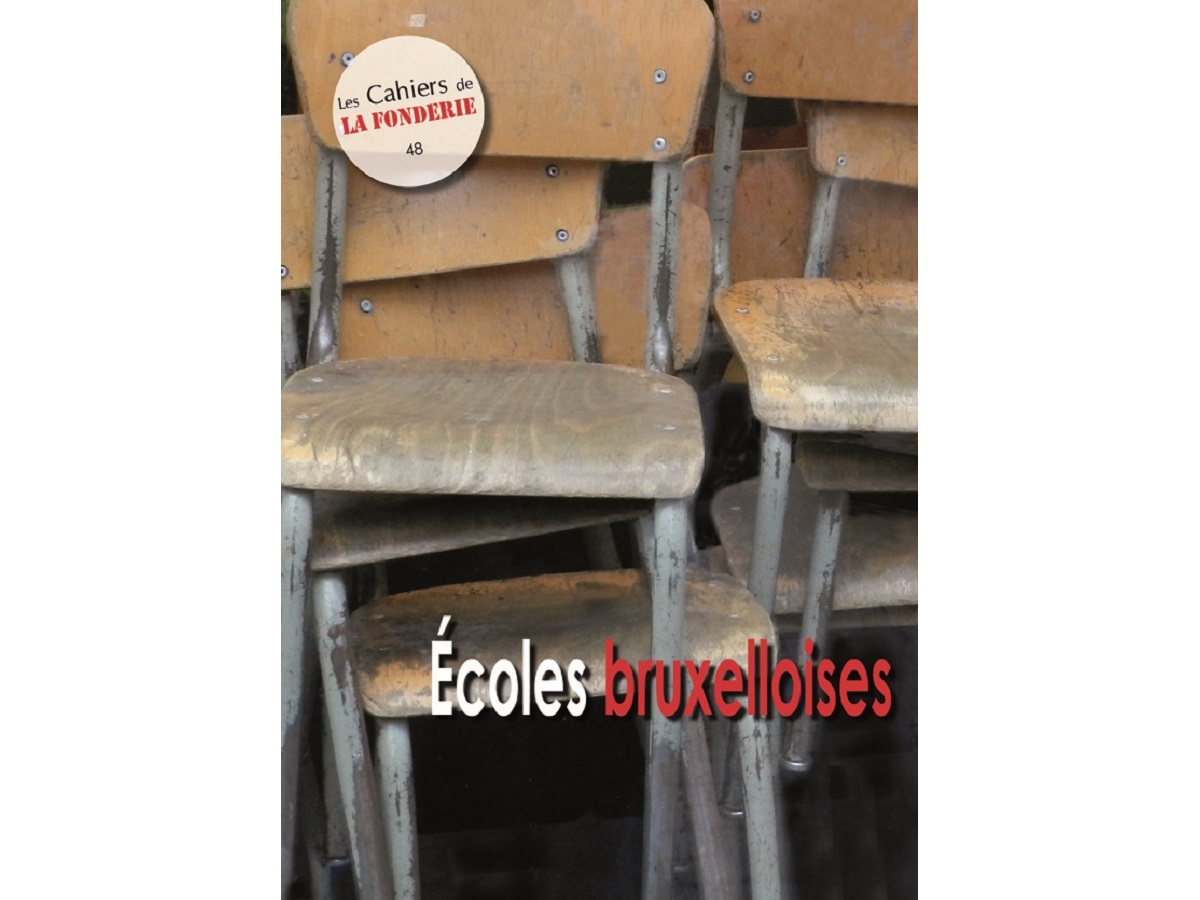
Amiante, céruse ou encore zinc : quels furent les combats et les obstacles avant une réelle reconnaissance de leur toxicité ? Quelles mesures furent prises ? Comment furent calculées les indemnisations ? Entre les intérêts souvent divergents de la santé et des intérêts économiques, la science sert parfois l’un ou l’autre donnant un caractère triangulaire à ces relations.
De l’histoire environnementale ou de l’histoire du travail, on passe rapidement à une analyse des rapports de force, des acteurs en présence ou encore des processus de décision. On en ressort enfin avec des interrogations existentielles sur l’essence même des notions de “société”, “travail”, “peur”, “capacité d’indignation” ou encore “renoncement”.
Sommaire
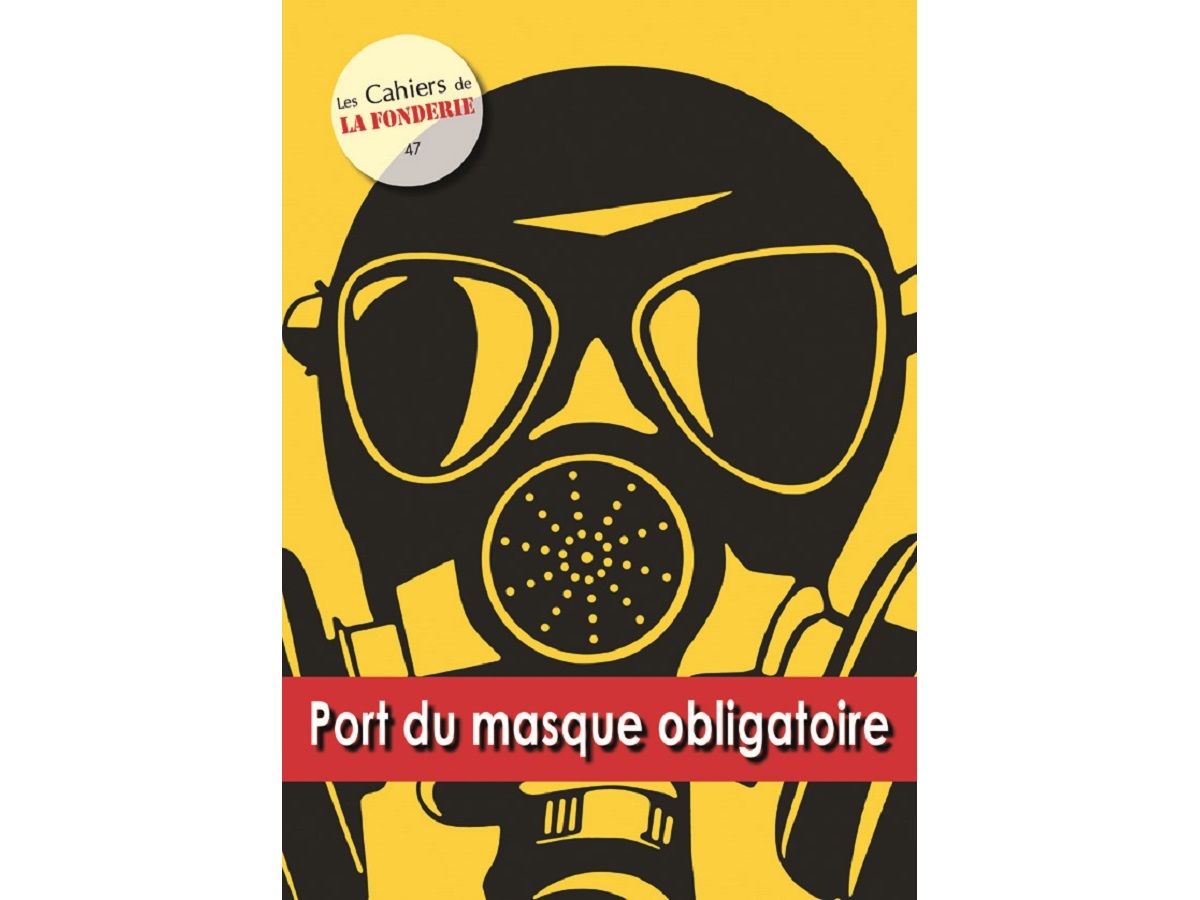
Les fêtes de fin d’année constituent une succession de célébrations suite auxquelles les petits et grands enfants sont inondés de cadeaux. Ces célébrations sont elles devenues le seul résultat d’une société mercantiliste qui crée, à force de publicités, ce besoin de faire la fête et de maintenir artificiellement des traditions ?
Ce numéro des Cahiers de La Fonderie tente de mettre un peu d’ordre dans toutes les idées reçues. Il s’ouvre par une promenade dans l’histoire des fêtes à Bruxelles : d’où viennent-elles ? Que fêtons-nous à Bruxelles ? La Saint-Nicolas, Noël et Halloween sans oublier des moments clés comme le joyeux cortège de la Saint-Verhaegen pour les étudiants de l’ULB ou, plus sérieux, l’ouverture de la saison mondaine.
Il fait la part belle à nos souvenirs d’antan… et impressions d’aujourd’hui car non, le plaisir d’être ensemble n’est pas perdu !
Sommaire
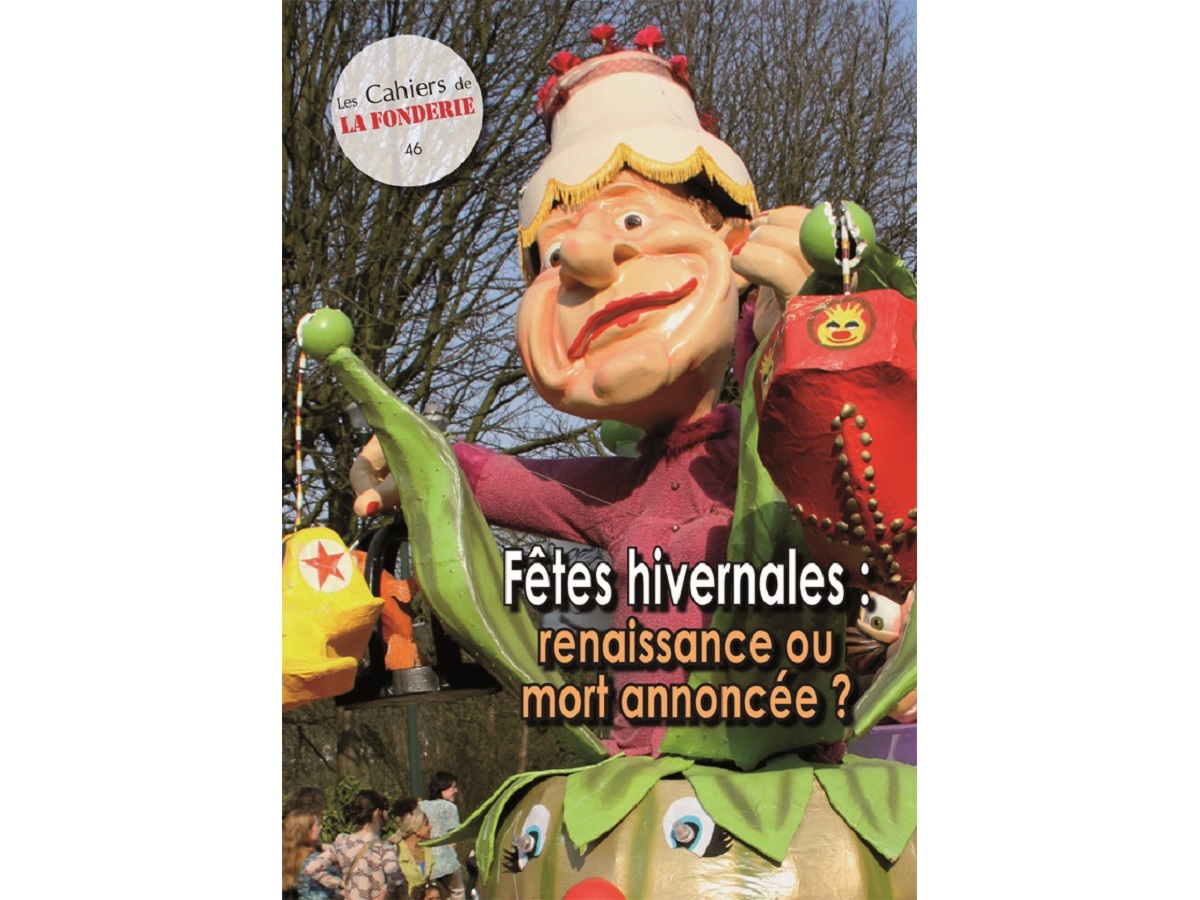
Sommaire
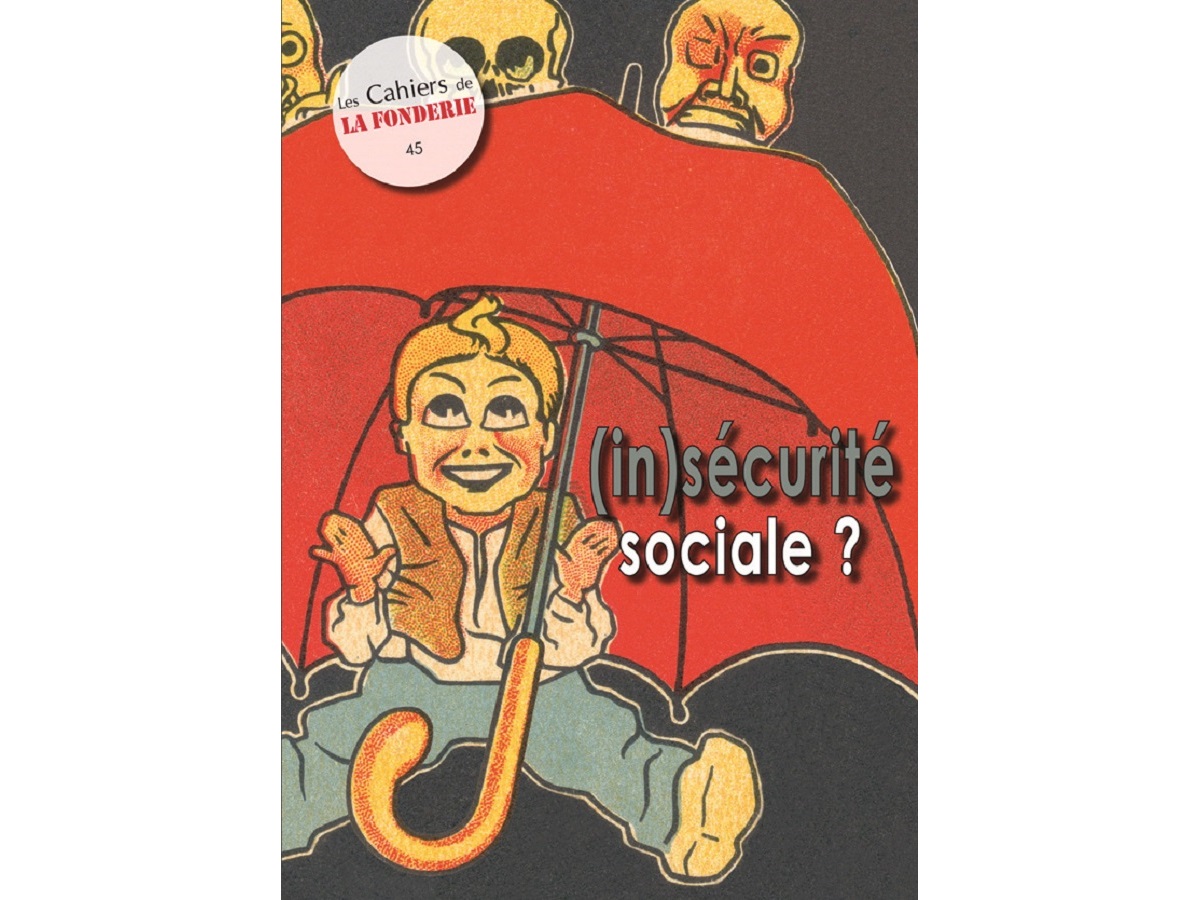
Sommaire
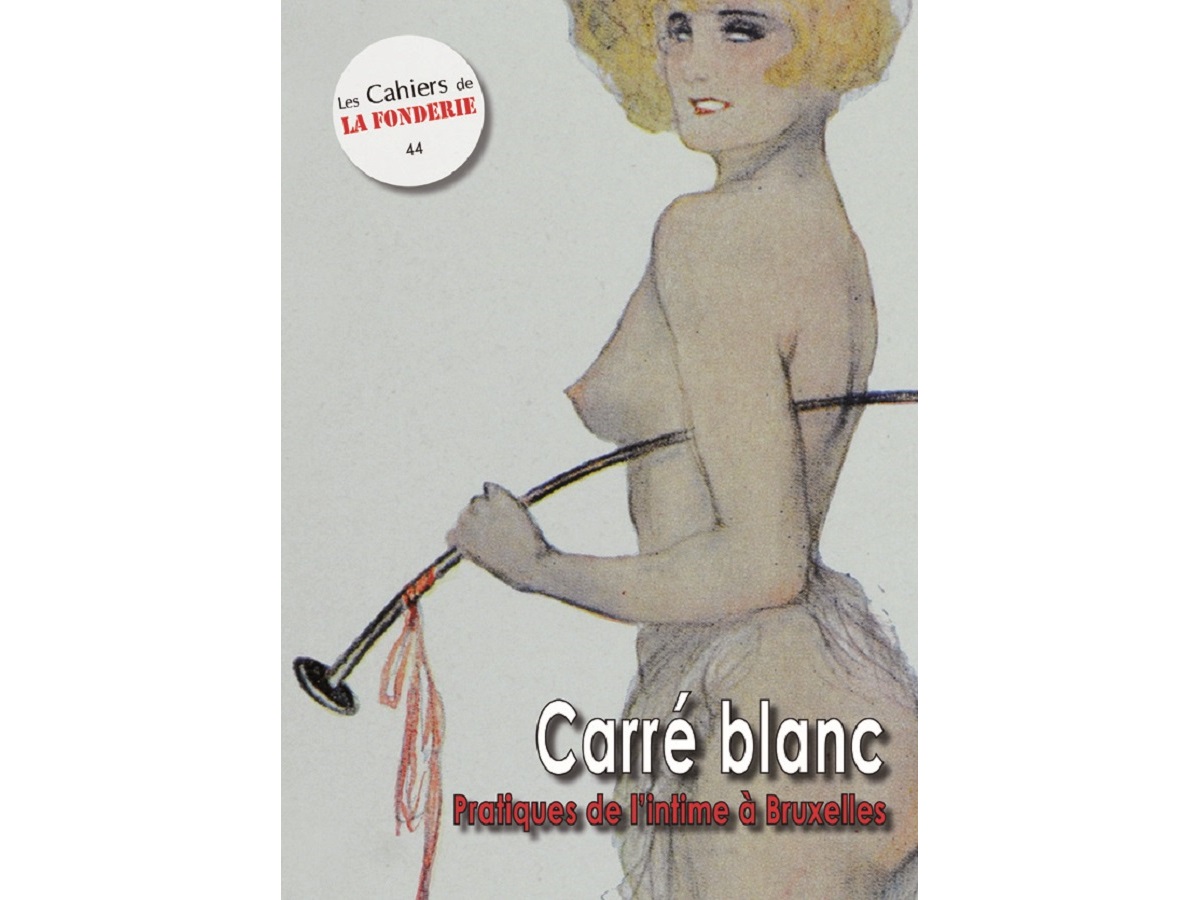
Les études sur la société bruxelloise se focalisent souvent sur les classes dites défavorisées à travers des études sur la pauvreté, le chômage, le logement ouvrier, etc. Depuis quelques années pourtant, historiens, sociologues ou géographes renouvellent les recherches urbaines en proposant un regard sur les élites, ces groupes privilégiés qui marquent au moins tout autant les espaces de nos villes de leur empreinte. En témoigne le groupe de recherche de l’ULB sur «les élites dans la ville», dont ce Cahier de La Fonderie est la première publication collective.
Il permet de faire connaître au public les résultats de travaux en cours et pour la plupart inédits.
Sommaire
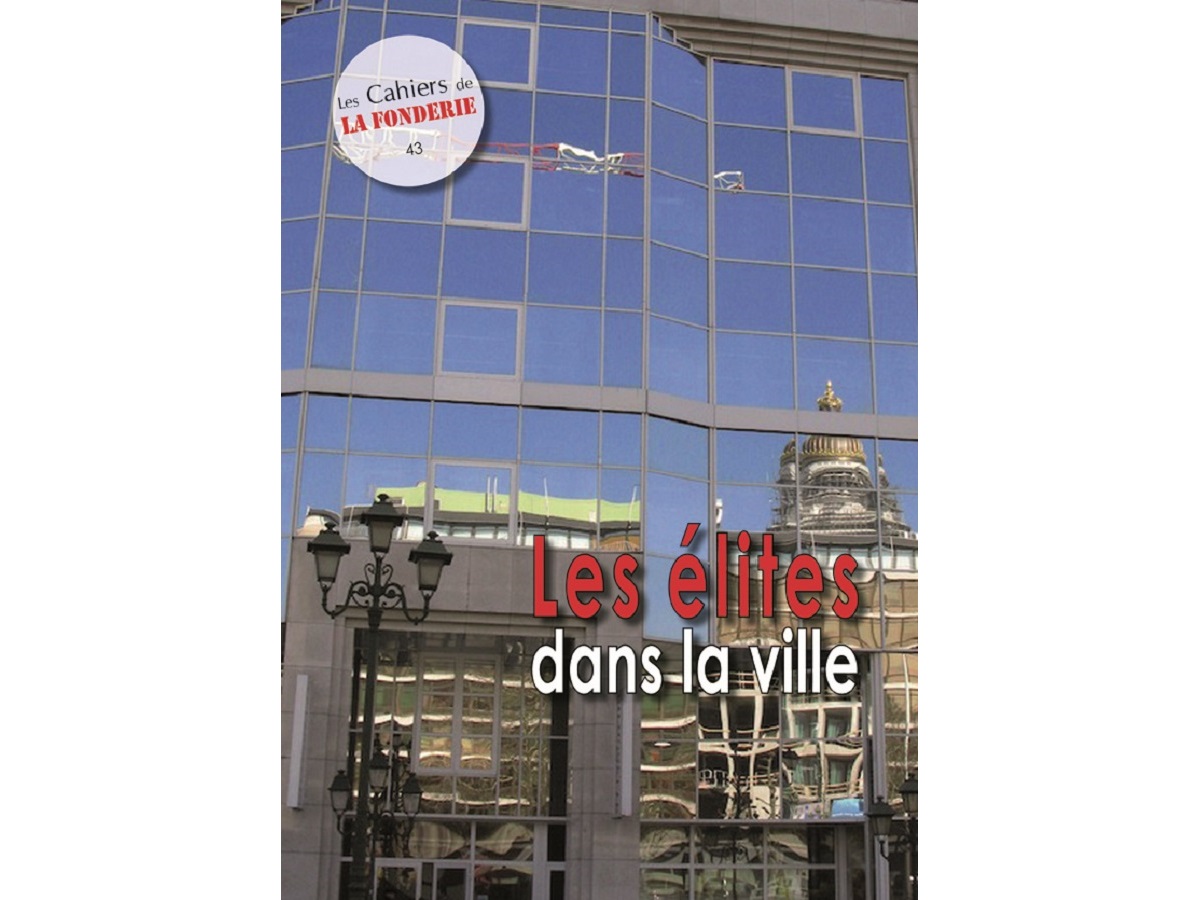
Sommaire
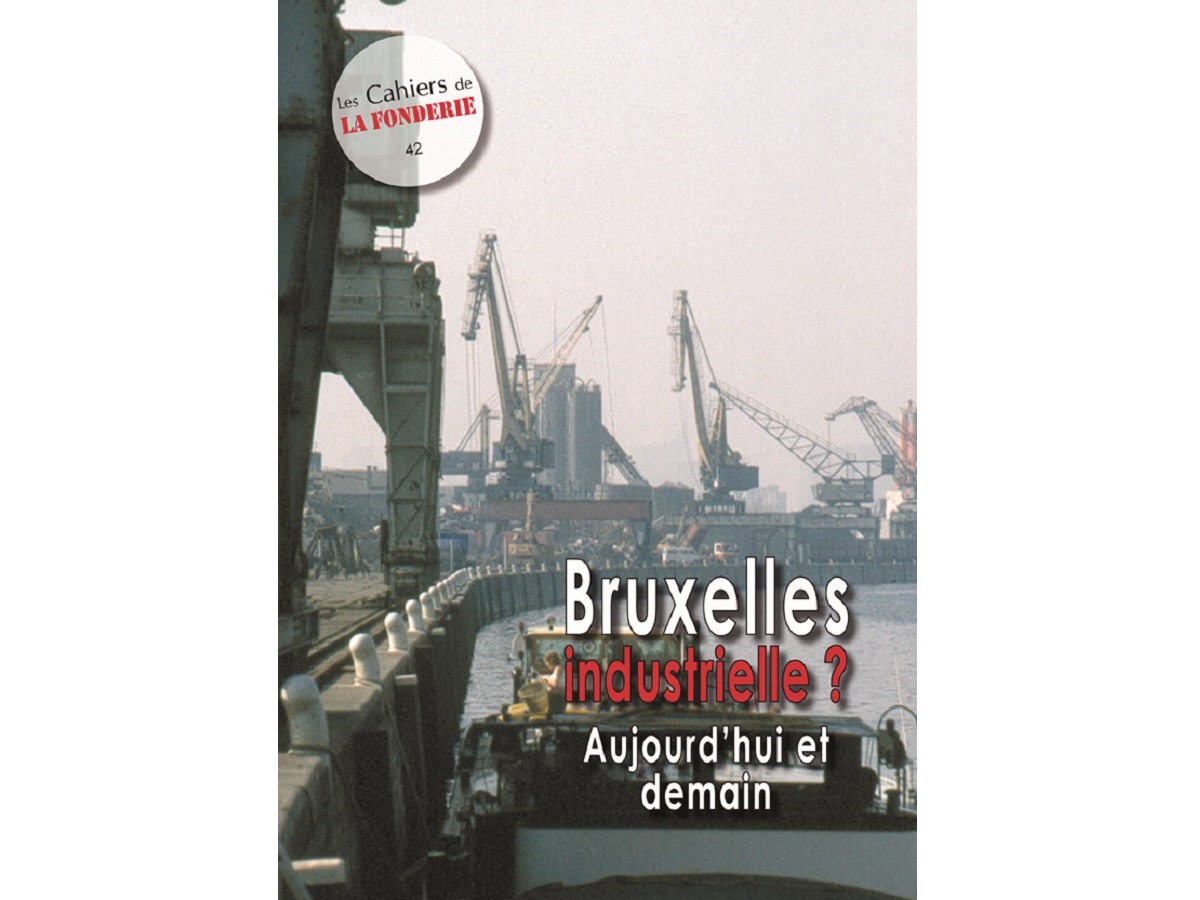
Sommaire
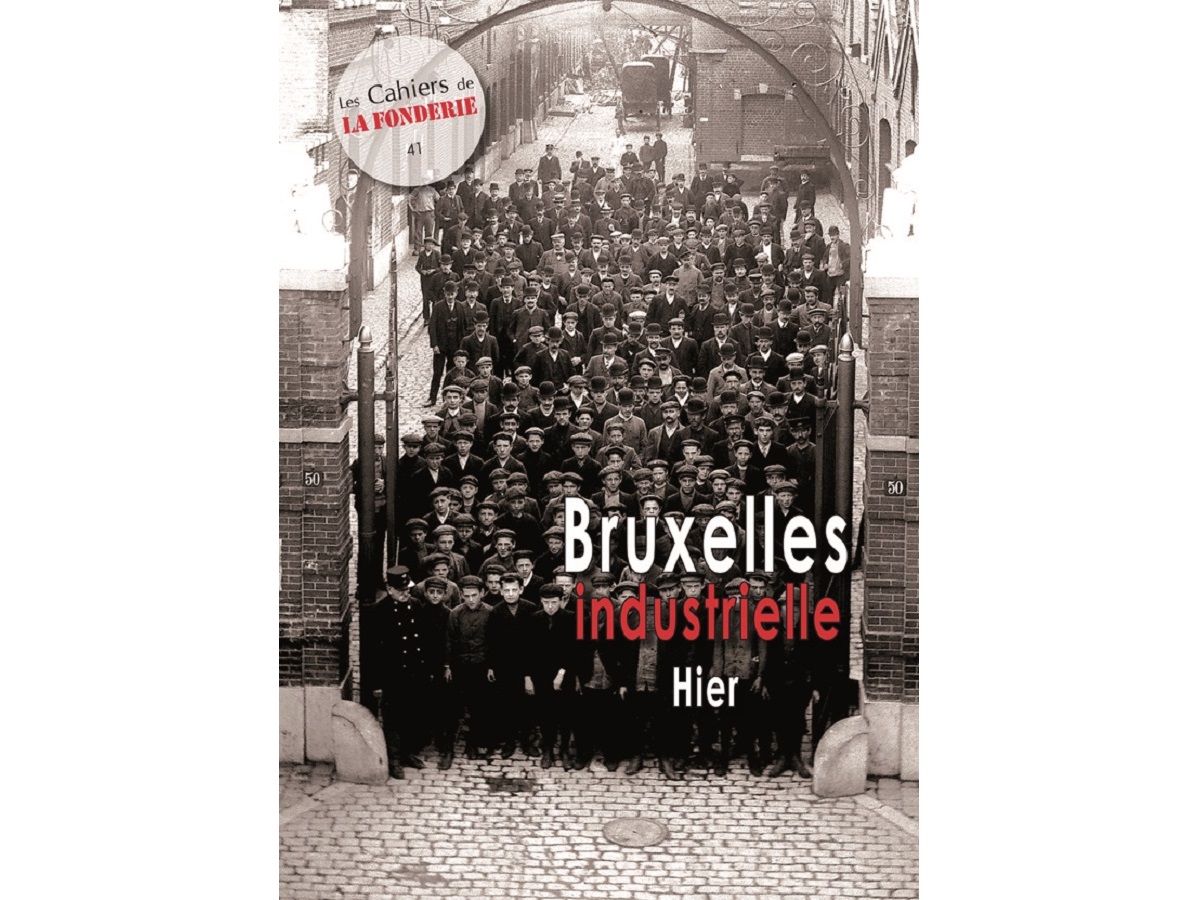
Les témoignages l’attestent, le numéro des Cahiers préféré des lecteurs est sans aucun doute le numéro 11, Bonbons, pralines, esquimaux et chocolats ! Depuis lors, souvent, nous avons eu envie d’aborder le thème de l’alimentation à Bruxelles… c’est chose faite avec la parution de Boire et manger. Dégustez ce menu de choix aux saveurs plutôt inattendues.
Sommaire
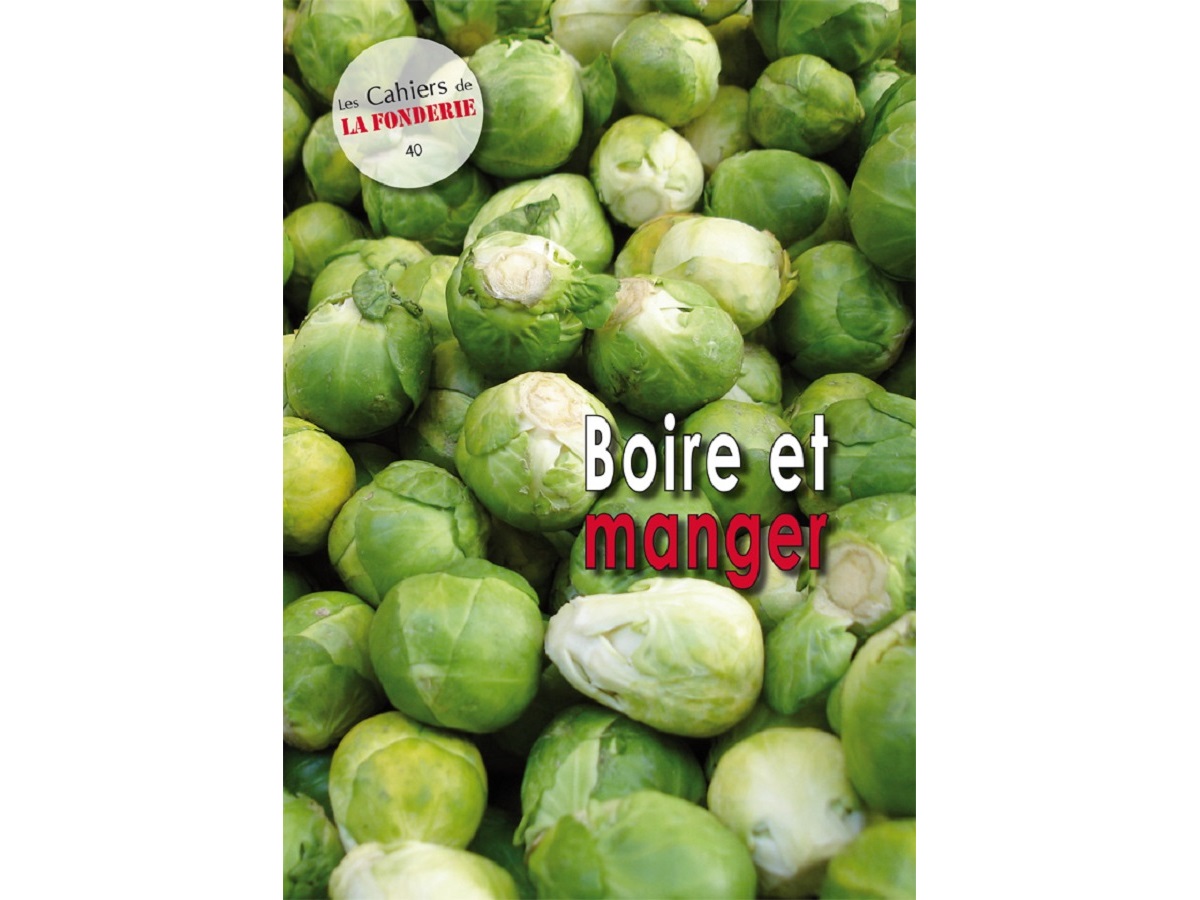
Sommaire
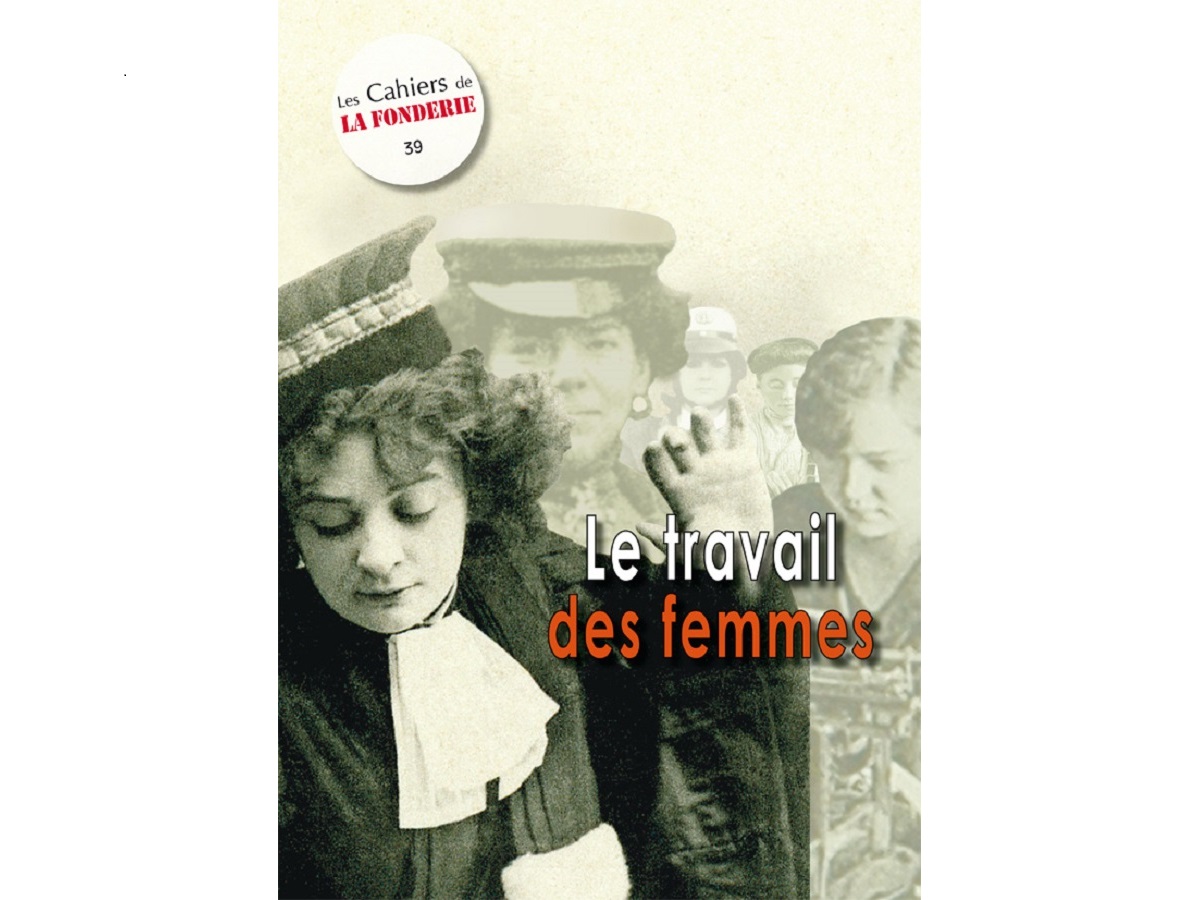
Sommaire
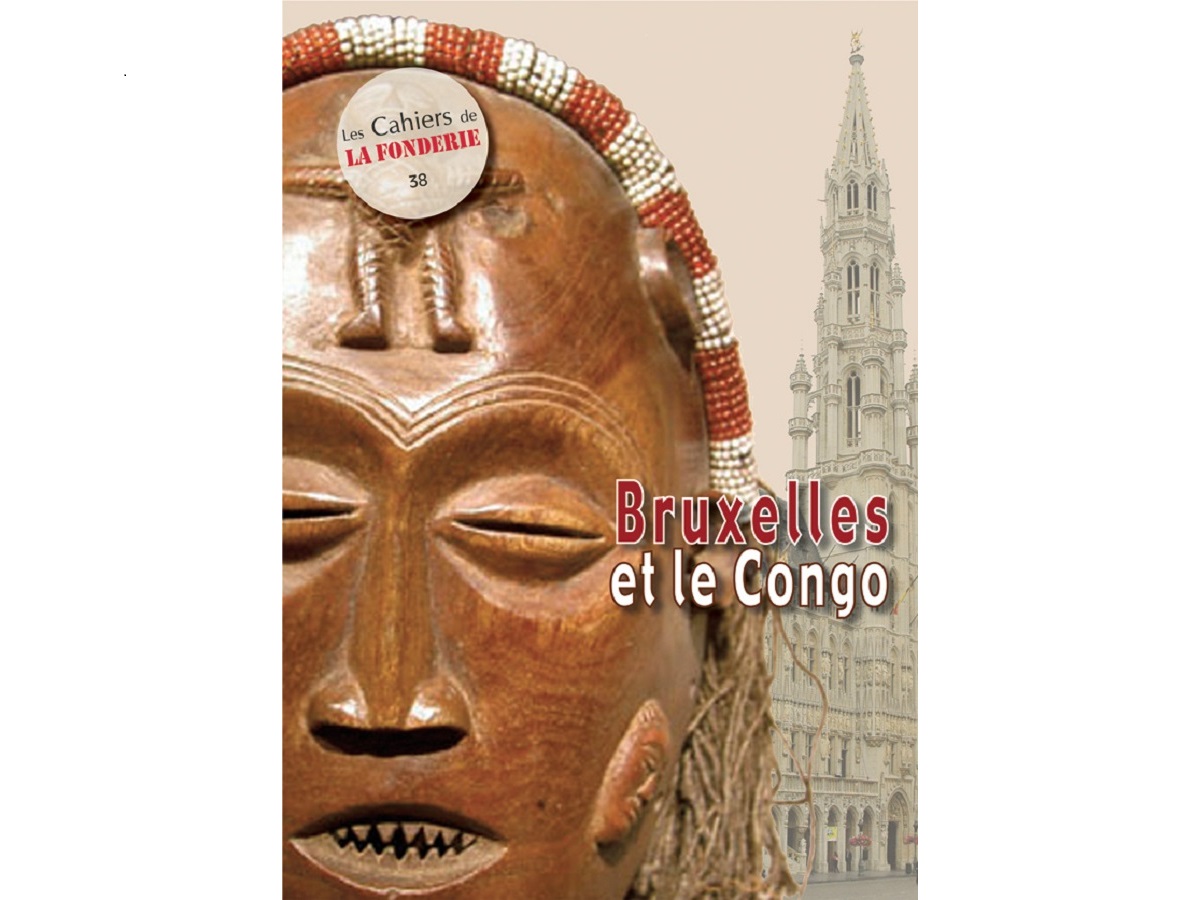
Sommaire
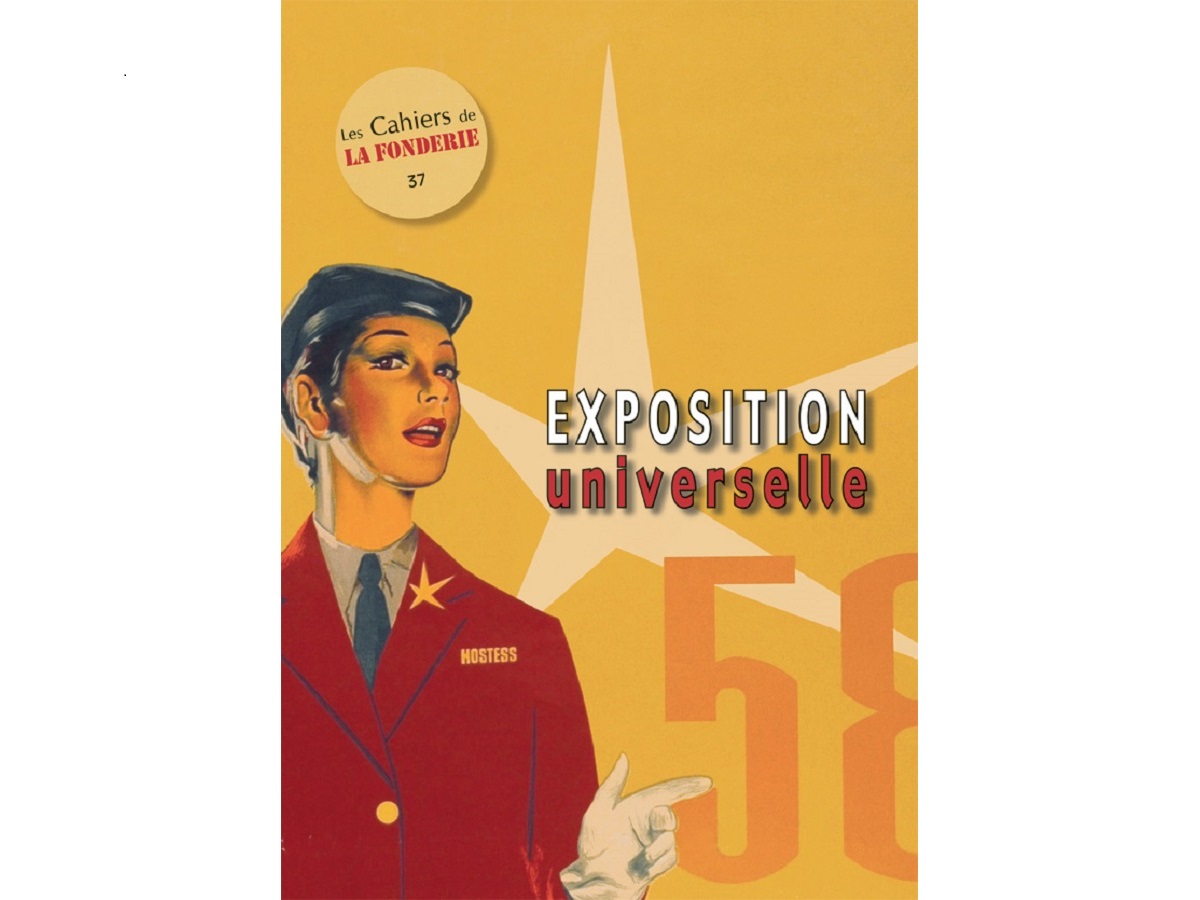
Dimitri est hydrologue et chercheur à la VUB.
Borne située Place de Ninove, en face du numéro 5.
Vous écoutez un podcast réalisé par La Fonderie et le Musée des Égouts, dans le cadre d’une balade sonore en autonomie. Cette balade sonore est un voyage dans les coulisses des métiers de l’eau à Bruxelles.
Les neuf bornes ont été conçues par des jeunes de l’école de devoirs l’Amorce dans le cadre du stage Sous les pavés organisé par La Fonderie, le Musée des Égouts et Fabwest en juillet 2021. Les participants ont réalisé des modèles originaux en plâtre qui ont servi pour couler les bornes-pavés en bronze, inspirées par la grande variété de plaques présentes dans nos rues.
Oh ! La balade s’inscrit dans le cadre de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source. Cette exposition de La Fonderie est accessible d’octobre 2021 à fin juin 2022. Elle est le résultat d’un partenariat avec l’ULB et VIVAQUA dans le cadre de ses 130 ans.
Le plan pour suivre le parcours urbain est à votre disposition à l’accueil de La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail ainsi qu’au Musée des Égouts. C’est gratuit.

Koen travaille pour l’asbl Infirmiers de rue. Son témoignage est en néerlandais.
Borne située près de la fontaine du parc de la Rosée.
L’asbl Infirmiers de rue propose un plan de fontaines d’eau potable et toilettes gratuites au centre-ville. Pour le télécharger, cliquez ici.
Vous écoutez un podcast réalisé par La Fonderie et le Musée des Égouts, dans le cadre d’une balade sonore en autonomie. Cette balade sonore est un voyage dans les coulisses des métiers de l’eau à Bruxelles.
Les neuf bornes ont été conçues par des jeunes de l’école de devoirs l’Amorce dans le cadre du stage Sous les pavés organisé par La Fonderie, le Musée des Égouts et Fabwest en juillet 2021. Les participants ont réalisé des modèles originaux en plâtre qui ont servi pour couler les bornes-pavés en bronze, inspirées par la grande variété de plaques présentes dans nos rues.
Oh ! La balade s’inscrit dans le cadre de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source. Cette exposition de La Fonderie est accessible d’octobre 2021 à fin juin 2022. Elle est le résultat d’un partenariat avec l’ULB et VIVAQUA dans le cadre de ses 130 ans.
Le plan pour suivre le parcours urbain est à votre disposition à l’accueil de La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail ainsi qu’au Musée des Égouts. C’est gratuit.

Roel est historien de la ville. Son témoignage est en néerlandais.
Borne située rue de la Senne, au coin de la Rue Cuerens
Vous écoutez un podcast réalisé par La Fonderie et le Musée des Égouts, dans le cadre d’une balade sonore en autonomie. Cette balade sonore est un voyage dans les coulisses des métiers de l’eau à Bruxelles.
Les neuf bornes ont été conçues par des jeunes de l’école de devoirs l’Amorce dans le cadre du stage Sous les pavés organisé par La Fonderie, le Musée des Égouts et Fabwest en juillet 2021. Les participants ont réalisé des modèles originaux en plâtre qui ont servi pour couler les bornes-pavés en bronze, inspirées par la grande variété de plaques présentes dans nos rues.
Oh ! La balade s’inscrit dans le cadre de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source. Cette exposition de La Fonderie est accessible d’octobre 2021 à fin juin 2022. Elle est le résultat d’un partenariat avec l’ULB et VIVAQUA dans le cadre de ses 130 ans.
Le plan pour suivre le parcours urbain est à votre disposition à l’accueil de La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail ainsi qu’au Musée des Égouts. C’est gratuit.

Christian est expert fontainier.
Borne située rue de la Senne, 75
Vous écoutez un podcast réalisé par La Fonderie et le Musée des Égouts, dans le cadre d’une balade sonore en autonomie. Cette balade sonore est un voyage dans les coulisses des métiers de l’eau à Bruxelles.
Les neuf bornes ont été conçues par des jeunes de l’école de devoirs l’Amorce dans le cadre du stage Sous les pavés organisé par La Fonderie, le Musée des Égouts et Fabwest en juillet 2021. Les participants ont réalisé des modèles originaux en plâtre qui ont servi pour couler les bornes-pavés en bronze, inspirées par la grande variété de plaques présentes dans nos rues.
Oh ! La balade s’inscrit dans le cadre de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source. Cette exposition de La Fonderie est accessible d’octobre 2021 à fin juin 2022. Elle est le résultat d’un partenariat avec l’ULB et VIVAQUA dans le cadre de ses 130 ans.
Le plan pour suivre le parcours urbain est à votre disposition à l’accueil de La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail ainsi qu’au Musée des Égouts. C’est gratuit.

Pieter est le fondateur de Canal It Up. Son témoignage est en néerlandais.
Borne située quai du Hainaut, au coin de la rue Evariste Pierron.
Vous écoutez un podcast réalisé par La Fonderie et le Musée des Égouts, dans le cadre d’une balade sonore en autonomie. Cette balade sonore est un voyage dans les coulisses des métiers de l’eau à Bruxelles.
Les neuf bornes ont été conçues par des jeunes de l’école de devoirs l’Amorce dans le cadre du stage Sous les pavés organisé par La Fonderie, le Musée des Égouts et Fabwest en juillet 2021. Les participants ont réalisé des modèles originaux en plâtre qui ont servi pour couler les bornes-pavés en bronze, inspirées par la grande variété de plaques présentes dans nos rues.
Oh ! La balade s’inscrit dans le cadre de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source. Cette exposition de La Fonderie est accessible d’octobre 2021 à fin juin 2022. Elle est le résultat d’un partenariat avec l’ULB et VIVAQUA dans le cadre de ses 130 ans.
Le plan pour suivre le parcours urbain est à votre disposition à l’accueil de La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail ainsi qu’au Musée des Égouts. C’est gratuit.

André est patron de bains.
Borne située devant les Bains-douches publics, Rue Ransfort 76.
Vous écoutez un podcast réalisé par La Fonderie et le Musée des Égouts, dans le cadre d’une balade sonore en autonomie. Cette balade sonore est un voyage dans les coulisses des métiers de l’eau à Bruxelles.
Les neuf bornes ont été conçues par des jeunes de l’école de devoirs l’Amorce dans le cadre du stage Sous les pavés organisé par La Fonderie, le Musée des Égouts et Fabwest en juillet 2021. Les participants ont réalisé des modèles originaux en plâtre qui ont servi pour couler les bornes-pavés en bronze, inspirées par la grande variété de plaques présentes dans nos rues.
Oh ! La balade s’inscrit dans le cadre de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source. Cette exposition de La Fonderie est accessible d’octobre 2021 à fin juin 2022. Elle est le résultat d’un partenariat avec l’ULB et VIVAQUA dans le cadre de ses 130 ans.
Le plan pour suivre le parcours urbain est à votre disposition à l’accueil de La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail ainsi qu’au Musée des Égouts. C’est gratuit.

Armand Steurs fut le premier directeur de la Compagnie Intercommunale des Eaux.
Borne située dans la cour de La Fonderie, Rue Ransfort 27.
Vous écoutez un podcast réalisé par La Fonderie et le Musée des Égouts, dans le cadre d’une balade sonore en autonomie. Cette balade sonore est un voyage dans les coulisses des métiers de l’eau à Bruxelles.
Les neuf bornes ont été conçues par des jeunes de l’école de devoirs l’Amorce dans le cadre du stage Sous les pavés organisé par La Fonderie, le Musée des Égouts et Fabwest en juillet 2021. Les participants ont réalisé des modèles originaux en plâtre qui ont servi pour couler les bornes-pavés en bronze, inspirées par la grande variété de plaques présentes dans nos rues.
Oh ! La balade s’inscrit dans le cadre de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source. Cette exposition de La Fonderie est accessible d’octobre 2021 à fin juin 2022. Elle est le résultat d’un partenariat avec l’ULB et VIVAQUA dans le cadre de ses 130 ans.
Le plan pour suivre le parcours urbain est à votre disposition à l’accueil de La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail ainsi qu’au Musée des Égouts. C’est gratuit.

Negi est caporal pompier de Bruxelles.
Borne située Place Alphonse Lemmens, en face du numéro 16.
Vous écoutez un podcast réalisé par La Fonderie et le Musée des Égouts, dans le cadre d’une balade sonore en autonomie. Cette balade sonore est un voyage dans les coulisses des métiers de l’eau à Bruxelles.
Les neuf bornes ont été conçues par des jeunes de l’école de devoirs l’Amorce dans le cadre du stage Sous les pavés organisé par La Fonderie, le Musée des Égouts et Fabwest en juillet 2021. Les participants ont réalisé des modèles originaux en plâtre qui ont servi pour couler les bornes-pavés en bronze, inspirées par la grande variété de plaques présentes dans nos rues.
Oh ! La balade s’inscrit dans le cadre de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source. Cette exposition de La Fonderie est accessible d’octobre 2021 à fin juin 2022. Elle est le résultat d’un partenariat avec l’ULB et VIVAQUA dans le cadre de ses 130 ans.
Le plan pour suivre le parcours urbain est à votre disposition à l’accueil de La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail ainsi qu’au Musée des Égouts. C’est gratuit.
Roland est égoutier retraité.
Borne située au Musée des Égouts, à l’entrée du pavillon d’octroi, Porte d’Anderlecht.
Vous écoutez un podcast réalisé par La Fonderie et le Musée des Égouts, dans le cadre d’une balade sonore en autonomie. Cette balade sonore est un voyage dans les coulisses des métiers de l’eau à Bruxelles.
Les neuf bornes ont été conçues par des jeunes de l’école de devoirs l’Amorce dans le cadre du stage Sous les pavés organisé par La Fonderie, le Musée des Égouts et Fabwest en juillet 2021. Les participants ont réalisé des modèles originaux en plâtre qui ont servi pour couler les bornes-pavés en bronze, inspirées par la grande variété de plaques présentes dans nos rues.
Oh ! La balade s’inscrit dans le cadre de l’exposition Oh ! Ça ne coule pas de source. Cette exposition de La Fonderie est accessible d’octobre 2021 à fin juin 2022. Elle est le résultat d’un partenariat avec l’ULB et VIVAQUA dans le cadre de ses 130 ans.
Le plan pour suivre le parcours urbain est à votre disposition à l’accueil de La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail ainsi qu’au Musée des Égouts. C’est gratuit.
